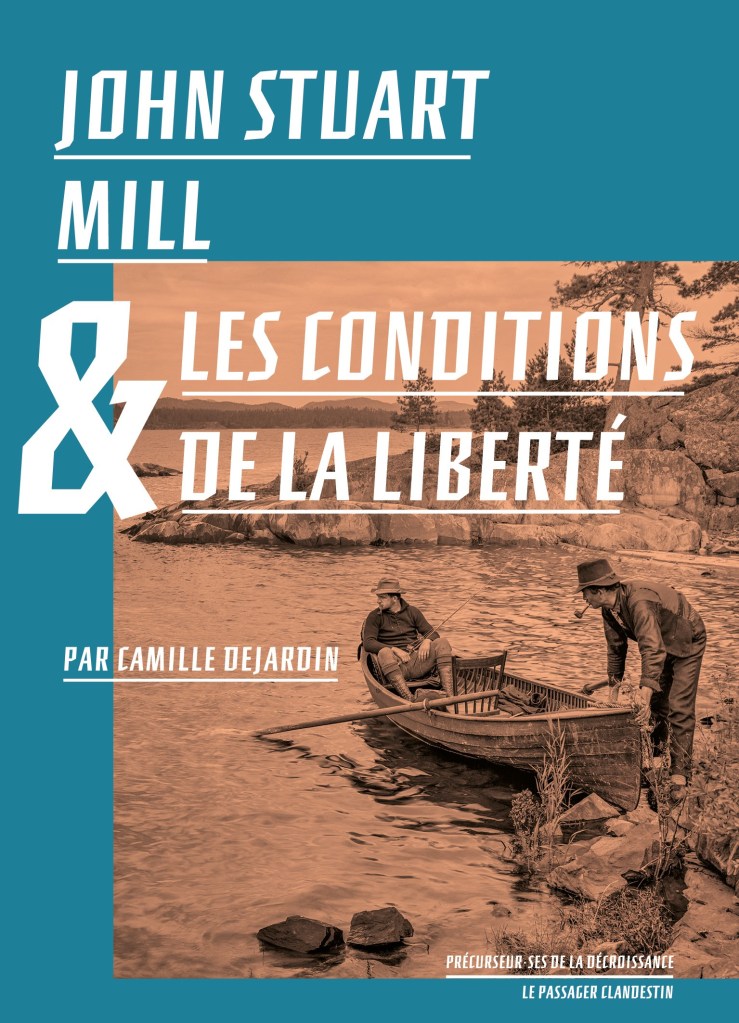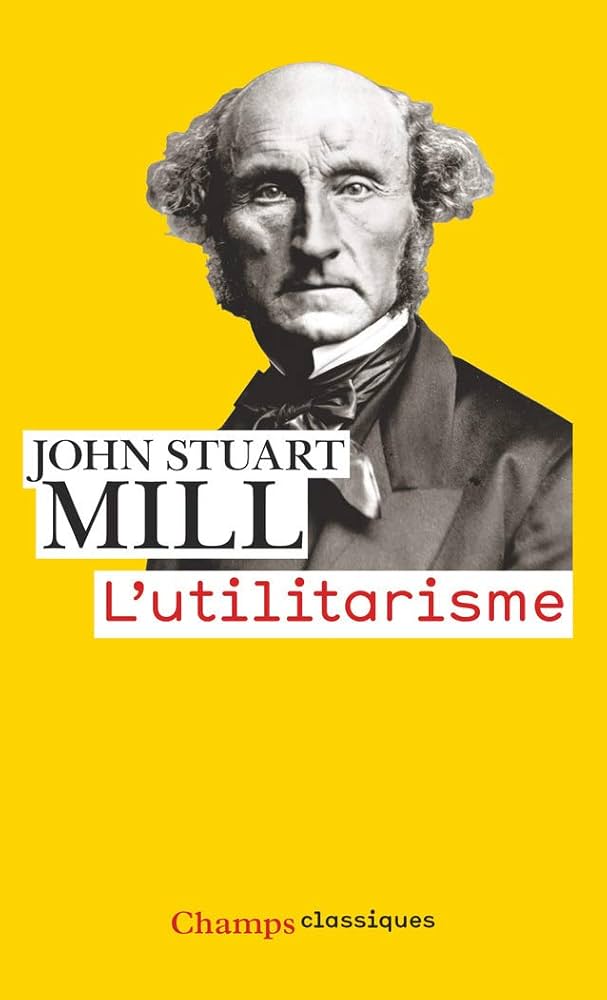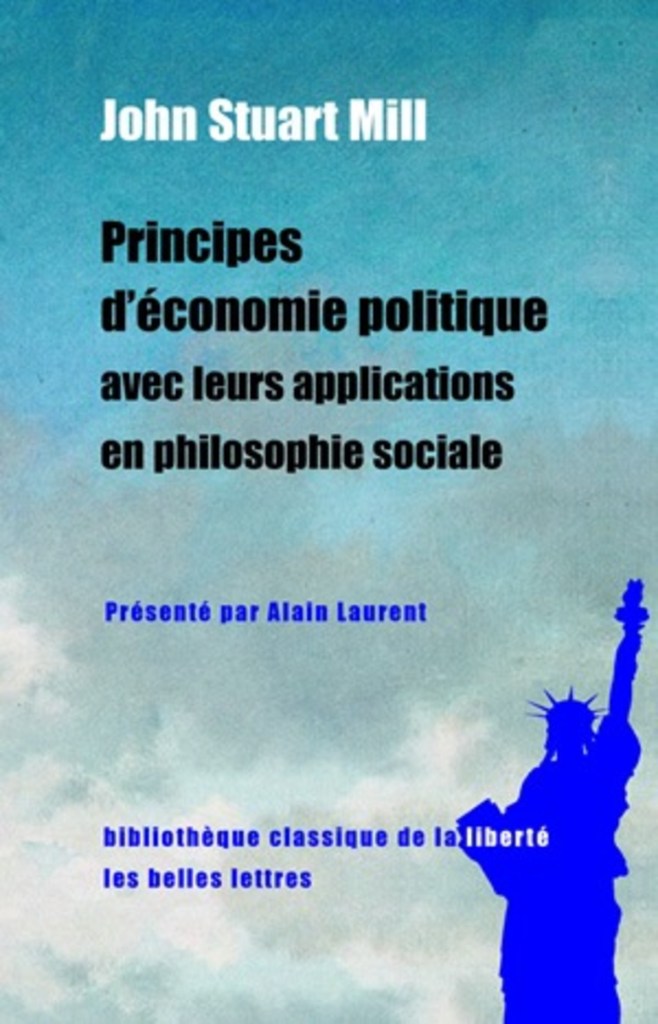John Stuart Mill fait partie des classiques, de ceux dont on a entendu parler et qu’on croit connaître sans forcément les avoir lus. Mais si Mill est un classique, il est aussi éminemment moderne et surprenant. Il aborde de multiples domaines (écologie, économie, féminisme, éducation…) et développe une pensée bien éloignée des préjugés que certains portent rapidement sur elle. Camille Dejardin, auteur du récent « Mill et les conditions de la liberté » (Le Passager Clandestin), vous le présente à neuf.
Le Comptoir : Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous amenée à vous intéresser à John Stuart Mill ?
Camille Dejardin : Je suis professeur agrégée de philosophie, docteur en sciences politiques et chercheuse en philosophie politique actuellement associée à l’Université Catholique de Louvain. Ma rencontre avec John Stuart Mill remonte à mes cours d’anglais de khâgne. Mais c’est en Master de philosophie politique qu’on m’a fait travailler sur un passage traitant de l’individualité, qui m’a intéressée particulièrement du fait de parallèles avec la pensée de Tocqueville, que je connaissais mieux à l’époque.
De fil en aiguille, en 2012 j’ai décidé de consacrer ma thèse à Mill. À l’époque, il était largement considéré comme un auteur « mineur ». J’ose croire que j’ai participé au renouveau actuel des études milliennes (avec, d’ailleurs, un glissement progressif de l’œuvre de Mill vers celle de sa collaboratrice et épouse Harriet Taylor, avec l’essor des études féministes), qui n’était pas du tout acquis il y a dix ans.
Concrètement, j’ai lu et étudié toute son œuvre politique à la recherche d’une clé de lecture, alors que certains commentateurs le trouvaient « incohérent », notamment du fait du contraste apparent entre ses ouvrages les plus célèbres, De la liberté et L’Utilitarisme. En réalité, il n’y a pas contradiction mais convergence profonde, portant sur la conscience des prérequis à la fois de la liberté (c’est une théorie de l’individualité et de ce qui permet à celle-ci d’éclore, notamment l’éducation) et d’un exercice effectif et pérenne de celle-ci en société (d’où des enjeux éducatifs mais également sociaux et environnementaux).
Votre ouvrage paraît dans une collection consacrée aux pionniers de la décroissance. Mais avant d’aborder cette thématique, pourriez-vous nous donner les fondamentaux de la philosophie de Mill ?
Dans mon premier livre (John Stuart Mill, libéral utopique. Actualité d’une pensée visionnaire, Gallimard, 2022), je me suis attachée à rendre accessibles au public les acquis de mes recherches doctorales : ce qui m’apparaît comme le cœur problématique et conceptuel de la philosophie morale et politique de Mill.
Schématiquement, Mill est un théoricien à la fois de l’utilité – le rapport de chaque individu et de la communauté des citoyens au « bonheur », qui ne se réduit pas au bien-être mais mêle vertu et réalisation de soi – et de la liberté – qu’il définit comme autonomie, c’est-à-dire comme latitude effective d’expression de choix personnels, lesquels supposent en amont une formation solide du soi. Ces deux idéaux combinés, utilité et liberté, ont longtemps divisé et dérouté les critiques : le Mill utilitariste rebute les libéraux qui voient dans la recherche de maximisation du bonheur, selon des clichés qui ont la vie dure, une entrave à la liberté individuelle. Le Mill libéral pourrait aussi dérouter les utilitaristes en étant assimilé à un ennemi du « bien commun » au nom de la liberté individuelle et de la liberté économique.
Pourtant, ces idéaux ne se réduisent pas à des formules simplistes et peuvent converger : pourquoi la liberté s’opposerait-elle au bien commun ? Liberté et utilité ne sont-elles pas plutôt des conditions l’une de l’autre, la liberté n’ayant aucun sens dans un monde injuste de prédation et de conflits, le bien commun pouvant difficilement être tenu pour effectif au prix de l’asservissement ou de l’embrigadement ? La pensée de Mill, que l’on peut qualifier avec Catherine Audard de « libéralisme social », et que j’ai appelée « libéralisme utopique » du fait de sa proximité avec les socialismes dits utopiques et de sa profonde exigence d’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles, dépasse les contradictions apparentes et propose une synthèse transpartisane qui n’est pas pour autant « tiède » ni dénuée de cohérence.
« Chez Mill il y a une convergence profonde, portant sur la conscience des prérequis à la fois de la liberté et d’un exercice effectif et pérenne de celle-ci en société. »
Comment Mill propose-t-il une synthèse dépassant ces apparentes contradictions ?
À y regarder de plus près, le problème sous-jacent est commun à la poursuite de ces deux idéaux, liberté et utilité. En effet, chez Mill, la promotion de la liberté (comme autonomie) comme celle du bonheur (comme libre réalisation de son individualité) supposent dans tous les cas un sujet bien constitué, un individu capable de penser, de juger, de parler et de se faire entendre en son nom propre. Mais qu’est-ce que « son nom propre » dans une société massifiée ?
Tous les individus, auxquels l’individualisme juridique accorde désormais par principe une dignité et une voix, ont-ils véritablement une individualité à faire valoir ? Comment celle-ci est-elle et peut-elle se constituer ? À la racine de toutes les revendications proprement politiques, il faut d’ores et déjà un individu réalisé. Avec Nicolas Quérini, j’ai donc tendance à penser que la priorité de Mill « est le self-development » et que ce sont les besoins de celui-ci qui fédèrent un grand nombre de ses autres préconisations.
À ce stade, faut-il considérer que Mill est individualiste ou anti-individualiste ? Égalitaire ou élitiste ?
Tout se joue dans la nuance. Le fait que Mill puisse être, malgré son étiquette d’utilitariste et d’ami de Bentham, un défenseur de l’individualité de chacun, semble paradoxal. Et qu’il décrète que l’individualité n’est pas un donné mais un acquis que les circonstances sociales doivent encourager (même s’il revient toujours à chaque individu de l’actualiser) laisse perplexe : et ce, tant les libéraux (qui ont tendance à vanter l’initiative ou le mérite individuel sans en considérer les prérequis) que les socialistes (qui auraient au contraire tendance à tabler sur une égalité de talents ou, du moins, à ne pas reconnaître qu’il y ait des individus plus accomplis et « meilleurs » que d’autres).
En fait, Mill propose une synthèse entre libéralisme, socialisme, conservatisme, féminisme, utilitarisme et proto-écologie qui souligne les besoins de l’individualité et les prérequis ou conditions de la liberté. Par sa subtilité, il aurait tout pour mettre bien des gens d’accord, mais la contrepartie est que tout le monde peut lui reprocher quelque chose !
« La pensée de Mill peut-être qualifiée de « libéralisme utopique » du fait de sa proximité avec les socialismes dits utopiques et de sa profonde exigence d’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles. »
En l’occurrence, il n’y a rien de véritablement élitiste chez Mill puisque l’enjeu est pour lui de favoriser les conditions à la fois les plus larges et les plus exigeantes du développement de soi pour le plus grand nombre, pour les deux sexes et avec la meilleure répartition des chances possible. Et ces conditions sont aussi bien intellectuelles et institutionnelles que matérielles, ce qui emporte de profondes conséquences sociales et même écologiques. En l’occurrence, c’est remarquable sous la plume d’un libéral du XIXe siècle. C’est cela que je détaille dans l’ouvrage paru au Passager clandestin, extraits retraduits ou inédits à l’appui.
Vous qualifiez Mill de « libéral dissident ». Qu’entendez-vous par là ?
Justifions d’abord « libéral ». Mill en est indéniablement un. Économiquement, c’est un économiste classique, donc d’obédience globalement favorable à l’économie de marché, opposé à la réglementation des prix, etc. Politiquement, il se disait libéral (bien que se qualifiât de « socialiste » à la fin de sa vie), critiquait toute forme de réduction de la liberté individuelle au nom d’un principe d’égalité, voyait dans l’égalité des chances un besoin mais dans l’égalitarisme un fléau.
Contrairement aux démocrates de son temps, il défendait aussi un principe de compétence dans la participation aux affaires publiques, se méfiait des droits tenus pour innés, promouvait le mérite et l’émulation permanente, envisageait même un « vote plural » (tout le monde aurait au moins une voix mais certains en auraient plusieurs). Tout cela le rattache à la mouvance libérale, bien qu’il ait eu des interlocuteurs dans tous les partis, des socialistes aux Tories.
Reste qu’il ne défend jamais ces valeurs in abstracto. Sa pensée normative ne cesse de revenir vers le réel, de pointer les limites ou les besoins attachés aux valeurs qu’il défend. Quand il défend le mérite, il rappelle que celui-ci n’a aucun sens sans une égalité des chances effectives, qui doit être préalablement assurée par une éducation de qualité pour tous. Quand il parle d’émulation, il rappelle qu’elle n’a pas non de sens sans une éducation comparable, des exigences comparables mais aussi des chances comparables, ce pourquoi il fait plus que réclamer la fin des « barrières à l’entrée » qui sont opposées aux femmes dans le choix de leur profession : il demande aussi la fin de l’éducation (scolaire mais aussi familiale et domestique) selon le sexe et l’accès des femmes à toute la gamme des formations.
« Mill propose une synthèse entre libéralisme, socialisme, conservatisme, féminisme, utilitarisme et proto-écologie qui souligne les besoins de l’individualité et les prérequis ou conditions de la liberté. »
Et, à plusieurs reprises, cet attachement à l’aspect concret, enchâssé ou rétroagissant de ses considérations le fait s’opposer à d’autres penseurs ou politiques libéraux. C’est en cela que je l’appelle « dissident ».
Mill était donc aussi critique du libéralisme de son temps ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’en tient jamais à la doxa libérale, qu’il dénonce déjà à son époque comme ossifiée autour de principes comme la libre entreprise, la propriété privée mais aussi la réticence au suffrage universel, sans voir les prérequis de ces principes ou leurs limites dans certaines situations.
C’est précisément dans une telle relativisation des théories précédentes qu’il s’oppose à l’objectif de croissance économique (alors appelé « état économique progressif ») illimité. Dans son chapitre « De l’état stationnaire » des Principes d’économie politique, il s’oppose à ceux qu’il désigne comme « les économistes de la vieille école », pour qui tout progrès passe par l’augmentation de la production de richesses et de la population, et non par une meilleure répartition des richesses au sein d’une population potentiellement stagnante voire artificiellement contenue dans des bornes strictes. À ce moment-là, il se revendique de Malthus contre Godwin mais aussi Ricardo, son propre maître.
« Mill demande la fin de l’éducation (scolaire mais aussi familiale et domestique) selon le sexe et l’accès des femmes à toute la gamme des formations. »
Plus tard, cet aspect « dissident » de sa critique du matérialisme moral, du consumérisme et de la poursuite de l’augmentation des richesses disponibles sans égard pour leur juste répartition ou pour les conséquences environnementales de leur extraction va même le condamner à une certaine éclipse, au moins dans les cursus académiques « continentaux ». Je me répète, mais il faut bien prendre conscience qu’il y a encore quinze ans, vouloir étudier Mill en philosophie (et non au titre de quelque archéologie de l’économie ou dans un cours de culture anglo-saxonne) passait pour farfelu. Sans doute du fait de cet anticonformisme !
Nos Desserts :
- Se procurer l’ouvrage de Camille Dejardin chez votre libraire
- Sur Le Comptoir, lire la 2ème partie de l’entretien avec Camille Dejardin
- Fabrice Arfi nous propose de relire John Lock
- Entretien de Camille Dejardin dans Socialter
- Trois émissions consacrée à John Stuart Mill sur France Culture
Catégories :Politique