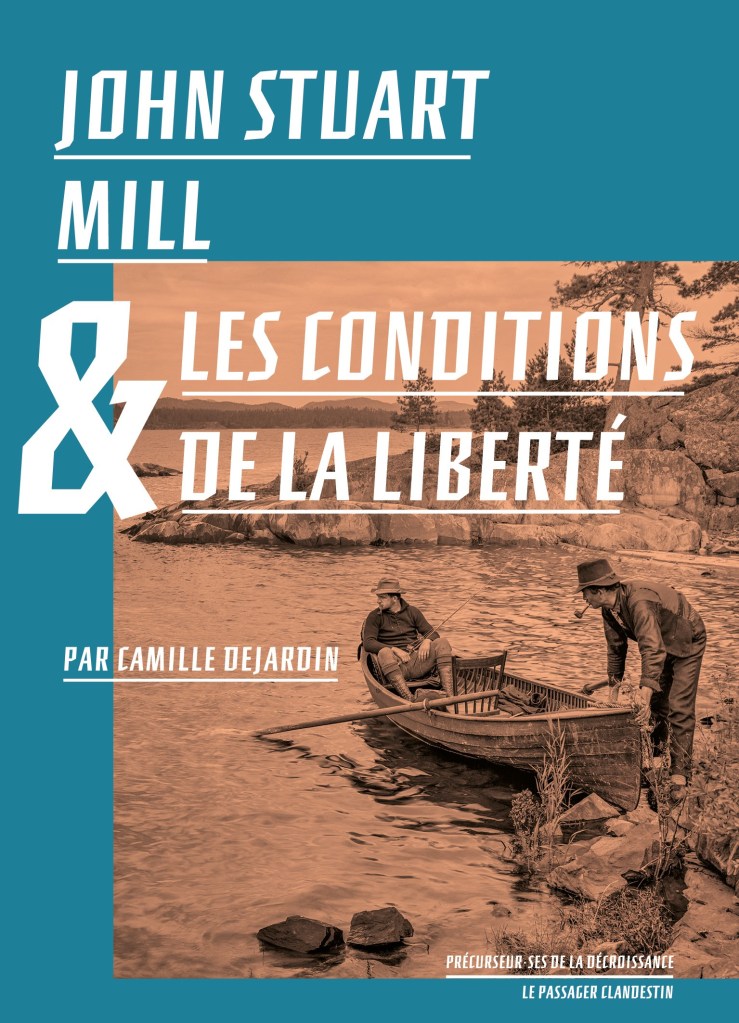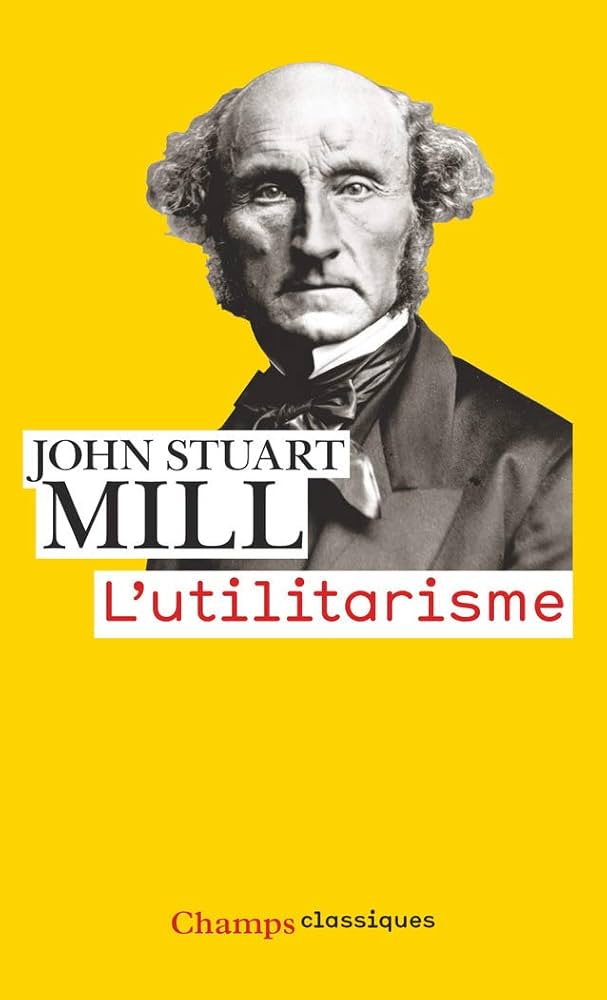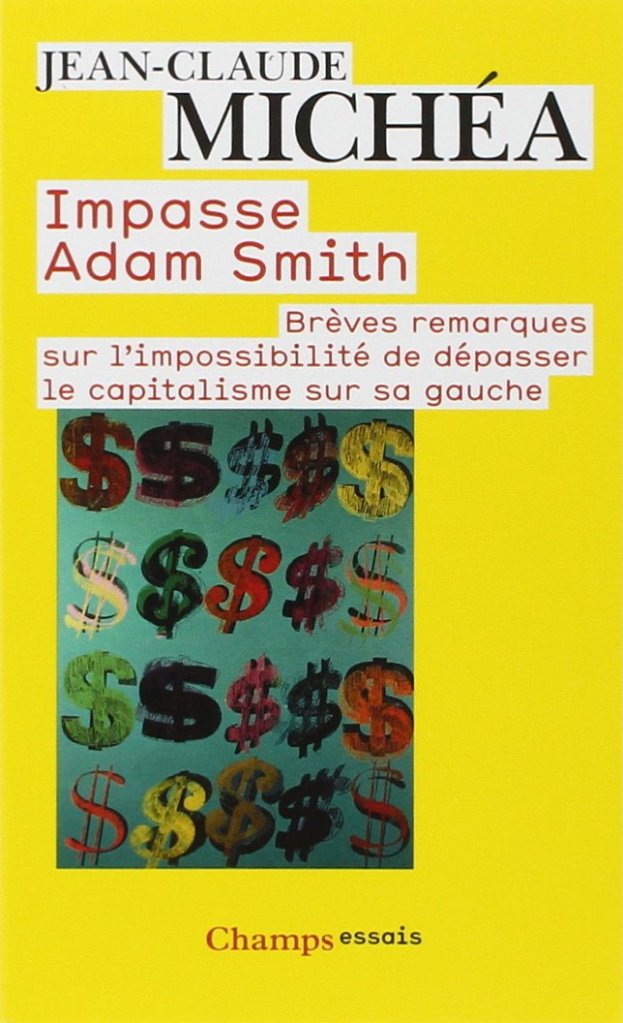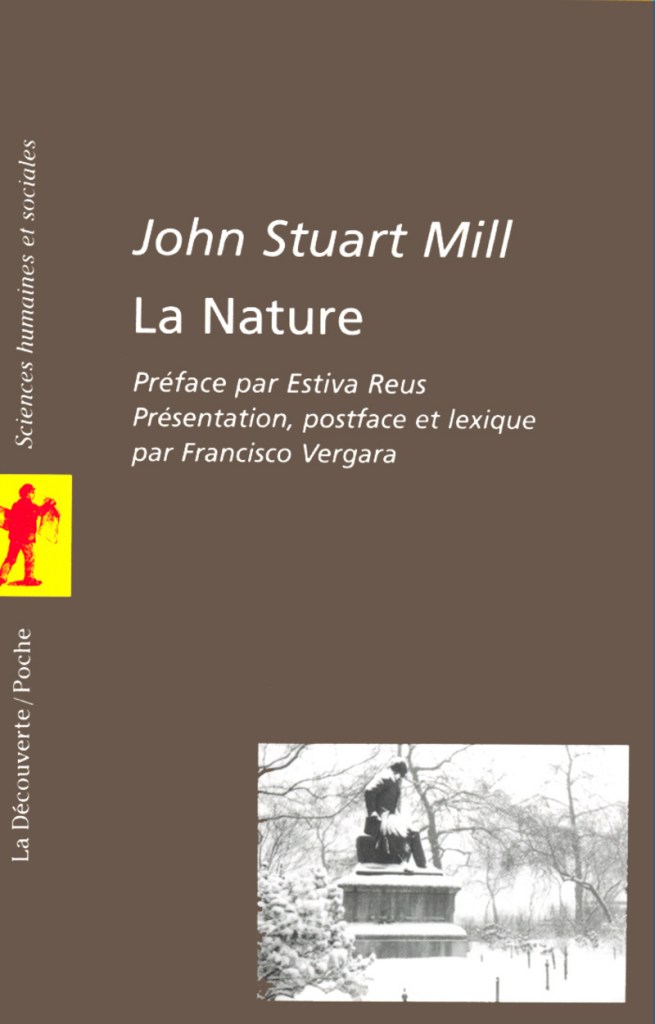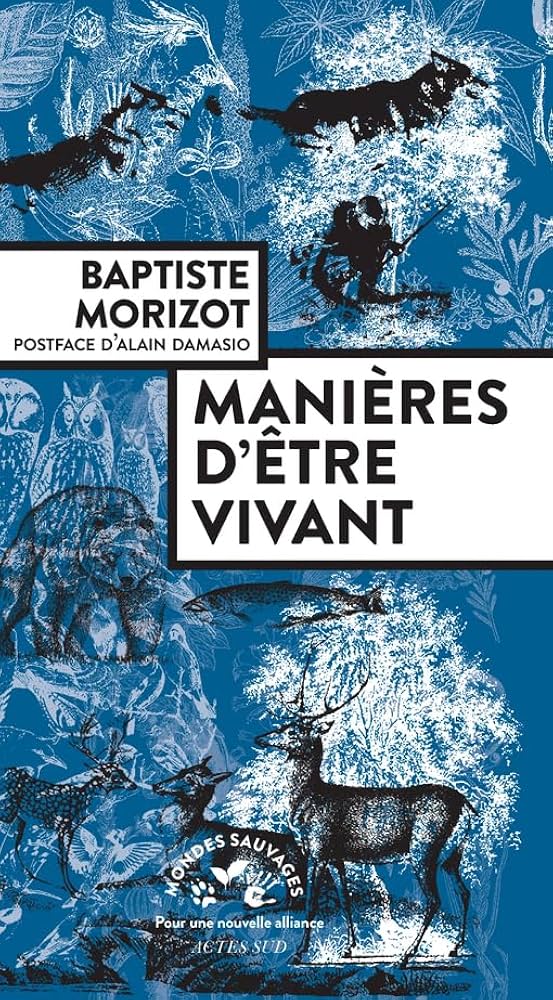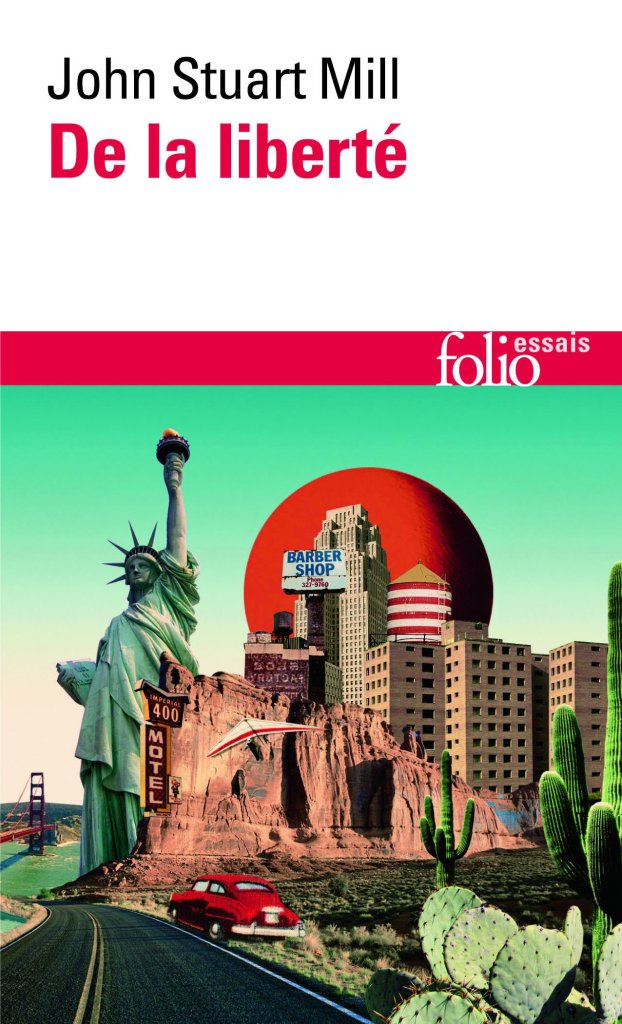Depuis plus d’une décennie, historiens et philosophes relisent les classiques du libéralisme et leurs découvertes surprennent. Loin de s’en remettre au libre marché ou d’encenser l’esprit marchand, Locke, Smith ou Mill sécrètent aussi un antidote permettant de se prémunir contre la marchandisation. Et on peut puiser chez eux bien de quoi remettre en cause le néolibéralisme et le productivisme actuels. Suite de l’entretien avec Camille Dejardin, auteure du récent « Mill et les conditions de la liberté » (Le Passager Clandestin).
Le Comptoir : La pensée de Mill vous semble-t-elle avoir un potentiel émancipateur pour notre temps ?
Camille Dejardin : Bien sûr ! C’est une pensée salutaire et stimulante à plusieurs égards.
Tout d’abord, en tant que critique interne du libéralisme, elle montre que la critique des excès du libéralisme (et, ai-je tendance à penser, de sa nouvelle forme qu’est le néolibéralisme) ne conduit pas nécessairement à l’illibéralisme voire à l’autoritarisme.
Aujourd’hui le débat est biaisé. Si vous critiquez une position autoproclamée progressiste, vous êtes « réactionnaire ». Si vous pointez ce que le libéralisme a d’autoritaire dans son déploiement économique, par exemple, vous êtes « socialiste » voire « communiste » (et donc rapidement ramené à l’URSS, dont l’échec reconnu sert d’argument d’autorité pour mettre fin à la discussion). Si vous êtes contre la dérégulation dans certains domaines, voire que vous critiquez l’objectif de croissance illimitée, vous êtes un autoritariste, un rétrograde, un « khmer vert », etc. Et, de fait, de nombreux pays qui critiquent certains aspects du libéralisme actuel prennent aujourd’hui de manière effrayante le chemin de l’autoritarisme ou de la dictature ! Sans pour autant prendre la voie de la sobriété écologique, notons-le…
Mill, lui, indique que des passerelles et des compromis sont possibles. Ce qu’il propose, c’est un libéralisme social sur fond de conservation et de transmission (d’un environnement de qualité et du patrimoine intellectuel et littéraire classique). C’est un « progrès » qui ne soit pas confondu avec le laisser-aller ou la fuite en avant. Et, de facto, du fait de la primauté d’« intérêts sinistres » fort éloignés du développement harmonieux des facultés individuelles ou de la communauté civique dans son ensemble, c’est une option subtile n’a jamais été prise au sérieux !
Et quand bien même on n’adhérerait pas à ses idées, il me semble que la lecture de Mill ne peut faire que du bien, par son ouverture et sa nuance mêmes. Sa tournure d’esprit est un antidote à la binarisation des débats et à l’anathème remplaçant la pensée. Il incarne ce que Jean Birnbaum appelle « le courage de la nuance » : l’effort honnête face à la difficulté de penser, sans s’en tenir aux écoles ni aux slogans. Lire Mill, c’est donc non seulement lire un penseur qui déjoue les étiquettes dont on prétend l’affubler ; c’est aussi lire un auteur qui oblige son lecteur à penser et je crois que c’est ce dont notre époque « de gens qui écrivent à la hâte pour des gens qui lisent à la hâte », disait déjà Mill, a le plus besoin.
Au-delà de Mill, on observe actuellement de nombreuses relectures des fondateurs du libéralisme (Locke, Smith, notamment). Ceux-ci paraissent en fait assez éloignés d’être de simples partisans du libre marché. Cette rectification vous paraît-elle juste ? Si oui, comment expliquer que leurs écrits aient été caricaturés ?
J’ai l’impression que la seconde moitié du XXe siècle a rebattu un grand nombre de cartes et nous a fait voir beaucoup de nouvelles choses mais aussi oublier ou déformer beaucoup d’anciennes, et notamment d’anciennes façons de penser et de sentir, balayées par la « société de consommation ».
L’après-guerre a été marqué, comme on le sait, par une période qualifiée d’« euphorie économique » par la plupart des enseignants : en réalité, une période de croissance sans précédent de la production et de la consommation de richesses, donc aussi de l’extraction de ressources. Et ce, pour des gains de confort certes palpables et parfois inouïs, sur fond de reconstruction et d’une focalisation inédite sur les conditions matérielles de l’existence après le traumatisme subi. Dans le même temps, la hantise de l’autoritarisme et de l’horreur a permis à une poussée égalitaire et libertaire elle aussi sans précédent de trouver une expression de plus en plus légitime, et finalement victorieuse (même si elle a d’abord été réprimée d’une manière qui nous semble très violente aujourd’hui). Enfin, la Guerre froide, avec son opposition bien tranchée entre deux blocs dont chacun diabolisait l’autre, a donné à chaque camp la possibilité de se dire le camp du Bien contre celui du Mal.
« La tournure d’esprit de Mill est un antidote à la binarisation des débats et à l’anathème remplaçant la pensée. »
Ces trois caractéristiques : mutations économiques accélérées et ère de « croissance », poussée égalitaire et libertaire, monde bipolaire ayant converti tout l’Occident en camp revendiqué du capitalisme et « de la liberté », a contribué à ancrer une certaine vision du libéralisme, de son histoire, de ses fondements conceptuels et de ses ennemis.
Cette vision est-elle juste ?
Il ne faut pas oublier que toute idéologie, y compris dominante et par là parfois implicite, écrit sa propre histoire (et écrit l’histoire tout court). Et le libéralisme capitaliste et plus ou moins libertaire de l’Ouest est « notre » idéologie, celle dans laquelle nous baignons depuis l’après-guerre et a fortiori depuis le milieu des années 1970, alors dans un contexte d’opposition tranchée à un bloc ennemi qui faisait de toute forme de socialisme un repoussoir et de toute critique sociale prétexte à suspicion de passage à l’Est (suspicion le plus souvent exagérée dans le contexte états-unien du maccarthysme mais parfois plus fondée en France, où nombre d’intellectuels ont été étonnamment complaisants pendant des décennies avec le totalitarisme soviétique puis le maoïsme, comme Sartre, Beauvoir et bien d’autres, dont certains sont encore vivants et parfois devenus conservateurs).
Or, l’histoire du libéralisme a en partie été écrite ou réécrite à ce moment où l’opinion s’est bipolarisée et simplifiée, et a rendu comme étanches libéralisme et socialisme politiques alors qu’ils ne l’ont presque jamais été. A aussi été rendue étanche la frontière économique entre propriété privée et propriété collective, alors que de nombreux intermédiaires sont envisageables et étaient considérés avec plausibilité par des économistes passés (comme Mill), notamment en ce qui concerne les coopératives.
D’éminents théoriciens comme Friedrich Hayek ont écrit une histoire du libéralisme qui passe sous silence une grande partie des nuances qui en constituaient des sous-mouvances, des singularités. Hayek a d’ailleurs fait un excellent travail biographique et éditorial au sujet de Mill mais tantôt en gommant, tantôt en discréditant ce qui lui apparaissait comme ses aspérités.
Il en a été de même d’Adam Smith, réduit à l’idée de « main invisible », qui arrangeait beaucoup de penseurs libéraux du XXe siècle désireux de faire de lui leur saint patron, mais qui est à peine un concept sous sa plume. Et les adversaires du libéralisme ont aussi pris part à cette réduction : Jean-Claude Michéa, par exemple, à qui l’on doit cependant nombre d’analyses intéressantes, écrit « impasse Adam Smith » comme si le pauvre économiste et moraliste écossais de la fin du XVIIIe siècle était responsable de nos maux présents…
Les idéologies ont-elles réellement profondément changé ?
Je ne nie aucunement que les idées s’engendrent les unes les autres et ont une certaine efficacité dans l’histoire mais je récuse le caractère direct de cette filiation. À mes yeux, le libéralisme a changé au XXe siècle en même temps que d’autres aspects du monde qui rendent impossibles un simple retour en arrière mais aussi une continuité sans mélange entre les pensées d’avant et celles de nos jours. Je pense à ce titre que le « néolibéralisme » n’était pas nécessairement écrit ou « en germe » dans le libéralisme dit classique, et qu’il y a dans celui-ci des aspects qui méritent d’être défendus, repris ou ne serait-ce que redécouverts en essayant de les appréhender avant leur dévoiement ou leur occultation.
De manière générale, faire l’économie de la nuance est le principal danger d’une époque qui tend à réduire toute la complexité et la richesse du monde comme de la pensée à des clichés et des slogans de type commercial, courts, faciles à retenir, y compris en philosophie. Descartes a subi pareil traitement quand certains ont fait de son expression « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » l’origine de rien de moins que la catastrophe écologique actuelle et d’un « prométhéisme » qui le relierait quasiment directement à Elon Musk. Ce serait trop simple !
Alors oui, je pense qu’il y a beaucoup de gestes salutaires dans les « redécouvertes » actuelles de penseurs antérieurs, notamment dans la famille libérale. Beaucoup d’auteurs caricaturés ou simplement oubliés retrouvent là une lecture plus probe, plus attentive aux détails.
N’y a-t-il pas certains dangers dans ces relectures des auteurs passés ?
Oui, certes : méfions-nous de ne pas tomber dans un excès inverse, en voyant dans tout auteur passé un « précurseur » de nos luttes actuelles, ce qui serait aussi une trahison de la vérité, par anachronisme.
Je le répète : toute époque, toute idéologie écrit l’histoire, au sens où elle produit son récit. Le XIXe siècle a produit ou poursuivi un certain récit (celui du Progrès, de la légitimité de l’impérialisme…) auquel, en grande partie, nous ne croyons plus et dont nous critiquons de nombreux aspects. Le second XXe siècle a produit d’autres récits (lutte manichéenne pendant la Guerre froide, promesse d’émancipation universelle par les Droits de l’Homme…) dont nous sommes encore les héritiers mais qui sont en train de muter (on parle désormais davantage de monde multipolaire, de multiculturalisme, d’imposture des Droits « de l’homme » au singulier et au masculin, de lutte contre toutes les formes de discrimination, etc.). Mais nous ne sortons jamais du récit.
« Faire l’économie de la nuance est le principal danger d’une époque qui tend à réduire toute la complexité et la richesse du monde comme de la pensée à des clichés et des slogans de type commercial, courts, faciles à retenir, y compris en philosophie. »
L’une des leçons épistémologiques que nous devrions tirer de la déconstruction et du relativisme (ou, du moins, du perspectivisme) dont notre époque est friande est donc que nous devrions rester très humbles dans ce que nous affirmons, et rester au plus près des textes que nous lisons, au plus près de leur contexte. Quand je vois aujourd’hui des autrices anglophones du XIXe siècle traduites dans un français qui utilise de l’écriture autoproclamée « inclusive », je tombe des nues : c’est un tel anachronisme qu’on peine à croire que ce soit licite dans un travail académique !
Malgré de louables intentions, l’anachronisme reste, me semble-t-il, une faute grave sur le plan scientifique. J’espère donc ne pas (trop) en commettre moi-même, en tentant de faire la part des choses entre ce que Mill soutenait et ce que j’ai tiré de sa lecture ou ce en quoi il peut nous inspirer aujourd’hui. Et j’espère qu’on n’en commettra pas de nos jours au prétexte de rendre justice à des auteurs passés mais en les « tirant » en réalité vers des combats auxquels ils ne pouvaient être que conceptuellement et moralement étrangers.
Reste que Mill a bel et bien écrit un chapitre intitulé « De l’état [économique] stationnaire » !
Existe-t-il une philosophie de la nature chez John Stuart Mill ?
À vrai dire, pas exactement. Mill a précisément écrit à la fin de sa vie un essai intitulé La nature pour faire part de ses réserves quant à ce concept. Pour le dire simplement, de deux choses l’une : soit la nature englobe tout ce qui jaillit spontanément, ce qui suit son cours propre, et auquel cas elle devient synonyme de « tout », hommes compris ; soit elle désigne ce qui n’est pas humain, ou pas transformé par l’humain, mais la distinction est floue car l’homme transforme son environnement. Le concept pose problème, comme on en prend mieux conscience aujourd’hui (on cherche alors d’autres termes : écosystèmes, vivant…).
« Toute époque, toute idéologie écrit l’histoire, au sens où elle produit son récit. »
Toujours est-il, selon Mill, qu’il est vain de prétendre prendre la nature comme norme, de souhaiter « vivre selon la nature » comme le disaient les auteurs antiques : la nature n’est d’aucun secours à l’être humain dans la recherche des normes qui doivent gouverner son existence. Celui-ci doit toujours endosser la pleine responsabilité de l’établissement de ses normes, qui sont toutes de nature humaine et morale.
Mill semble pourtant avoir un rapport très incarné à la nature.
Oui, mais en tant qu’environnement esthétique surtout, même si cette dimension esthétique a certes, en soi, une vertu « moralisante ». Mill la voit comme une réserve d’altérité et de « sauvagerie », pas comme un miroir de l’âme humaine (comme certains auteurs et artistes romantiques) ni comme un modèle ou une source de normes (comme certains conservateurs).
Pour lui, si le contact avec du non-humain est essentiel, physiquement comme psychiquement, c’est pour ne pas se retrouver dans ce que Baptiste Morizot appelle aujourd’hui le « huis clos anthropique » : la confrontation permanente avec la « civilisation » jusqu’à l’oubli du reste du monde. Le « spectacle de la nature sauvage », selon les mots de Mill, rappelle à l’homme sa finitude, l’invite à l’humilité, au respect du non-soi, en même temps qu’elle exalte en lui le goût du beau ou du sublime désintéressés. C’est pour cela qu’il plaide pour la préservation d’aires naturelles exemptes de toute exploitation humaine.
« Nous devrions rester très humbles dans ce que nous affirmons, et rester au plus près des textes que nous lisons, au plus près de leur contexte. »
À quel titre Mill vous paraît-il donc pouvoir figurer dans une collection dédiée à la « décroissance » ?
Il me semble y avoir sa place en tant qu’il faisait objection à l’impératif naissant de « croissance », qui ne s’appelait pas encore ainsi (on précisait croissance économique ou démographique ou on parlait d’état progressif de l’économie…).
Mill écrit clairement : « J’avoue ne pas être emballé par l’idéal de vie de ceux qui pensent […] que la façon de se piétiner, de se talonner, de s’écraser et de jouer des coudes qui constitue notre vie sociale actuelle est ce que le genre humain peut désirer de mieux […]. Qu’on pardonne à ceux qui n’acceptent pas que ce stade archaïque du développement humain soit son aboutissement ultime d’être relativement indifférents au genre de progrès économique dont se félicite à grands cris le commun des politiciens : le simple accroissement de la production et de l’accumulation. »
« La nature n’est d’aucun secours à l’être humain dans la recherche des normes qui doivent gouverner son existence. »
C’est un pavé dans la mare pour notre temps, rompu à la « société de consommation » et de performance, plus encore que pour le sien, où perduraient encore officiellement de fortes aspirations religieuses, spirituelles et morales ! Rien qu’en formulant ces objections, Mill invite à relativiser l’expansion économique conçue comme fin en soi, et pas seulement ses conséquences néfastes, qui pourraient être considérées comme des dommages collatéraux évitables ou au contraire comme des maux nécessaires. Ce qu’il nous demande est : que cherche-t-on, au fond, à gagner ?
Mill défend l’idée d’une « société stationnaire ». De quoi s’agit-il ?
Je me permets de vous corriger : Mill ne parle pas – du moins dans les passages concernant quelque chose qu’il appelle de ses vœux – de « société stationnaire » mais d’« état stationnaire », et celui-ci ne concerne que l’économie et la démographie, auxquelles il se garde bien d’assimiler tout dynamisme social, comme en témoigne sa distinction entre « état progressif » (de l’économie) et « progrès », et celle qu’il fait de même entre « état stationnaire » et « stagnation ».
Dans le chapitre qui porte ce nom dans ses Principes d’économie politique, il s’attache à réfuter deux idées : la première, que la dynamique de croissance démographique et industrielle de son temps représente à proprement parler une amélioration de la condition humaine ; la seconde, qu’à l’inverse une économie et une démographie en état stationnaire, à condition d’être anticipées et parées de garde-fous cependant, soient nécessairement synonymes de stagnation ou de récession.
Pour lui, la croissance économique (et démographique) n’est souhaitable que pour atteindre un certain seuil de prospérité qu’il définit comme suffisance. Au-delà, c’est seulement d’une meilleure répartition des richesses que l’on a besoin. Toute poursuite purement quantitative de l’extraction, de la transformation et de la consommation de richesses est non seulement une illusion quant à un véritable progrès social mais également un piège moral, tendant à substituer au devoir de se gouverner en tant qu’hommes, collectivement et individuellement, la tentation de n’encourager que la poursuite de désirs illimités.
Mill en cela est très proche des critiques antiques de l’hybris, mais avec des arguments propres à la civilisation industrielle et consumériste naissante.
« Le « spectacle de la nature sauvage », selon les mots de Mill, rappelle à l’homme sa finitude, l’invite à l’humilité, au respect du non-soi, en même temps qu’elle exalte en lui le goût du beau ou du sublime désintéressés. »
Pour terminer, la question décalée : Mill soutiendrait-il le nucléaire ?
Si un certain anachronisme est inévitable lorsque l’on puise chez les auteurs du passé des inspirations pour la période présente, il me semble toujours dangereux de tenter de les « faire s’exprimer » sur des réalités qu’ils ne pouvaient absolument pas imaginer, comme je l’affirmais plus tôt. La maîtrise du nucléaire telle que nous la connaissons fait partie de ces choses inconcevables, au sens propre, pour quelqu’un du XIXe siècle.
Il me semble néanmoins que, si on extrapole ce qu’il dit de techniques ou de situations peu ou prou comparables – même si aucune ne l’est véritablement ! –, on peut imaginer qu’il ferait certainement preuve de la plus grande prudence. Mill n’est pas « technophobe », comme on dit de nos jours : il a pu, jusqu’à la fin de sa vie, promouvoir le « progrès des arts industriels », y compris dans une configuration stationnaire de l’économie globale. Cependant il n’a cessé de mettre en garde contre les effets d’écran de la puissance de production ou du confort.
Or, il me semble que ce qu’apporte le nucléaire civil, à savoir la promesse d’une énergie se prétendant « propre » et « bon marché » quasiment illimitée dans ses rendements (nonobstant l’approvisionnement de ses matières premières et ses forts besoins en eau, en maintenance et en sécurité, ce qui veut dire une forme de militarisation et/ou un pari sur la paix et la sécurité mondiales), aurait dans tous les cas été jugé par Mill comme un possible leurre. Car, pour lui, la liberté et la dignité humaines ne résident pas dans le confort et l’énergie disponibles mais dans ce qu’un trop-plein de confort justement menace : l’aguerrissement des facultés individuelles et la concorde collective, dans une tension continuée vers la sauvegarde des conditions d’une démocratie éclairée.
« Toute poursuite purement quantitative de l’extraction, de la transformation et de la consommation de richesses est non seulement une illusion quant à un véritable progrès social mais également un piège moral. »
Quant au nucléaire militaire, qui ne peut être éludé de la question, il aurait sans aucun doute traumatisé ce philosophe comme il a traumatisé au siècle suivant tous les témoins de Hiroshima et Nagasaki (et ce, sans encore parler des essais nucléaires et des populations et corps d’armée sacrifiés dans le processus).
Tout ce que je puis dire, dans la lignée de ce que nous disions plus tôt de l’hybris, c’est qu’il est difficile de reconnaître les idéaux et les espoirs que Mill formait pour l’humanité dans les plus grandes « réalisations » de celle-ci aux XXe et XXIe siècles.
Nos Desserts :
- Se procurer l’ouvrage de Camille Dejardin chez votre libraire
- Sur Le Comptoir, lire la 1ère partie de l’entretien avec Camille Dejardin
- Lire également une relecture écologique de Nietzsche
- Une relecture écologique de Kant
- Et la lecture de Paul Guillibert vers un “communisme décroissant”
Catégories :Politique