Entretien avec les auteurs d’À la fin du monde il fera beau. Essai sur l’inaction climatique.
Gabriel Perez est professeur de philosophie, psychologue du travail et syndicaliste. Florian Massip est chercheur à l’École des Mines en bio-informatique, discipline avec laquelle il étudie les processus d’évolution des espèces. En croisant leurs disciplines, tous deux s’interrogent sur les causes de l’inaction climatique et répondent ici à nos questions.
Le Comptoir : Qu’est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ?
Nous avons pu constater dans nos engagements respectifs – militants, syndicaux ou universitaires – une incapacité collective à se saisir véritablement des dérèglements climatiques. Dans certains milieux intellectuels que nous fréquentons, la question n’est presque jamais évoquée. Comme si cela relevait d’une réalité impossible à penser ; comme si le passage du constat commun à la mobilisation générale était frappé d’impuissance. C’est donc l’énigme initiale du livre : pourquoi ne se passe-t-il rien, ou si peu, au regard des catastrophes annoncées ?
Qu’est-ce qui vous a motivé à l’écrire à quatre mains ?
Le dialogue entre un philosophe-psychologue du travail et un biologiste permet d’articuler des champs de réflexion qui, de façon générale, sont tenus à distance, à savoir : le rôle historique de l’organisation du travail, le pouvoir des imaginaires politiques et la compréhension du vivant dans la survie et le devenir de l’humanité.
La mise en relation de ces champs éclaire le pouvoir qu’exerce le néolibéralisme sur notre destin collectif, mais aussi un chemin pour amorcer les transformations historiques qui s’imposent.
On découvre alors un lien très fort entre la gouvernance par les nombres, qui prétend mesurer la performance d’un travailleur à l’aune d’indicateurs chiffrés, et la volonté de mathématisation du vivant, pour le réduire à un statut d’artefact remplaçable.
« Pourquoi ne se passe-t-il rien, ou si peu, au regard des catastrophes annoncées ? »
Un petit mot sur le titre de votre ouvrage ?
Le titre comporte une promesse ironique de bonheur, comme une dénonciation des fausses promesses des néolibéraux qui nous entraînent vers la fin du monde, lancés à pleine vitesse dans leurs SUV. Il met ainsi en exergue l’ambivalence de nos sociétés : conscientes d’aller vers la catastrophe, elles gardent paradoxalement une apparente sérénité. Mais le titre reste volontairement ambigu. Ainsi, il traduit aussi notre volonté de nous accrocher, malgré tout, à un petit espoir.
Dans la première partie de votre ouvrage, vous partez d’une réflexion sur le travail, ce qui est rarement abordé au prisme des enjeux écologiques. En quoi y voyez-vous un enjeu crucial ?
Il y a un impensé politique majeur autour du travail et de son organisation. Rares sont les écologistes qui s’adressent directement aux travailleurs comme des acteurs essentiels des transformations nécessaires. Ils préfèrent s’adresser aux militants, ou aux représentants politiques. Par ailleurs, ils ne perçoivent pas toujours comment les enjeux d’organisation du travail s’articulent à ceux de nos fonctionnements démocratiques. Or, si les écologistes ne pensent pas ces articulations, les néolibéraux le font. C’est pour cela qu’ils parviennent, à l’échelle de la division mondiale du travail, à mobiliser des masses gigantesques de travailleurs pour produire selon des modalités qui condamnent une part de l’humanité.
Face à ces enjeux, comment peut-on reprendre prise sur le travail ?
La reprise de notre destin démocratique passe précisément par une redéfinition des pouvoirs des travailleurs sur l’organisation du travail. Aujourd’hui, de très nombreux travailleurs accomplissent des tâches qu’ils réprouvent moralement : c’est la « souffrance éthique », dont parle Christophe Dejours.
« Le titre du livre comporte une promesse ironique de bonheur, comme une dénonciation des fausses promesses des néolibéraux qui nous entraînent vers la fin du monde, lancés à pleine vitesse dans leurs SUV. »
Ils « collaborent », avec toutes les connotations historiques du terme, au travail de destruction du vivant. Face à cette souffrance, l’individu s’arrête de penser, car cela devient une activité trop coûteuse.
Comment alors réintroduire l’éthique et les enjeux écologiques au sein des entreprises ? Parmi les propositions concrètes que nous avançons, nous défendons la généralisation d’une « clause de conscience » et de « motions de défiance » à toutes les organisations, de sorte que les travailleurs puissent rendre publiques et discutables les stratégies opérées par leurs directions.
Vous y décryptez les notions de « résilience » et d’« adaptation ». En quoi vous semblent-elles des pièges ?
Nous avons identifié un « tandem conceptuel » composé de « l’adaptation » et de la « résilience ». L’adaptation est un concept dont les ramifications remontent aux darwinistes sociaux et aux penseurs néolibéraux. Pour eux, il serait « naturel » que les sociétés et les individus soient contraints de « s’adapter » à un environnement changeant et concurrentiel. Dans ce cas, adaptation signifie à la fois sélection des plus adaptés et élimination des inadaptés. Quant au concept de résilience, que l’on retrouve dans la loi Climat et Résilience, il ne sert plus à désigner la manière dont un individu peut surmonter un traumatisme (Cyrulnik). Il est devenu un concept anticipatoire, qui annonce les traumatismes à venir et participe à leur acceptation. Il s’agit donc, à travers ces concepts, de légitimer l’ordre du monde.
« Rares sont les écologistes qui s’adressent directement aux travailleurs comme des acteurs essentiels des transformations nécessaires. »
Après la thématique du travail, vous abordez la question de l’imaginaire politique. Pour vous, Hollywood participe d’une forme de confusionnisme au service de l’agenda néo-libéral.
Dans cet essai, nous essayons de montrer que l’imaginaire n’est pas l’opposé du réel, mais une façon de mettre au travail les dynamiques d’une culture. Les grandes productions hollywoodiennes interrogent les manières de gouverner un monde transfiguré par les dérèglements climatiques. Seulement, les déplacements qu’ils opèrent dans leurs réflexions n’ont pas lieu sur le plan du concept, mais sur le plan de l’image, échappant ainsi à l’examen rationnel. Or, de Seul sur Mars à Avatar, Hollywood ne se contente pas de réécrire Robinson Crusoé ou Pocahontas. Il recycle les grands mythes de la culture états-unienne pour les conformer aux enjeux de gouvernance du néolibéralisme.
A contrario, quelles œuvres (cinéma, romans, jeux vidéos…) vous paraissent permettre de penser ces questions écologiques ?
La tâche de l’imaginaire politique, c’est d’arriver à imaginer ce qui ne peut être pensé. L’imaginaire, en vérité, précède le réel. Si les néolibéraux investissent Hollywood, c’est bien parce qu’ils rencontrent des difficultés pratiques pour envisager à quoi pourrait ressembler une société organisée autour du travail et de la productivité dans un environnement naturel délabré. Y a-t-il un imaginaire mondial comparable à Hollywood capable de penser autrement que les néolibéraux et d’articuler le sens du travail, le destin de la culture et notre avenir démocratique simultanément ? Pour l’instant, il existe des œuvres locales et contextuelles, qui racontent les expérimentations écologiques, l’invention des éco-lieux, etc. Mais elles ne parviennent pas à structurer la conscience collective. Hollywood, pour l’instant, n’a pas d’équivalent. Tout comme il n’existe pas de philosophie politique et de pratique de gouvernement aussi puissante que le néolibéralisme.
« Il s’agit à travers les concepts d’adaptation et de résilience de légitimer l’ordre du monde. »
En quoi l’utopie vous semble être un outil intéressant pour sortir de l’inaction climatique ?
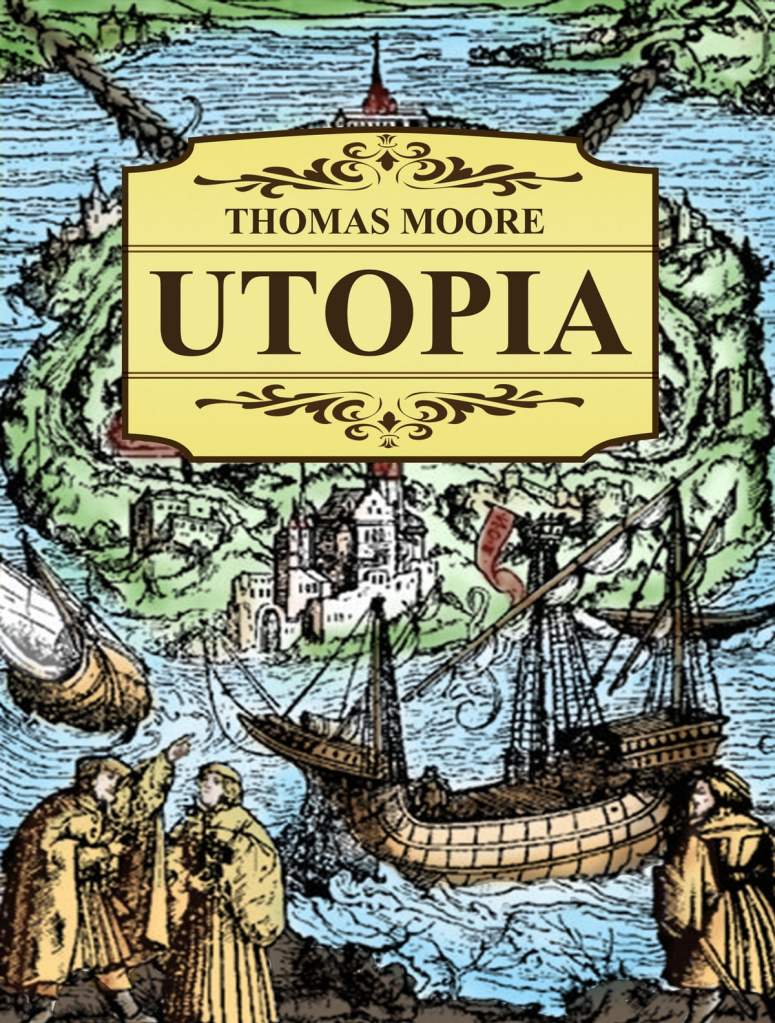 Il y a un contresens historique concernant l’utopie : ni Platon, ni Thomas More, ni Cyrano de Bergerac ou Campanella n’ont envisagé leurs utopies comme des cités idéales. Au contraire, l’utopie a représenté un exercice de philosophie tendant à mettre en évidence les limites du politique. Au XIXe siècle, cependant, les penseurs socialistes – Owen, Saint-Simon, Fourier, Godin – réinvestissent l’utopie non plus seulement sur le plan de la philosophie politique, mais de façon concrète, à travers des expérimentations sociales.
Il y a un contresens historique concernant l’utopie : ni Platon, ni Thomas More, ni Cyrano de Bergerac ou Campanella n’ont envisagé leurs utopies comme des cités idéales. Au contraire, l’utopie a représenté un exercice de philosophie tendant à mettre en évidence les limites du politique. Au XIXe siècle, cependant, les penseurs socialistes – Owen, Saint-Simon, Fourier, Godin – réinvestissent l’utopie non plus seulement sur le plan de la philosophie politique, mais de façon concrète, à travers des expérimentations sociales.
Dès lors, les limites éprouvées par ces utopies ne sont plus seulement conceptuelles : elles deviennent matérielles, organisationnelles, psychiques, etc. En cela, elles constituent un réservoir expérimental indispensable pour nourrir la pensée politique : qu’est-ce qui, dans chaque utopie, a fonctionné ou échoué ? Quelles leçons peut-on tirer de ces expérimentations ? Quels compromis faut-il construire ? En définitive, peut-on bâtir un monde meilleur que celui que nous proposent les néolibéraux ? Si oui, comment ?
Après avoir identifié deux causes de l’inaction climatique (« l’effondrement de la démocratie du travail » et « l’absence d’imaginaire politique »), vous proposez, dans la troisième partie de votre ouvrage, une voie possible pour reprendre prise sur notre destin collectif : le « vivant au secours de l’imaginaire ». De quoi s’agit-il fondamentalement ?
L’objectif de cette partie est double : tout d’abord, démontrer que l’imaginaire néolibéral, bien qu’il se pare souvent des habits de la science, détourne en fait les concepts scientifiques pour nourrir une vision idéologique du monde. Ce faisant, les néolibéraux proposent un imaginaire qui nous paraît très pauvre, un monde aseptisé et d’enfermement.
Au contraire, le vivant est le lieu d’une richesse et d’une diversité sans cesse renouvelée et fascinante. C’est aussi un monde d’échange et de coopération. Sans tomber dans une vision idéaliste, il nous a semblé que le monde vivant pouvait être une source d’inspiration pour refonder un imaginaire. En particulier, parce que le monde vivant intègre ses limites : une espèce, ou un écosystème qui consomme ses ressources plus vite qu’elles ne se reconstituent est voué à la disparition. Or, malgré ces limites, le vivant est capable d’une formidable capacité d’innovation.
« L’utopie a représenté un exercice de philosophie tendant à mettre en évidence les limites du politique. »
Quelles formes ce recours au vivant pourrait-il prendre ?
Dans un premier temps, on pourrait déjà souhaiter que cesse la référence constante au darwinisme et à la « survie du plus apte » pour justifier l’exploitation et l’individualisme.
Nous avons voulu proposer une ébauche de réponse à cette question, à travers le concept d’« isopolitique », une pensée des équilibres suggérant de développer une politique qui entérine enfin que le destin de l’homme est indubitablement lié à celui du reste du monde vivant. Il est alors nécessaire d’imaginer des formes d’expression pour le vivant, pour que celui-ci puisse être pris en compte et influer sur les politiques publiques. On pourrait par exemple inventer un parlement des vivants, permettant une participation du vivant à la vie démocratique, à travers une représentation par des ambassadeurs élus ou désignés.
« Les néolibéraux proposent un imaginaire qui nous paraît très pauvre, un monde aseptisé et d’enfermement. »
Vous avez à plusieurs reprises des critiques sévères à l’égard des partis et des syndicats.
Les partis, comme les confédérations syndicales, ont longtemps représenté des forces historiques à l’origine de grandes transformations sociales. Cependant, elles ne sont plus en capacité de produire de l’analyse et de concilier militantisme et réflexion politique. Depuis près de deux décennies, elles sous-traitent ce travail à des think tanks. Cette division des tâches les empêche désormais de mener le travail nécessaire de redéfinition de leur rôle et d’affronter les contradictions qui les rendent inaudibles : si le syndicalisme a pour vocation la défense corporatiste des travailleurs, est-il en mesure de soutenir des mesures de décroissance ? Si les partis ont pour principal objectif la conquête du pouvoir, sont-ils prêts pour autant à engager les rapports de force avec les grands fleurons de l’industrie et des énergies ?
Patrick Pouyanné, PDG de Total, pèse sans conteste davantage dans l’avenir de l’humanité que n’importe quelle figure politique. Il y a là souvent un impensé. Pour avoir fréquenté partis et syndicats, on ne peut pas dire que les questions écologiques y soient vraiment prises au sérieux. Quand on met en balance les conséquences des dérèglements climatiques et les discours des partis politiques et leurs propositions, on ne peut que constater un gouffre abyssal.
En regard, des organisations comme Extinction Rebellion ou les Soulèvements de la Terre vous paraissent-elles porteuses d’espoir ?
Si nous nous réjouissons de voir des formes de mobilisation recréer du collectif, nous ne pouvons là encore que pointer les impasses de ces modes d’engagement. Au fond, l’activisme est toujours partagé entre deux objectifs : un objectif de lutte et de confrontation aux pouvoirs dominants ; un objectif d’amplification de visibilité d’une lutte par des formes de mobilisation spectaculaires ou radicales. Mais paradoxalement, s’il peut atteindre ces deux objectifs, il ne parvient jamais à agréger à ses combats les forces institutionnelles – syndicats et partis en premier lieu – qui pourraient conduire à une prise du pouvoir, condition sine qua non d’une véritable transformation sociale et économique.

Lors d’une mobilisation organisée par Les Soulèvements de la Terre contre Monsento-Bayer, le 5 mars 2022, à Trèbes. © Idriss Bigou-Gilles/HansLucas via AFP
Vous consacrez de longs développements à la figure du « boomer » : qui est ce « boomer » pour vous ?
Nous donnons une définition du boomer qui n’est pas uniquement générationnelle. Certes, le boomer correspond à l’individu tel qu’il a été façonné par les décennies d’après-guerre qui ont fait advenir une société du travail, de la productivité, des loisirs et de la consommation. Mais le boomer, de nos jours, est celui qui veut prolonger ce modèle de civilisation, quand bien même il conduit aux désastres écologiques. Il croit aux mythes technicistes qui promettent des solutions aux catastrophes à venir. Il est convaincu, quoi qu’il arrive, qu’il n’existe pas de meilleur monde possible. Ainsi le boomer n’a pas d’âge. On le retrouve dans toutes les générations.
Comment intégrez-vous la question sociale à votre réflexion d’ensemble ?
À travers la question de l’adaptation et la désignation des « inadaptés », l’essai dessine les enjeux d’une réflexion sociale renouvelée par les enjeux climatiques. La question qui se pose, c’est de savoir si la raréfaction des ressources qui résultera des dérèglements climatiques fera l’objet d’une captation de ces dernières par les plus riches. Une révolte contre l’ordre néolibéral est aussi probable. La question est alors ouverte : prendra-t-elle la forme d’insurrections sporadiques ou d’une grande révolution ? Ou assisterons-nous au retour des idéologies de masse ?
Vous-même mentionnez de multiples enjeux (« limites planétaires », extinctions massives d’espèces…). Comment articuler l’ensemble ?
Résumer les questions environnementales à la question climatique est une erreur malheureusement très fréquente. Le GIEC a mis très longtemps avant de s’intéresser aux questions liées à la chute de la biodiversité par exemple. Or certaines des solutions imaginées pour répondre aux dérèglements climatiques – comme le tout électrique par exemple – nécessitent une grande consommation de ressource, ce qui implique la destruction d’espaces naturels et la pollution des sols. La seule manière d’articuler l’ensemble est de repenser notre modèle de société, d’imaginer de nouvelles utopies tournées vers la sobriété et le respect des équilibres naturels.
« Le boomer est celui qui veut prolonger ce modèle de civilisation, quand bien même il conduit aux désastres écologiques. »
En tant que chercheur, que répondez-vous aux militants écologistes qui estiment que la science n’est pas une partie de la solution, mais qu’elle est une partie du problème ?
La science telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui par certains, dans sa version « industrielle », est en effet une partie du problème. Elle nourrit d’ailleurs une forme de scientisme et une illusion de toute puissance, qui veulent faire croire que la situation est sous contrôle, alors même que nous naviguons vers l’inconnu. On peut également regretter que l’impact environnemental des pratiques scientifiques ne soit que rarement discuté dans les laboratoires.

Un figuier des banian (ficus benghalensis). En dépit de sa taille imposante (jusqu’à 100m de diamètre), sa survie dépend d’une petite guêpe, le blastophage, sans qui la reproduction de ce ficus est impossible
Cela étant, la science a tout de même un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre la crise environnementale : pour comprendre et essayer de prévoir les changements en cours, ou pour inventer des solutions. Et vouloir la mettre sous tutelle, comme on l’entend parfois chez certains militants écologistes, c’est méconnaître le fonctionnement de la science, et faire la même erreur que les néolibéraux.
« La seule manière d’articuler l’ensemble est de repenser notre modèle de société, d’imaginer de nouvelles utopies tournées vers la sobriété et le respect des équilibres naturels. »
Comment serait-il possible concrètement de faire en sorte que la science soit au service du bien commun ?
Pour parler du système français, et sans tomber dans une vision idéalisée du passé, il est évident que les réformes récentes ont fait beaucoup de mal : l’alignement sur le système anglo-saxon, la précarisation généralisée des jeunes scientifiques, et la volonté de mesurer la performance à l’aide d’indicateurs chiffrés (nombre de publication, taux de citation…), qui détermine l’attribution des financements ont entraîné une mise au pas de la profession. Il est devenu très difficile de trouver des espaces de pensée libre et d’élaboration face à la pression de la bureaucratisation. Redonner à la science et aux scientifiques les moyens de leur indépendance semble être une première étape indispensable.
Nos Desserts :
- Se procurer l’ouvrage de Perez et Massip chez votre libraire
- Voir aussi Les derniers maîtres. Paroles vivantes de philosophes de Gabriel Perez
- Pour Benoît Berthelier « Nietzsche peut éclairer de manière salutaire la question écologique »
- Sur Le Comptoir, lire notre article « L’archipel des fictions utopiques »
- « Défense et illustration des communs » sur En attendant Nadeau
Catégories :Politique



