Il y a quinze ans Blanche-Neige tentait de rentrer chez elle, mais elle se fit refouler par les personnes justement en charge de surveiller son domicile. Qu’est–elle devenue depuis ? A-t-elle enfin pu regagner son domicile ?
« Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances ». Je n’ai jamais compris vraiment ce que voulait dire Proust avec cette phrase. Alors plutôt que d’espérer une fulgurance qui pourrait ne jamais arriver, j’ai choisi moi-même le sens que je souhaitais lui donner. C’est l’histoire de Blanche-Neige qui voulait rentrer chez elle, et se vit refouler pour cause d’abus d’identité d’un personnage imaginaire. Chez moi « les faits » dont parlent Proust c’est Blanche-Neige qui veut rentrer chez elle, et « le monde où vivent nos croyances » c’est là où habite Blanche-Neige. Il se trouve effectivement que Blanche-Neige n’a pas pu rentrer chez elle, terrible mésaventure survenue il y a quinze ans déjà.
Comment l’histoire s’est telle terminée ? J’en sais rien. Je sais c’est décevant. Mais j’ai quelques informations qui me laissent à penser que Blanche-Neige a finalement dû changer d’identité. De toute façon, à quoi bon. Les complications administratives seraient devenues insupportables à gérer. Blanche-Neige choisit alors le pragmatisme, puisqu’il était évidemment illusoire d’attendre un coup de main des sept nains. Désormais, elle s’appelle Pilvi Takala, se dit née en Finlande, et se présente comme artiste.
Hérodote plutôt que Thucydide
À vrai dire je ne me souviens plus très bien du déroulé exact des évènements. Peut être inverse–je quelque peu la chronologie des faits. Peut–être même que Pilvi Takala existait déjà, et c’est elle qui choisit plus tard d’être Blanche-Neige. Je ne sais plus. Mais on s’en moque. Il fut un temps où l’on racontait bien des choses sans frise chronologique. Bernard Williams philosophe anglais « qui s’ennuyait à mourir » (The Makropulos case), interroge cette évidence contemporaine qui nous fait raconter les choses telles qu’elles se sont produites au cours du temps, alors qu’elles pourraient très bien être racontées autrement. D’ailleurs, il fut un temps où l’ordre des faits rapportés importait peu. La bascule se fit avec Thucydide, premier véritable historien comme le rappelle Ian Hacking (philosophe canadien), qu’il oppose à Hérodote.
« Hérodote nous a laissé des souvenirs d’évènements divers qui se sont produits dans différentes parties du monde antique dont l’ordre chronologique n’est pas clair… L’œuvre de Thucydide est une chronique dans laquelle chaque incident a lieu avant, après, ou en même temps que chaque autre événement qu’il décrit. Une chronologie raisonnée, pour ainsi dire, et qui implique que les événements antérieurs sont en quelque façon les causes des évènements postérieurs. »
Bref, tout ça pour dire que je me sens davantage Hérodote que Thucydide dans cette affaire de Blanche-Neige. Aucune importance, de toute façon mon hésitation à convoquer l’ordre des faits n’est pas dommageable au témoignage que je rends de « ma » Blanche-Neige. Cette dernière s’est vue refoulée à l’entrée de son domicile, et c’est cela seulement qui motive ma moue. Pourtant des enfants l’avaient bien reconnue, eux dont le jugement vierge de toute nuisance rationnelle les rend particulièrement réceptifs à la présence de Blanche-Neige. Une expérience traumatisante pour ces enfants qui voient alors leur Blanche-Neige refoulée par des grands bonhommes pas très sympathiques. Une expérience non moins traumatisante pour cette Blanche-Neige que l’on accuse d’avoir exactement les mêmes traits qu’un personnage imaginaire, et de surcroit qui habite exactement au même endroit.
Tarski, Magritte, et Tony Montana
Évidemment, cette situation ubuesque ne pouvait produire qu’une discussion absurde entre Blanche-Neige et les gardiens du parc. Discussion que l’on résumera en deux postures qui d’un certain point de vue ne manquent pas de finesse :
– Posture de Blanche-Neige : elle use d’une définition de la vérité proposée par le logicien philosophe de la vérité Alfred Tarski : « Je suis Blanche-Neige si et seulement si je suis blanche neige… » Imparable. Dans le texte de Tarski c’est plus exactement « la neige est blanche si et seulement si la neige est blanche ». Si les gardiens du parc avaient lu Tarski, ils n’auraient pas pu rester insensibles à l’argument. Malheureusement, les gardiens avaient d’autres lectures. Aussi défendables ma foi. Le surréalisme.
– Posture du gardien : il use d’une définition de la vérité proposée par le surréalisme, « Blanche-Neige n’est pas Blanche-Neige… ». Avec un peu d’imagination on aura reconnu Magritte et sa pipe : « ceci n’est pas une pipe. » Ceci n’est pas Blanche-Neige et pourtant on voit Blanche-Neige. Oui mais c’est pas parce que vous nous montrez quelque chose qui veut dire « Blanche-Neige », que c’est Blanche-Neige que l’on voit… Pas simple. Mais on voit l’idée.
Sauf que globalement, on avance pas d’un pouce. Concrètement, on se retrouve dans un problème de niveau CP pour les logiciens initiés : le paradoxe du Menteur (Euboulide, siècle −4)1 : « quand je dis je mens, c’est vrai ? » Si c’ est vraie, alors elle c’est faux; et si c’est faux alors c’est vrai. On tourne en boucle, comme un algo qui trouve pas la solution. Encore un problème de têtes de bits.
Blanche-Neige aurait peut être dû être un chouilla plus agressive, et s’habiller en Tony Montana (Al Pacino dans Scarface) : « Je dis toujours la vérité. Même quand je mens c’est vrai. » Alors peut–être, les gardiens auraient été sonnés. Inaptes à la réplique, ils auraient abdiqué, laissant Blanche-Neige rentrer chez elle. Mais au lieu de cela, Blanche-Neige fut invitée à rentrer chez elle, alors qu’elle souhaitait justement rentrer chez elle.
Le parc impossible
Blanche-Neige n’aurait jamais dû habiter là. C’est de là que vient tout le problème. Quand on habite un parc à rêves, on prend le risque de perdre le droit de rêver. Comme si on pouvait regarder, mais pas toucher. Pas un parc virtuel, mais un parc bien réel, trop réel. Tellement réel qu’on est soi–même en manque de réel pour y habiter. Baudrillard avait dit quelque chose comme cela dans son Simulacres et simulation, avec son idée d’hyper-réalité.
Pourtant, ce parc à rêves existe bel et bien, mais il est peuplé de mondes imaginaires. On se retrouve dans la peau de cet ensemble mathématique qui ne peut pas exister : « l’ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux mêmes », terrible paradoxe qui fit trembler l’édifice mathématique, et qui raconte pourtant simplement l’histoire du barbier qui proposer de raser tous les hommes qui ne se rasaient pas eux-mêmes.
Nos Desserts :
- Au Comptoir, lire notre article « La réalité est morte, vive l’hyperréalité ! »
- Lire également notre facétie « J’ai une tête de bit »
-
Lire Simulacres et simulation de Jean Baudrillard
- Lire « Philosophie et histoire des concepts scientifiques » de Ian Hacking
Catégories :Culture

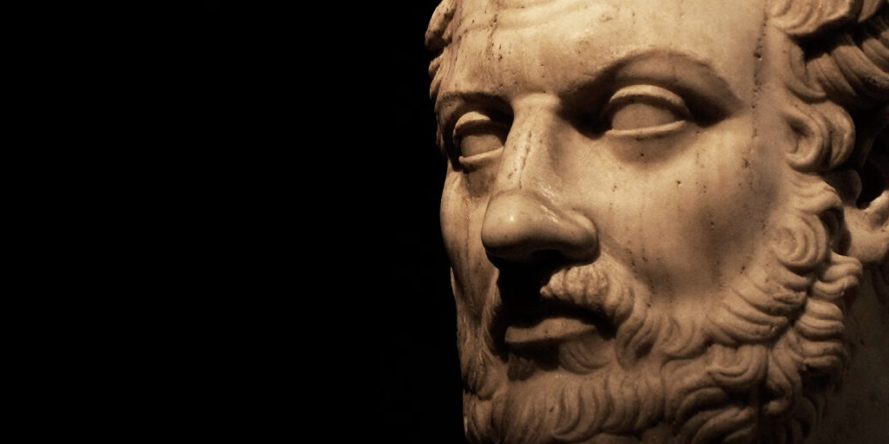

« ….n’a pas pu rentré…. ». Snif.
« …a finalement dû changé … ». Re-snif.
Il y a des fondamentaux grammaticaux qui semblent malheureusement vous échapper.
Je suis désolé de ne pouvoir aller au-delà.