Parmi les singularités qui caractérisent Romain Gary, celle d’avoir été précurseur de la question écologique, et plus précisément de la protection de la faune occupe une bonne place. Point d’orgue de cette prémonition salvatrice ? L’un de ses romans les plus aboutis, « Les Racines du ciel », paru en 1956, et qui obtient un prix Goncourt la même année. À l’intérieur de celui-ci, une place centrale est donnée aux éléphants que défend la valeureux Morel avec une passion grandiose. Ils sont l’objet de descriptions magnifiques, bien entendu, mais aussi l’occasion de réflexions sur la vie des hommes, parfois acerbes, tranchantes, mais également touchantes…
Au hasard, on citera par exemple celle-ci : « Il n’est pas possible de surprendre les grands troupeaux en train de courir à travers les vastes espaces de l’Afrique sans faire aussitôt le serment de tout tenter pour perpétuer la présence parmi nous de cette splendeur naturelle dont la vue fera toujours sourire d’allégresse tout homme digne de ce nom… » Ou encore celle-là: « Les gens se sentent tellement seuls et abandonnés, qu’ils ont besoin de quelque chose de costaud, qui puisse vraiment tenir le coup. Les chiens, c’est dépassé, les hommes ont besoin des éléphants ».
Dans cet article, nous voudrions en dire un peu plus à ce sujet hypnotique, car tel est bien le qualificatif qui vient en tête lorsque l’on repense aux lignes consacrées aux pachydermes. Au-delà de la préservation des éléphants, se jouent des questions fondamentales qu’ils permettent d’incarner parfaitement grâce à leur présence massive. Celle de la marche du monde, par exemple, puisque « ce que le progrès demande inexorablement aux hommes et aux continents, c’est de renoncer à leur étrangeté, c’est de rompre avec le mystère – et sur cette voie s’inscrivent les ossements du dernier éléphant… ».
Il faut le dire très clairement, l’existence des éléphants est pour Morel (à travers lequel on sent fortement transparaitre Romain Gary) et ses compagnons, l’occasion de dresser un portrait peu reluisant d’une humanité qui vient tout juste de sortir de la Seconde Guerre Mondiale et qui, de plus en plus, parait oublier l’importance de la beauté, de l’émerveillement : «Vous avez déjà vu un éléphanteau couché sur le flanc, la trompe inerte, et vous regardant avec des yeux où semblent s’être réfugiées toutes les qualités humaines tant vantée et dont l’humanité est si abondamment dépourvue ? » demande par exemple Haas, un Néerlandais spécialiste de la capture des éléphanteaux bientôt prit de remords et qui ralliera la lutte pour leur protection. Parmi les cibles de l’écrivain, on trouve en très bonne position la « belle congrégation d’impuissants, d’alcooliques et de femelles dont la sexualité s’éveille généralement pour la première fois dans les courses de taureaux, et atteint l’instant suprême, le doigt sur la gâchette et l’œil fixé sur la corne du rhinocéros ou les défenses d’un beau mâle – avec un chasseur professionnel derrière – on est prudent malgré tout » , mais aussi les chasseurs, et autres marchands d’ivoire.
Ces prises de positions et questionnements philosophiques en faveur de la protection de la faune africaine prennent d’autant plus de valeur que le roman ne fait pas non plus l’économie de problématiques bien plus concrètes et matérielles. Ainsi, le combat mené pour la préservation des pachydermes s’accompagne d’un rappel régulier des besoins primaires de l’homme qui demandent à être comblés avant de pouvoir admirer les bâtes majestueuses : « Pour l’homme blanc, l’éléphant avait été pendant longtemps uniquement de l’ivoire et pour l’homme noir, il était uniquement de la viande, la plus abondante quantité de viande qu’un coup heureux de sagaie empoisonnée pût lui procurer. L’idée de la “beauté” de l’éléphant, de la “noblesse” de l’éléphant, c’était une notion d’homme rassasié, de l’homme des restaurants, des deux repas par jour et des musées d’art abstrait – une vue de l’esprit élitiste qui se réfugie, devant les réalités sociales hideuses auxquelles elle est incapable de faire face, dans les nuages élevés de la beauté, et s’enivre des notions crépusculaires et vagues du “ beau ”, du “noble ”, du “ fraternel ”, simplement parce que l’attitude purement poétique est la seule que l’histoire lui permette d’adopter. Les intellectuels bourgeois exigeaient de leur société décadente qu’elle s’encombrât des éléphants, pour la seule raison qu’ils espéraient ainsi échapper eux-mêmes à la destruction ».
Voilà d’ailleurs l’une des forces du roman ; faire valoir le point de vue des nombreux personnages qui le parsèment, pour pousser le lecteur à s’interroger, quitte à ce qu’il s’y perde un peu, quitte à écorner sérieusement l’image du personnage principal dont l’un des protagonistes explique qu’il rentrerait parfaitement dans cette catégorie de bourgeois décadents… Les différents comparses eux-mêmes hésitent dans la marche à suivre, mais tous sont saisis par la force de Morel qui semble justement pouvoir s’élever au-delà des besoins du corps, dans une sorte de mysticisme qui trouve son catalyseur chez les éléphants. Ainsi, à ce précédent constat désabusé et implacable dressé par Waïtari, ancien député des Oulés, répond cette observation du père Tassin, un prêtre jésuite et paléontologue : « Il croyait vraiment que les gens avaient encore assez de générosité, par les temps que nous vivons, pour s’occuper non seulement d’eux-mêmes, mais encore des éléphants. Qu’il y avait dans leur cœur encore assez de place. C’était à pleurer. Je restais là, muet, à le regarder, à l’admirer, devrais-je plutôt dire, avec son air sombre, obstiné, et sa serviette bourrée de toutes les pétitions, de tous les manifestes que vous pouvez imaginer. Désopilant, si vous voulez, mais aussi désarmant, parce qu’on le sentait tout pénétré de ces belles choses que l’homme s’est racontées sur lui-même dans ses moments d’inspiration ».
« Les chiens, c’est dépassé, les hommes ont besoin des éléphants ».
Un espoir inépuisable
Miroir de l’âme des hommes et de leur dignité, les éléphants sont aussi une source d’espoir inépuisable, un plaisir esthétique immense : « Chaque fois que vous les rencontrez, dans la savane, en train de remuer leurs trompes et leurs grandes oreilles, un sourire irrésistible vous monte aux lèvres. Leur énormité même, leur maladresse, leur gigantisme représentent une masse de liberté qui vous fait rêver ». Et le simple fait qu’ils existent suffit à créer des foyers de résistance inextinguibles chez ceux y songent, ainsi qu’en atteste l’expérience de Robert, ancien codétenu concentrationnaire de Morel. En effet, enfermé et mis à l’isolement par les Allemands, il reviendra de tortures abominables (privation de nourriture, arrachement des ongles, nez cassé, etc.) avec une vigueur morale intacte. Devant le regard interloqué de ses camarades qui sont surpris d’une telle résistance, il leur déclare : « Quand vous n’en pouvez plus, faites comme moi : pensez à des troupeaux d’éléphants en liberté en train de courir vers l’Afrique, des centaines et des centaines de bêtes magnifiques auxquelles rien ne résiste, pas même un mur, pas même un barbelé, qui foncent à travers les espaces ouverts et qui cassent tout sur leur passage, qui renversent tout et tant qu’ils sont vivants, rien ne peut les arrêter- la liberté quoi ! ». C’est le même Robert qui, néanmoins, sera plus tard attaché à un acacia par Morel et ses comparses, tandis que le feu a été mis à sa propriété à cause du massacre d’éléphants qui détruisaient ses récoltes… Contradictions et complexités des personnages des Racines du Ciel, là encore, qui donnent toute la richesse de cette œuvre remarquable, avec un échange inoubliable entre les deux anciens codétenus.
Cet espoir qui nait des éléphants, et qui se propage grâce à ceux qui sont suffisamment fous pour le faire vivre entre en contradiction avec la modernité naissante, c’est toutefois dans ces animaux que s’incarne peut-être plus que dans tout autre bête la possibilité de résister au « rationalisme absolu », comme l’écrira Gary, dans sa « Lettre à l’éléphant », parue en 1968 dans le Figaro Littéraire : « C’est ainsi, monsieur et cher éléphant, que nous nous trouvons, vous et moi, sur le même bateau, poussé vers l’oubli par le même vent puissant du rationalisme absolu. Dans une société, vraiment matérialiste et réaliste, poètes, écrivains, artistes, rêveurs et éléphants ne sont plus que des gêneurs ». À l’image de celle du poète, la présence de l’éléphant est devenue anachronique. À nous de protéger ces deux étranges spécimens, et avec eux, ce qu’ils englobent de précieux pour apprécier la vie.
Orel Petitemouche
Nos Desserts :
- Au Comptoir, lire notre article « Chien Blanc, ou le syndrome de la culpabilité »
-
Deux séries d’émissions sur France Culture : « Romain Gary, l’obstiné » et « Romain Gary, l’écrivain aux multiples vies »
- « En armes » sur Diacritik à propos de Le Sens de ma vie de Romain Gary
Catégories :Culture

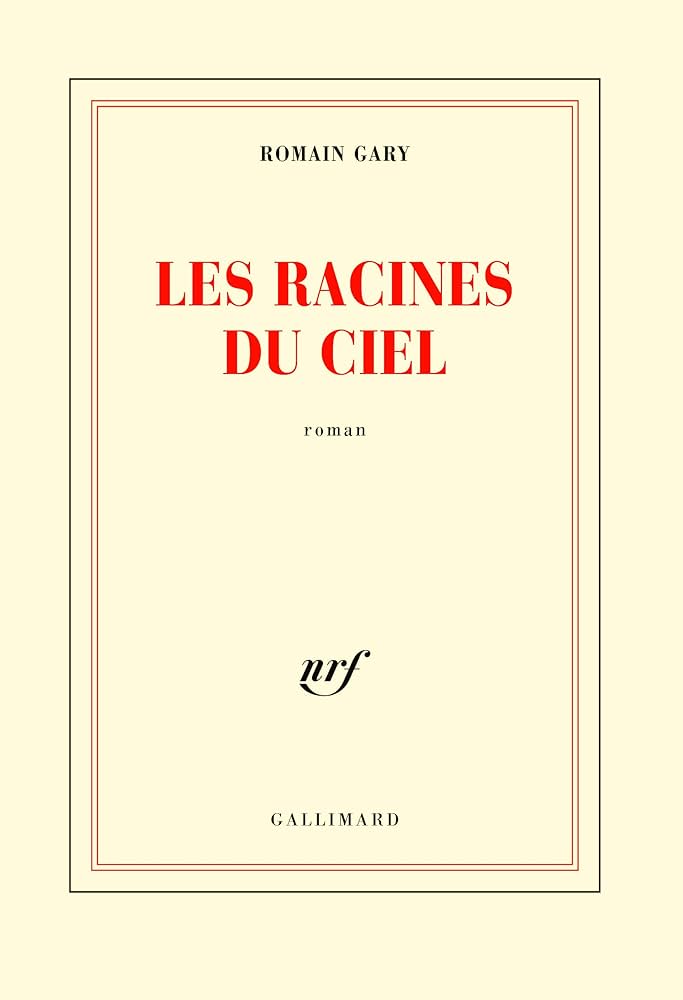

Émile Zola, né le 2 avril 1840, à Paris, et mort, le 29 septembre 1902, dans la même ville, est un écrivain et journaliste, considéré comme le chef de file du naturalisme. Il est principalement connu pour Les Rougon-Macquart, fresque romanesque, en vingt volumes, dépeignant la société française, sous le Second Empire, et mettant en scène la famille Rougon-Macquart, à travers ses différentes générations, dont chacun des représentants, d’une époque, et d’une génération particulière, fait l’objet d’un roman.
Les dernières années de la vie d’Émile Zola sont marquées par son engagement dans l’affaire Dreyfus, avec la publication, en janvier 1898, dans le quotidien L’Aurore, de l’article intitulé « J’accuse… ! », qui lui vaudra un procès pour diffamation, et un exil à Londres, la même année.
François Anatole Thibault, né le 16 avril 1844, à Paris, et mort, le 12 octobre 1924, à 80 ans, à Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), est écrivain. Et l’une des consciences les plus significatives de son temps. Son père, Noël France, né le 4 nivôse an XIV (25 décembre 1805), dans une famille de cordonniers pauvres, reste analphabète jusqu’à vingt ans, quitte son village en 1825, pour entrer dans l’armée, où il sera sous-officier légitimiste, et dont il démissionnera, au lendemain de la Révolution de 1830.
Noël se retrouve, en 1838, à la tête d’une librairie historique d’ouvrages, journaux, caricatures, autographes relatifs… à la Révolution. Le monde est fanatique et cruel. Anatole France, sceptique et ironique, avec un sens aiguë de la formule : « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ».
L’île des pingouins, 1908, est une vive critique des professionnels de la politique.
L’homme politique, moi j’en fais du compost
Anatole France signe la pétition des intellectuels, en faveur d’Alfred Dreyfus. Il fut Président d’honneur de la Libre Pensée. Il est élu à l’Académie Française, en 1896, et reçoit le Prix Nobel de littérature, en 1921.
Alfred Dreyfus, né à Mulhouse, le 9 octobre 1859, et mort, à Paris, le 12 juillet 1935, est un officier français, membre d’une famille juive installée en Alsace depuis plusieurs siècles. Son grand-père était commerçant à Rixheim, près de Mulhouse. Son père créa, à Mulhouse, une petite filature de coton et, les affaires prospérant, y ajouta une usine de tissage. Il permit, ainsi, à sa famille, de faire partie de la bourgeoisie mulhousienne. Alfred épouse, le 18 avril 1890, Lucie Hadamard, d’une famille de diamantaires aisés, originaires de Metz. Le couple aura deux enfants.
Charles Maurras, né le 20 avril 1868, à Martigues (Bouches-du-Rhône), et mort le 16 novembre 1952, à Symphorien-lès-Tours (Indre-et-Loire), est un journaliste, essayiste, homme politique et poète français. Écrivain provençal, appartenant au Félibrige, et agnostique dans sa jeunesse, il se rapproche, ensuite, des milieux catholiques, et antidreyfusards. Sa doctrine, antisémite, anti-protestante, antimaçonnique et xénophobe, prône une monarchie héréditaire, et joue un rôle structurant pour divers courants politiques de droite et d’extrême droite, en France.
Le 10 mai 1871, le traité de Francfort entérine l’annexion, de fait, de l’Alsace, et d’une partie de la Lorraine, y compris la ville de Metz. En 1872, les personnes ayant opté pour la France, iront s’installer en Lorraine française, notamment à Nancy, à Paris, ou en Algérie. La nouvelle frontière franco-allemande s’impose. Symbolisée par un simple poteau, elle se franchit aisément, mais elle est, au fond des cœurs français, inacceptable.
Mina Owczyńska, née, en 1879, à Švenčionys (Lituanie), et morte, le 16 février 1941, à Nice (France), est la mère de Romain Gary, et sa principale source d’inspiration, pour le roman La promesse de l’aube (1960). Mina a deux frères, dont un nommé Eliasz, qui émigrera en France, et l’accueillera, quand elle y viendra, à son tour. Mina fait des études secondaires en yiddish et en russe, dans un établissement de la communauté juive. Elle y participe à un groupe de jeunesse, d’orientation socialiste, le « cercle Yehoash ».
Švenčionys est une ville de Lituanie, située à 84 km de la capitale Vilnius. Elle fait partie de la Haute Lituanie. Il s’agit d’un district frontalier, jouxtant le territoire de la Biélorussie. La ville, elle-même, se trouve à une dizaine de kilomètres de la frontière. Elle se trouve sur la route 102, qui relie Vilnius à Zarasai, à 75 km au nord, en suivant la frontière, doublant l’itinéraire principal, situé plus à l’intérieur. Elle est, aussi, reliée à Švenčionéliai (12 km à l’ouest), où passe la ligne de chemin de fer Varsovie-Vilnius-Pétersbourg. Il s’agit d’une zone de faible altitude, assez forestière.
Arieh-Leïb Kacew, né le 24 juin 1883, à Trakai, dans l’Empire russe (aujourd’hui, en Lituanie), et mort, en 1942, à Vilnius, est le père de Romain Gary. En 1912, Arieh (« lion » en hébreu, d’où la francisation en « Léon ») Kacew (« boucher » en yiddish) tient l’atelier et magasin de fourrures familial, rue Niemecka (“Daïtsche Gas”, ruelle allemande). Il fait partie de la Deuxième guilde des marchands. Il est aussi administrateur de la synagogue de la rue Zawalna. Il fait partie de la bourgeoisie de Vilnius.
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890, à Lille (Nord), et mort le 9 novembre 1970, à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne), est un militaire, résistant, homme d’État et écrivain français. En 1940, il rejette l’armistice, demandé par le président du Conseil Philippe Pétain à l’Allemagne nazie. Avec l’appui de Winston Churchill, il intervient à la radio britannique, le 18 juin : il lance, à la population française, un appel à poursuivre le combat, et à rejoindre les Forces françaises libres. Plusieurs années plus tard, en 1958, il met en place la cinquième République. Il en est le premier président, et occupera cette fonction, de 1959 à 1969. En 1969, il engage son mandat sur un référendum, et démissionne devant le résultat négatif.
L’affaire Dreyfus (1894-1906) est une nouvelle épreuve pour la République, après le scandale de Panama, qui rejaillit, gravement, sur certains dirigeants politiques, et déclenche une vague d’antiparlementarisme, et d’antisémitisme. C’est une affaire d’État, devenue un conflit social et politique majeur de la IIIe République, autour de l’accusation, infondée, de trahison, faite au capitaine Alfred Dreyfus, finalement innocenté. Elle bouleverse la société française, pendant douze ans, la divisant profondément, et durablement, en deux camps opposés : les « dreyfusards », partisans de l’innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.
La condamnation, fin 1894, du capitaine Alfred Dreyfus, pour avoir, prétendument, livré des documents secrets à l’Empire allemand, est une erreur judiciaire, dans un contexte social particulièrement propice à l’antisémitisme et à la haine anti-allemande, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine, en 1871.
Devant une telle iniquité, les partisans de la révision du procès d’Alfred Dreyfus se mobilisent, à fin d’émouvoir l’opinion publique, en sa faveur. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie, dans le journal L’Aurore, une lettre ouverte, au président de la République Félix Faure, dont le titre, « J’accuse… ! », s’affiche, en gros caractères, à la une. Dans une longue et dense plaidoirie, Zola rappelle, d’abord, les circonstances de l’Affaire, la découverte du bordereau incriminateur, et la condamnation, injuste et scandaleuse, d’Alfred Dreyfus. Puis il revient sur la révélation de la trahison du commandant Esterhazy, avant de dénoncer son acquittement, et d’accuser les ministres de la Guerre, les officiers de l’état-major, et les experts d’être responsable de la condamnation d’un innocent. Cette lettre ouverte a un retentissement, très important, dans l’opinion publique, et entraîne une grande effervescence dans le pays, tandis qu’elle expose son auteur à un déchainement de haine inouï.
Joseph Kessel, né le 15 janvier 1898, à Villa Clara (Argentine), et mort, le 23 juillet 1979, à Avernes (Val-d’Oise), est un romancier, grand reporter, aventurier, résistant et académicien français. Engagé volontaire, comme aviateur, pendant la Première Guerre mondiale, il tire de cette expérience humaine son premier grand succès littéraire, L’Équipage, publié à 25 ans. Il publie Belle de jour, qui fait scandale, et Fortune carrée, roman inspiré d’un périple en Mer Rouge. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il rejoint Charles de Gaulle, à Londres. Il y compose, et coécrit, avec son neveu Maurice Druon, les paroles du Chant des partisans, qui deviendra l’hymne de la Résistance.
L’Action française est un mouvement politique français, nationaliste et royaliste, d’extrême-droite, fondé en 1899, en pleine affaire Dreyfus, par Henri Vaugeois et Maurice Pujo, avec l’objectif d’opérer une réforme intellectuelle du nationalisme. Originellement structuré par un nationalisme républicain antidreyfusard, ce mouvement devient rapidement royaliste, sous l’influence de l’idéologue Charles Maurras.
Lesley Blanch née, dans une famille bourgeoise d’intellectuels et d’originaux, le 6 juin 1904, à Chiswick, dans l’Est londonien, et morte, le 7 mai 2007, à Menton, est une écrivaine et éditrice de mode. Dès l’âge de quatre ans, elle est fascinée par un ami de la famille, un mystérieux Russe, grand voyageur, de vingt-cinq ans son aîné. Il devient son amant, alors qu’elle a tout juste vingt ans. Il disparaît, en Union soviétique. Elle décide de se lancer à sa recherche, et devient, au début des années 1930, une des rares voyageurs, en Union soviétique. Elle s’y intéresse à l’histoire et à la littérature. De retour à Londres, elle est remarquée par la rédactrice en chef du magazine Vogue, et se met à écrire des articles culturels, élaborant un nouveau genre de portrait, très fourni et exhaustif. Pendant la guerre, elle écrit, également, pour le Ministère de l’Information britannique.
Les éditions Gallimard, appelées, jusqu’en 1919, les éditions de la Nouvelle Revue française et, jusqu’en 1961, la librairie Gallimard, sont un groupe d’édition français. La maison d’édition est fondée, par Gaston Gallimard, en 1911. Le groupe Gallimard est, actuellement, dirigé par Antoine Gallimard. Considérée comme l’une des plus importantes, et influentes, maisons d’édition, en France, notamment pour la littérature du XXe siècle et contemporaine, Gallimard est le diffuseur, en 2011, d’un catalogue comprenant 38 prix Goncourt, 38 écrivains ayant reçu le prix Nobel de littérature, et 10 écrivains récompensés du prix Pulitzer.
Roman Kacew est issu de deux lignées juives ashkénazes. Ses parents, Arieh Leib Kacew et Mina Owczynska, se sont mariés le 28 aout 1912. Son père est le deuxième époux de sa mère. Celle-ci, fraichement divorcée de Reuven Bregsztein, a eu, de lui, un fils, Joseph, né en 1902, qui cohabita avec Roman, de mars 1922 à avril 1923, avant de mourir de maladie, peu après, à Gdańsk.
Kléber Haedens, né le 11 décembre 1913, à Équeurdreville (Manche), et mort, le 13 août 1976, à Aureville (Haute-Garonne), est un écrivain français, romancier, essayiste et journaliste. Membre de l’Action française, dans les années 1930, il collabore à de nombreuses publications. Replié à Lyon, pendant l’Occupation, il est alors, avec Michel Déon, un des secrétaires particuliers de Charles Maurras, tout en continuant à écrire dans L’Action française, et dans d’autres périodiques. Au sein de Jeune France, il manifeste son désaccord sur l’organisation d’un 14 juillet républicain. Il collabore également à Paroles françaises, un journal de droite, publié, en France, après 1944. À la Libération, il travaille pour l’éditeur Robert Laffont, tout en tenant la critique dramatique d’Aspects de la France, journal néo-maurrassien, animé par Pierre Boutang.
Roman, né le 8 (le 21, dans le calendrier grégorien) mai 1914, à Vilnius, capitale de la Lituanie, empire russe, et mort le 2 décembre 1980, à Paris, est un aviateur, romancier, diplomate, scénariste et réalisateur français (Romain Gary), de langues française et anglaise, à l’œuvre éclectique, protéiforme et abondante, peuplée de personnages assoiffés d’absolu.
Vilnius, anciennement Wilno, puis Vilna, fondée par le grand-duc Gediminas, est la capitale de la Lituanie. Si l’histoire de Vilna est particulièrement complexe, au cours des siècles précédents, la période qui s’écoule entre le 1er août 1914, jour du déclenchement de la Première Guerre mondiale, et le 14 décembre 1925, décret portant incorporation définitive de la ville à la République polonaise, est proprement effarante. En effet, la cité change huit fois de mains. L’orthographe de son nom varie, plusieurs fois, selon la puissance dominante.
Gary eut mille vies, sans compter celles qu’il s’inventa, dans une œuvre, « jeu picaresque de ses multiples identités », qui tient du palimpseste et du mille-feuille, une œuvre électrique et baroque, résultat d’une histoire personnelle riche en mystères, et d’un tempérament révolté. Talentueux peintre des rapports humains, effrayé par la vieillesse, il offre une réflexion riche et complexe sur l’identité.
Romain Gary est connu, également, pour s’être livré à une mystification littéraire, dans les années 1970. Il se trouve être, ainsi, le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt à deux reprises, ce qui est, à la fois, inédit, et interdit, ayant écrit, secrètement, plusieurs de ses romans, sous différents noms d’auteur, dont le pseudonyme d’Émile Ajar.
Si Gary n’a jamais parlé d’Arieh, c’est que son père l’a abandonné. Il a 11 ans, Arieh quitte sa mère, pour fonder un nouveau foyer, avec une femme plus jeune, Frida Bojarska, avec qui il aura deux enfants. Le couple et ses deux enfants seront exterminés par les nazis, comme sept membres de la famille maternelle de Gary.
Romain Gary s’inventera un père de substitution, Ivan Mosjoukine, le plus fameux acteur russe du cinéma muet de l’époque, avec qui sa mère, qui était actrice, avait travaillé, et à qui Gary ressemble physiquement. Mina aurait eu, avec lui, une liaison secrète, dont il laissait entendre qu’il était le fruit. Mosjoukine apparaîtra d’ailleurs, dans son roman autobiographique La Promesse de l’aube. Mosjoukine était un homme de petite taille, aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Le cinéma accomplit bien des miracles.
Il ne fait pas bon venir au monde, en 1914, à Wilno, aux marges de l’empire russe, dans une famille juive. Peu après sa naissance, son père est mobilisé dans l’armée russe. Dans les bras de sa mère, fuyant l’avancée allemande, Roman quitte Vilnius, et se retrouve sur les routes. Roman et sa mère séjournent quelques mois à Švenčionys.
En 1915, la famille est déportée vers le centre de la Russie, les Russes soupçonnant les Juifs des pays baltes de se livrer à l’espionnage, au profit des Allemands. Durant cette période, Gary évoque la rencontre de matelots révolutionnaires, Mina, ancienne membre du cercle socialiste Yehoash, aurait participé à l’agitprop. Ils passeront plusieurs années en Russie.
En septembre 1921, fuyant l’Union soviétique, Mina et son fils sont de retour à Vilnius. Ce retour est rendu possible par la paix de Riga (mars 1921), qui met fin à la guerre entre la Russie soviétique, et la jeune république de Pologne. Ils y vivent, quelques années. Roman fréquente l’école polonaise et, sa mère étant, quelque peu, francomane, il prend des cours particuliers de français, pendant deux ans. Son père, démobilisé, les rejoint.
En août 1925, Mina quitte Vilnius, avec son fils, pour Švenčionys. Ils s’installent, en 1926, à Varsovie, où sont présents d’autres membres de la famille Owczynski, notamment un frère de Mina, Boris (1890-1949), avocat, chez qui ils sont hébergés. Roman semble avoir été scolarisé dans un collège polonais, le collège Górskiego, où il se retrouve en butte à l’antisémitisme. Il suit aussi des cours particuliers de français. Ses parents se séparent.
Mina adore son fils, d’un amour dévorant. Rien n’est trop beau pour son garçon. Elle lui parle de la France, comme d’un eldorado. En août 1928, ils obtiennent un visa touristique pour la France, que sa mère, excessivement francophile, appelait « le paradis terrestre ». Ayant un orgueil démesuré, elle plaçait, en lui, de grandes espérances, et rêvait, même, pour lui, d’un destin fabuleux. Mina est persuadée que, dans ce pays, son fils pourra s’accomplir, pleinement, en tant que diplomate, ou artiste. Elle le pousse à étudier et à écrire : des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, de grands romans. Elle le voit académicien, ou ambassadeur de France, et est prête, pour cela, à tous les sacrifices.
« Ma mère me parlait de la France comme d’autres mères parlent de Blanche-Neige et du Chat Botté et, malgré tous mes efforts, je n’ai jamais pu me débarrasser entièrement de cette image féerique d’une France de héros et de vertus exemplaires. Je suis probablement un des rares hommes au monde restés fidèles à un conte de nourrice. Malheureusement, ma mère n’était pas femme à garder pour elle ce rêve consolant qui l’habitait. Tout, chez elle, était immédiatement extériorisé, proclamé, déclamé, claironné, projeté au-dehors, avec, en général, accompagnement de lave et de cendre. » in La Promesse de l’aube [1960], Paris, Gallimard, collection Folio, 1973, pp 51-53.
Roman a 14 ans, Mina quitte Varsovie avec lui, et arrive, à Nice, le 23 août 1928. Eliasz, le frère de Mina, et sa famille y sont déjà installés. Pour l’adolescent juif de Vilnius, le rêve se réalise. Ils emménagent 15 rue Shakespeare, dans le quartier de la gare. Mina s’empresse d’inscrire Roman au lycée (aujourd’hui, lycée Masséna), celui de Guillaume Apollinaire et de René Cassin. Le 1er octobre, Roman commence sa scolarité française, en classe de 4e. En rentrant du lycée, il fait, parfois, un détour par le marché aux fleurs, pour acheter « un bouquet parfumé », à sa mère, femme flamboyante, fusionnelle et exigeante.
Gringoire, « Le grand hebdomadaire parisien, politique, littéraire », est un hebdomadaire français de droite, lancé le 9 novembre 1928, par Horace de Carbuccia, assisté de Georges Suarez, et de Joseph Kessel. Imaginé comme un équivalent, de droite, de Lumière, c’est le plus important titre de l’entre-deux-guerres : une place majeure y est accordée à la politique, il présente une page littéraire de qualité, de grands reportages et de grands feuilletons. Ses campagnes marquent les principaux événements de l’époque.
Pour élever son fils, Mina exerce différents métiers. Elle tient, un temps, une vitrine, à l’hôtel Negresco. Elle y vend des articles de luxe. Finalement, un de ses clients lui confie la gérance d’une petite pension de famille, boulevard Carlone, aujourd’hui François-Grosso, dans le quartier russe, peuplé d’exilés de l’époque tsariste, qu’elle baptise Hôtel Pension Mermonts, et dont la plupart des clients sont des Russes modestes, arrivés, là, au gré des aléas de la Révolution. En mai 1929, le divorce des parents de Roman est prononcé.
À la rentrée de septembre 1929, utilisant, désormais, son prénom francisé, Romain se distingue, en classe de français, en obtenant le premier prix de récitation, puis celui de composition française. Mais « dans les autres matières, excepté l’allemand qu’il parle et écrit très correctement, il est médiocre ». Ses amis de l’époque sont, comme lui, des élèves étrangers, ou issus de familles d’origine étrangère. Romain se lie avec quatre camarades, dont il restera proche, toute sa vie : Alexandre Kardo Sissoeff, René Agid, François Bondy et Sigurd Norberg.
Alexandre est russe, et champion de tennis. Gary lui empruntera ses exploits, dans La Promesse de l’aube. René, fils d’Alexandre Agid, propriétaire de L’Hermitage, un palace où il accueille les altesses et les pachas, convie Romain pour le déjeuner du dimanche. François, venu de Paris, est exilé à Nice, en tant qu’interne, par ses parents, parce qu’il néglige ses études. Enfin, Sigurd est un jeune Suédois, très bien élevé, et serré, de près, par un père, d’une sévérité extrême, qui s’indigne du relâchement de l’éducation française. Tous seront reçus, au baccalauréat de philosophie, en 1933.
En octobre 1933, il s’inscrit à la faculté de droit d’Aix-en-Provence. Il habite rue Roux-Alphéran. Il passe beaucoup de temps au Café des deux garçons, cours Mirabeau, voulant écrire comme Malraux qui, cette année-là, décroche le prix Goncourt, pour La Condition humaine. Il rédige son premier roman : Le vin des morts. L’action se passe sous terre et met en scène des morts-vivants.
Le micro-baudelairein, que je suis, signale, ici, que l’auteur qu’il connait le moins mal a écrit un Le Vin de l’Assassin, dont la première strophe est :
Ma femme est morte, je suis libre !
Je puis donc boire tout mon soûl.
Lorsque je rentrais sans un sou,
Ses cris me déchiraient la fibre.
Et un L’Âme du vin, dont la première strophe est :
Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité !
Charles Baudelaire a composé une section entière des Fleurs du mal, dédiée au vin (1857). Elle regroupe cinq poèmes : « L’Âme du vin », « Le Vin des chiffonniers », « Le Vin de l’assassin », « Le Vin du solitaire », et « Le Vin des amants », qui forment la quintessence poétique d’une pensée développée, quelques années auparavant, par lui-même, dans « Du vin et du haschisch » (1851).
Au début de l’année 1934, le monde subit les conséquences de la crise économique, issue du krach de 1929, et la montée des extrémismes. Le 6 février, appellent à une manifestation antiparlementaire, à Paris, devant la Chambre des députés, des groupes de droite, des associations d’anciens combattants, et des ligues d’extrême droite, pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe, à la suite de l’affaire Stavisky. L’Action française participe à cette manifestation, qui tourne à l’émeute, sur la place de la Concorde, et fait 19 morts.
Probablement grâce à l’aide financière que lui apporte son père, après leur rencontre à Varsovie, durant l’été 1934, Romain part continuer ses études de droit, à Paris. Il s’installe à l’hôtel de l’Europe, un hôtel à cafards, situé 4 rue Rollin, à deux pas de la place de la Contrescarpe. Afin de gagner quelque argent, il est : livreur, plongeur, figurant au cinéma, employé au restaurant Lapérouse. Il prépare ses examens, écrit tous les jours, et rêve de devenir célèbre.
Il voit approcher, avec résignation, son service militaire, de deux ans : « C’est comme ça qu’on nous vole notre jeunesse. » Suivent des considérations de potache sur la situation en Europe. Il achève sa lettre, par d’autres plaisanteries, remplies d’amertume, sur la misère dans laquelle il vit.
Romain publie ses premières nouvelles, dans Gringoire, qui n’est pas encore, à l’époque, d’extrême-droite. La première, L’Orage, y paraît le 15 février 1935, ce qui lui permet de ne plus dépendre, financièrement, de sa mère. Le jeune immigré dans la France xénophobe des années 1930, en butte à des ostracismes, est naturalisé français, le 5 juillet 1935.
Une de ses premières histoires d’amour se déploie avec une jeune journaliste suédoise, qu’il rencontre, à Nice, en juillet 1937 : Christel Söderlund. Elle est de passage en France, pour un reportage, et en instance de divorce. Jeune, mère d’un petit garçon, elle suit Roman, quand il va étudier à Paris. Les deux amants vivent une relation passionnelle, durant plusieurs mois. Il passe, avec elle, « des journées et des nuits inoubliables ». Christel décide, finalement, de rentrer à Stockholm, en mars, et de reprendre la vie commune avec son mari, musicien et compositeur. Laissant Romain, bouleversé par la rupture.
Gary obtient sa licence en droit, en juillet 1938. Il obtient, aussi, le diplôme de langues slaves, de l’université de Varsovie. Quand il comprend, enfin, que Gringoire est fasciste et antisémite, il renonce aux rétributions qu’il lui verse, et écrit à la rédaction une lettre, pour dire en substance : « Je ne mange pas de ce pain-là. »
En 1938, Romain rencontre, à Nice, une belle, et bien née, Hongroise, de 28 ans, aux yeux gris, qui le marquera, profondément : Ilona Gesmay. Elle a quatre ans de plus que lui. Ils deviennent amants. Gary vit, avec Ilona, un amour fou. Peut-être, même, son seul grand amour.
Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, les accords de Munich sont signés en Allemagne, pour « éviter la guerre ». Ils clôturent la Conférence des Quatre, réunie à l’initiative du dirigeant italien Benito Mussolini, pour régler, pacifiquement, le conflit qui oppose Adolf Hitler et la Tchécoslovaquie. Les signataires -le Duce, le Premier ministre britannique Arthur Neville Chamberlain, le Français Édouard Daladier, président du Conseil et Adolf Hitler- actent la cession des Sudètes, au profit du IIIe Reich, mais avec des garanties françaises, et anglaises, sur l’intégrité du reste du pays. Ce compromis est censé mettre un terme aux vives tensions que connaît l’Europe depuis des mois. Horrifié par ces accords, Romain en anticipe les conséquences.
Jean Dorothy Seberg, née le 13 novembre 1938, à Marshalltown, dans l’Iowa, et morte, le 30 août 1979, à Paris, est une actrice américano-française. Elle connaît son premier triomphe en 1957, avec le personnage de Jeanne d’Arc, qu’elle incarne dans le film Jeanne, d’Otto Preminger. De Bonjour tristesse, de Preminger, et d’après Sagan, à À bout de souffle, de Godard, et avec Belmondo pour partenaire, elle devient célèbre grâce à sa fraîcheur, sa beauté, et sa spontanéité. Sa vie privée tumultueuse, et son mariage avec Romain Gary, ont fait d’elle, au-delà de la star, une figure de la vie culturelle des années 1960. Elle est parmi les premières actrices à s’engager, politiquement, pour faire entendre la voix des Noirs américains, dans un contexte de ségrégation raciale. Sa mort, mal élucidée, met un point final mystérieux, à son existence.
Romain se découvre un autre rêve, Guynemer et Mermoz en ont tracé le chemin : devenir pilote de chasse, et officier, tant qu’à faire. Il obtient sa licence en droit, en juillet 1938, et est incorporé, le 4 novembre 1938, dans l’Armée de l’air, à la base aérienne de Salon-de-Provence.
À l’issue d’une formation d’élève officier de réserve, de trois mois, à l’école d’observation d’Avord, près de Bourges, il passe l’examen de sortie, en mars 1939. Mais l’administration ne le voit pas de cet œil, et l’élève-officier Kacew, sans doute, encore, trop peu français, n’est pas reçu à l’examen. L’armée refuse sa nomination, comme sous-officier, alors qu’il a brillamment réussi le concours. « Je n’ai pas été nommé officier. Seul sur 170 camarades. Because naturalisé. », comme le lui confirmera le lieutenant Jacquard.
Il faut replacer l’échec de Romain dans le contexte du printemps 1939, et de la flambée de l’antisémitisme violent, qui présentait les Juifs comme des envahisseurs, malfaisants, mercantiles, belliqueux, assoiffés de pouvoir, fauteurs de guerre. Au choix : bourgeois ou révolutionnaires.
Au mois de juin 1939, Romain se rend en Suède, avec deux mille francs en poche, pour tenter de reconquérir la belle Christel, avec laquelle il avait filé le parfait amour, pendant quelques semaines, à Paris, et à Nice. Romain ne réussit pas à la revoir. La famille de son ami Sigurd lui prête leur stuga. Il y remanie son premier roman : Le Vin des morts.
Lorsque la guerre éclate, en septembre 1939, Romain Kacew est mobilisé, en tant qu’instructeur de tir, à l’école des observateurs de Bordeaux-Mérignac, où la base aérienne d’Avord s’est repliée.
« Elle s’appelait Ilona Gesmay et habitait à Budapest. Elle était très belle et intelligente et je l’ai aimé. Elle est venue sur la Côte d’Azur et elle est descendue chez nous, au Mermonts, et ma mère voyait notre liaison d’un très bon œil, elle approuvait. Ses yeux avaient la couleur des chats persans, de leur fourrure. Elle était très fragile… Parfois, elle restait couchée des semaines entières, et lorsque çà n’allait pas mieux, elle partait en Suisse pour se faire soigner. Je pensais que je ne pourrais pas vivre sans elle, mais on peut toujours, c’est même ce qu’il y a de dégueulasse. Elle est partie en Hongrie juste avant la guerre, pour parler à ses parents de notre mariage, mais je ne pense pas qu’elle m’aurait vraiment épousé »
Ilona menait sa vie amoureuse très librement, ne se plaisait qu’en compagnie de l’aristocratie versaillaise, et ne songeait, nullement, à épouser ce garçon, qu’elle jugeait très beau, mais plus jeune qu’elle, et sans ressources.
Depuis la Suisse, où elle faisait de fréquents séjours, justifiés par sa santé mentale fragile, Ilona regagne Budapest, en mars 1940, sur l’ordre de son père, directeur général des Cimenteries, et président des Charbonnages de Hongrie, filiale flamande de la Kredit Bank. Romain écrit : « C’est une grande souffrance pour moi. » Il raconte, dans sa nouvelle À bout de souffle, qu’elle est la seule femme qu’il ait jamais aimée.
Ilona a échappé à la Shoah, avec ses parents qui, protégés par le comte Bernadotte, ne furent pas transférés dans le ghetto. Ils se cachèrent dans la cave de leur maison pendant le siège de Budapest. Munis de faux papiers, ils réussirent à gagner la Belgique, où le père avait des relations d’affaires, dans les charbonnages. Ilona fut le témoin des pogroms perpétrés par les fascistes hongrois, qui fusillèrent et jetèrent des milliers de Juifs dans le Danube, dont son beau-frère. Ilona perdit la raison. Elle se convertit au catholicisme, et fut internée, dans un hôpital psychiatrique, à Anvers.
« Son seul grand amour fut en réalité Ilona Gesmay, une Hongroise de 28 ans, quatre ans de plus que Gary. Soixante ans après leur histoire, je l’ai vu sangloter en l’évoquant », confie Myriam Anissimov, sa biographe. « Gary me raconta un soir, en sanglotant, qu’il était allé lui rendre visite à Anvers, mais qu’elle ne l’avait pas reconnu. » Elle « exerçait sur lui une extraordinaire fascination et eut une influence considérable sur sa création littéraire ». Elle devient sa muse, inspirant plusieurs de ses romans, dont La Promesse de l’aube, en 1960, La Nuit sera calme, en 1974, et surtout Europa, en 1972, où elle est évoquée, telle quelle, forte et mature. Gary voulait l’épouser, mais elle ne donna pas suite, considérant que cela eut été une mésalliance.
Âgée, Ilona recouvra la raison, et se souvint qu’elle était juive. Mais, elle continua à assister à la messe, dont le rituel l’enchantait. Elle mourut, à 91 ans (1908-1999). Dans « La Nuit sera calme », Gary indique : « C’était certainement la femme que j’ai le plus aimée dans ma vie et qui était faite pour vivre avec moi jusqu’à la fin des jours, des miens, en tout cas. Ilona, qui -l’idéalisation par le souvenir y aidant, évidemment- était la plus belle femme que j’aie jamais vue et que j’aie aimée comme on aime une fois dans sa vie, et encore, si on du talent pour ça… »
Gary tentera de se consoler, dans d’autres bras. Mais le double lauréat du prix Goncourt ne fut pas seulement l’archétype de l’homme à femmes. Si furent de simples exutoires la rencontre de nombreuses femmes éphémères, qui acceptaient sa sensualité violente, et dénuée de sentimentalité, dont il ne pouvait se passer, l’auteur de Gros-Câlin menait, avec d’autres partenaires, cette quête perpétuelle de l’amour, que son écriture prolongeait, dans une œuvre romanesque, amplement autobiographique.
Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle lance, avec l’appui de Winston Churchill, à la radio britannique, à la population française, un appel à refuser la capitulation demandée, par le président du Conseil Philippe Pétain à l’Allemagne nazie, à poursuivre le combat, et à rejoindre les Forces françaises libres. Fervent admirateur de Charles de Gaulle, révolté par la capitulation, et refusant de voir la France, qui l’avait accueilli, collaborer avec l’Allemagne nazie, Romain Gary décide de rallier les Forces françaises libres, disant : « La France libre est la seule communauté humaine à laquelle j’ai appartenu à part entière ».
Il s’évade, de France, en avion, atterrit à Alger, séjourne à Meknès et à Casablanca, le temps de trouver un cargo britannique, qui l’emmène à Gibraltar. Deux semaines plus tard, il débarque à Glasgow et, dès son arrivée, demande à servir dans une unité combattante des Forces aériennes françaises libres, sous le nom de Romain Gary.
Le 8 août 1940, à Londres, Gary est incorporé. Il sert au Moyen-Orient, en Libye, et à Koufra, en février 1941, en Abyssinie, puis en Syrie. Il contracte différentes maladies, dont le typhus et, presque mourant, restera six mois à l’hôpital. Rétabli, conservant, cependant, une paralysie de la partie gauche du visage, il rejoint l’escadrille de surveillance côtière, en Palestine, et se distingue, dans l’attaque d’un sous-marin italien. Il est breveté officier observateur, en avril 1941, puis, promu lieutenant, le 15 décembre 1942.
En février 1943, il est rattaché, en Grande-Bretagne, au groupe de bombardement Lorraine, et est affecté à la destruction des bases de lancement des missiles V1. En tant qu’observateur, il remplace Pierre Mendès France, dans l’équipage du sous-lieutenant Arnaud Langer. C’est dans ces conditions qu’il se distingue, particulièrement, le 25 janvier 1944, quand, alors qu’il se trouve dans l’avion de tête d’une formation de six appareils, il est blessé, au-dessus de Saint-Omer, par un éclat d’obus, en même temps que son coéquipier pilote Langer, gravement touché aux yeux.
Malgré sa blessure, il guide son coéquipier, et l’ensemble de sa formation, avec suffisamment de maîtrise pour réussir un bombardement très précis, et pour ramener l’escadrille à la base. Il finit sa mission, en héros, dans un cockpit fracassé. Il perdit beaucoup de sang. Le sang imprégnant son battledress n’était pas français, « Je n’ai pas une goutte de sang français mais la France coule dans mes veines ».
Il effectue, sur le front de l’Ouest, plus de vingt-cinq missions, totalisant plus de soixante-cinq heures de vol de guerre. Entre deux vols, il écrit Éducation européenne. Au Petit club français, de Londres, il rencontre Joseph Kessel.
À la fin de la guerre, par un décret du 20 novembre 1944, Romain Gary est nommé compagnon de la Libération. Il reçoit la croix de guerre 1939-1945, la médaille de la Résistance, la médaille des blessés, et devient commandeur de la Légion d’honneur. L’épopée gaullienne, où il s’était montré si brave, lui avait donné le sentiment de s’incorporer, enfin, à l’Histoire de France.
« Disons d’abord les choses clairement : je suis un « gaulliste inconditionnel ». Et puisque je fais ici cet aveu compromettant, aux conséquences imprévisibles pour moi et ma famille, je tiens à donner ici la définition du « gaulliste inconditionnel » à laquelle je me suis efforcé de rester fidèle depuis juin 1940. Un « gaulliste inconditionnel » est un homme qui s’est fait une certaine idée du général de Gaulle, comme le général de Gaulle « se fait une certaine idée de la France ». Dès que les deux conceptions cessent de coïncider, les liens sont rompus. Il s’agit donc bien plus d’une fidélité du général de Gaulle qu’au général de Gaulle. Fidélité à quoi ? À « une certaine idée de la France », justement, qu’il avait présentée aux Français libres bien avant de l’avoir formulée dès les premières lignes de ses Mémoires. Et cette idée, cet idéal – « la madone des fresques, la princesse des légendes » – est, par définition, incompatible avec une France du mensonge ou de la propagande tendancieuse. »
Début 1944, Gary fait la connaissance de Lesley Blanch, de dix ans son aînée. Il est capitaine dans l’escadrille Lorraine, des Forces françaises libres. Lesley, d’une grande beauté, le séduit. En avril 1945, et bien que l’amour d’Ilona continue de le hanter, Romain épouse Lesley. Il est son troisième époux. Elle est folle amoureuse de lui.
Son roman Éducation européenne, paru en 1945, qui se déroule parmi les partisans dans les forêts proches de Wilno, parait, à Paris, chez Calmann-Lévi. Il a été traduit, publié, et remarqué, à Londres, grâce aux bons offices de son épouse Lesley, qui dirigeait les pages culturelles du magazine Vogue, et fréquentait tout ce qui comptait, à Londres. Éducation européenne connut un succès immédiat, en France, et fut récompensé par le prix de la Critique. Sa carrière était lancée. Cela n’eut pas l’heur de le satisfaire : il visait le Goncourt.
Dès 1946, devenu diplomate, Gary est envoyé dans différents pays. Lesley partage la vie professionnelle de son mari. Elle le suit, dans toutes ses expéditions. Le couple va énormément voyager. En l’accompagnant, elle découvre les Balkans, la Turquie, le Guatemala, le Sahara, des pays où tous deux vivent intensément, et écrivent.
L’œuvre littéraire de Romain Gary est marquée par un refus opiniâtre de céder devant la médiocrité humaine. Ses personnages sont fréquemment en dehors du système, parce que révoltés, contre tout ce qui pousse l’homme à des comportements qui lui font perdre sa dignité. Ils oscillent entre la souffrance de voir leur monde abîmé, et la lutte pour garder, coûte que coûte, l’espérance. Romain Gary vit, lui-même, ces combats, mêlant, admirablement, le dramatique et l’humour.
L’écrivain incandescent, formidablement délié, se vit reprocher, par de troubles puristes, de mal écrire. Ainsi, en 1956, au moment où Jean Giono et Pierre Mac Orlan donnaient le Goncourt aux Racines du ciel, le sinistre Kleber Haedens, ancien secrétaire de Charles Maurras, affirma : « Nous avons le regret mais aussi le devoir de le dire : Romain Gary ne sait pas le français. Il n’existe peut-être pas d’ouvrage aussi lourdement incorrect dans toute l’histoire de la littérature française. Son style est celui d’une exécrable traduction ».
Touché au vif, Gary ne le rata pas : « Dès que j’entends dans la voix d’un homme cette souffrance haineuse, je me prosterne avec sympathie et jubilation. C’est un frère. » Réponse digne d’un « terroriste de l’humour », comme il s’autoproclamait.
En 1959, Gary a 45 ans, Jean : 21. Elle avait failli brûler vive, sur le tournage de Jeanne, de Preminger, et sortait d’A bout de souffle, de Godard. Gary fait la connaissance de Jean Seberg, en tombe amoureux, et entame une liaison avec elle. Jean voulait toujours faire l’amour.
La Promesse de l’aube, paru en 1960, est le récit de l’amour inconditionnel qui lia Romain Gary à sa mère, tout au long de sa vie. Un amour démesuré, qu’il ne peut trahir. Une mère, extravagante et excessive, et son fils, brillant, drôle, capable de réaliser les ambitions folles qu’elle a pour lui. Leur relation pourrait être décrite comme une symbiose, parfois bénéfique, parfois délétère, où les deux protagonistes dépendent l’un de l’autre. Il est facile d’avoir l’impression que cette relation régit toute sa vie et ses actes : sa relation avec les autres femmes, ses ambitions professionnelles, sa capacité à être heureux et satisfait de ce qu’il a réussi à accomplir. Bien que le livre soit, essentiellement, autobiographique, on sait que l’auteur s’est, de maintes manières, éloigné de la vérité.
Le fils de Jean et Romain, Alexandre Diego, nait en 1962. En 1963, Gary divorce de sa précédente épouse, Lesley. Celle-ci continuera, néanmoins, à porter le nom de Gary. « En France, cela améliore ma place à table », confiait-elle, avec humour. Gary et Seberg se marient.
En 1967, les éditions Gallimard font paraître le roman La Danse de Gengis Cohn. Ce roman est le deuxième tome de la trilogie « Frère Océan », après Pour Sganarelle, et avant La Tête coupable. L’action se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Schatz, commissaire à Licht, enquête sur une série de meurtres mystérieux : toutes les victimes sont des hommes, et tous arborent un sourire extraordinaire. Pendant l’investigation, le commissaire est harcelé par des interventions de Moïché Cohn, alias Gengis Cohn, un comique juif, tué par des SS, en 1944. L’humour noir est très présent dans ce roman, qui traite non seulement de la Shoah, mais aussi de la judéité, et de l’humanité en général.
En 1968, lorsque Gary apprend que Jean entretient une liaison avec Clint Eastwood, pendant le tournage de La Kermesse de l’Ouest, il prend l’avion, et provoque l’acteur en duel, au revolver. Le « cow-boy américain » se défile. Romain Gary et Jean Seberg divorcent, en 1970.
Gros-Câlin, publié en 1974, sous le nom d’Émile Ajar, à l’insu de son éditeur Gallimard, est présenté, par ce dernier, comme « une étonnante fable humoristique. » Il s’agit de l’histoire de M. Cousin, un statisticien troublé, qui cherche désespérément à combler le vide de son existence. À défaut de trouver l’amour chez ses contemporains, il s’éprend d’un python adulte capable de l’enlacer dans une puissante étreinte. De fait, il matérialise l’inadéquation du personnage. Progressivement, le lecteur comprend que l’étrangeté du reptile, sa présence incongrue dans Paris, l’improbable potentiel de communication que la bête manifeste sont aussi des caractéristiques de Cousin. Déçu par des amitiés chimériques et un projet de mariage qui n’existait que dans sa tête, le personnage se referme sur lui-même, confiant au hasard et à la contingence le soin de lui rappeler sa propre existence.
En 1975, Gary demande à son cousin Paul Pavlowitch de personnifier Émile Ajar. Quand Romain Gary obtient, pour La Vie devant soi, un second prix Goncourt, le 17 novembre 1975, Paul donne des interviews, pendant que Gary jubile, secrètement, de se voir adoubé, une seconde fois.
En 1978, répondant à la question d’une journaliste, qui lui avait demandé : « Vieillir ? », Romain Gary avait répondu : « Catastrophe. Mais ça ne m’arrivera pas. Jamais. J’imagine que ce doit être une chose atroce, mais comme moi, je suis incapable de vieillir, j’ai fait un pacte avec ce monsieur là-haut, vous connaissez ? J’ai fait un pacte avec lui aux termes duquel je ne vieillirai jamais ».
En 1979, son destin rattrape Jean Seberg. Salie par le FBI, pour son soutien aux Black Panthers, gravement dépressive, elle se donne la mort, à 40 ans, le sang chargé d’alcool et de barbituriques.
« Je suis hanté par l’escroquerie intellectuelle et l’abus de confiance parce que je suis un écrivain du XXe siècle et que jamais dans l’histoire, la malhonnêteté intellectuelle, idéologique, morale et spirituelle n’a été aussi cynique, aussi immonde et aussi sanglante. Le commediante Mussolini et le charlatan Hitler ont poussé leur imposture jusqu’à trente millions de morts. Le fascisme n’a pas été autre chose qu’une atroce exploitation de la connerie. En Russie, Staline exterminait des populations entières au nom de la justice sociale et des masses laborieuses, qu’il réduisait en esclavage. »
Dans un recueil de confidences, livrées dans un entretien à Radio-Canada, en 1980, à la fin du chapitre intitulé « Le sens de ma vie », Romain Gary fait cette déclaration : « La seule chose qui m’intéresse, c’est la femme, je ne dis pas les femmes, attention, je dis la femme, la féminité ». « Mon rapport avec les femmes a été d’abord un respect et une adoration pour ma mère, qui s’est sacrifiée pour moi, et un amour des femmes dans toutes les dimensions de la féminité », rajoute-t-il. « Gary disait lui-même que les deux choses qui l’avaient sauvé, c’était la littérature et la sexualité », témoigne, encore, Myriam Anissimov.
Europa est publié le 27 avril 1972, par les éditions Gallimard. Vingt-sept ans après Education européenne, Gary revient au thème de l’Europe, alors qu’il est une dans une période créatrice difficile. Dans ce roman délirant – au sens propre du terme – l’auteur met en scène Jean Danthès, ambassadeur de France en Italie, et son amour pour l’Europe, incarnée dans la figure dédoublée de Malvina von Leyden, et de sa fille Erika, qu’accompagne le personnage –redondant dans l’œuvre de Gary– du Baron, personnification du destin, haïe par Gary. Dédoublement de la personnalité, telle est bien la clé de chaque personnage, ou aspect, de cette œuvre de fiction, comme elle l’est de l’Europe elle-même, cet autre conte de fées.
Le 2 décembre 1980, il a 66 ans, Romain Gary déjeune au restaurant Récamier, avec son éditeur, Claude Gallimard. Il ne se fait pas raccompagner par le chauffeur de la maison. Il rentre, chez lui, au 108 rue du Bac, à pied.
En fin d’après-midi, l’auteur de La Vie devant soi et de La Promesse de l’aube, unique double lauréat du prix Goncourt, se déshabille, plie soigneusement ses vêtements, s’allonge sur son lit, saisit son revolver, et se tire une balle dans la bouche. Il laisse, au pied de son lit, une lettre, qui s’achève par ces mots : « Je me suis enfin exprimé entièrement. » Un peu plus d’un an après le suicide de Jean Seberg, qu’il a follement aimée, la balle du Smith & Wesson n’est pas sortie du crâne. La vérité a eu le dernier mot.
« L’éternité, c’est long, surtout vers la fin. », Allan Stewart Konigsberg, réalisateur, scénariste, écrivain, acteur, dramaturge et humoriste américain, né à New York le 1er décembre 1935.