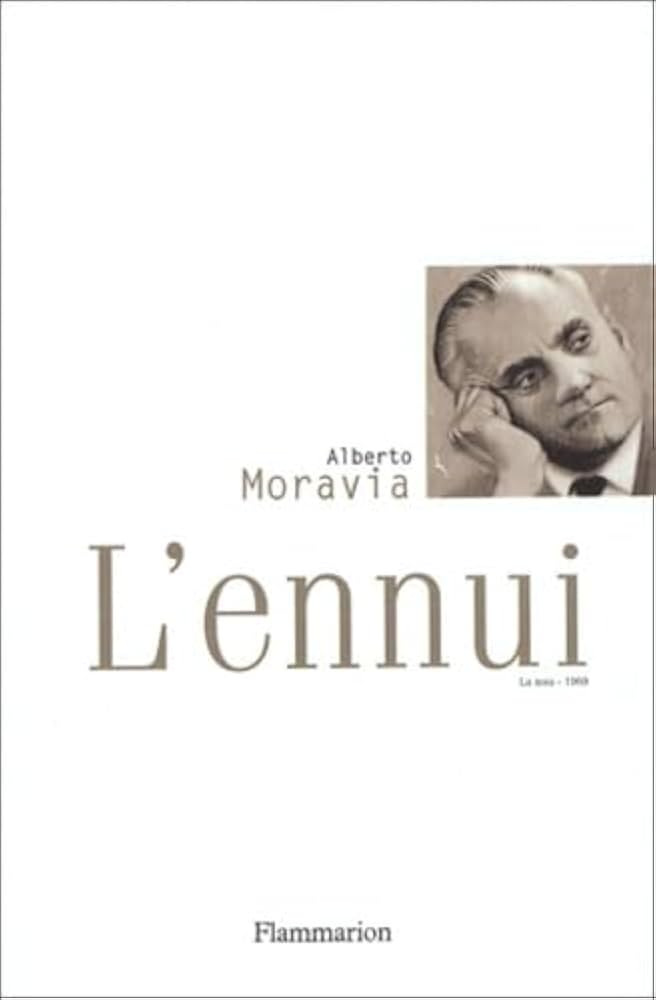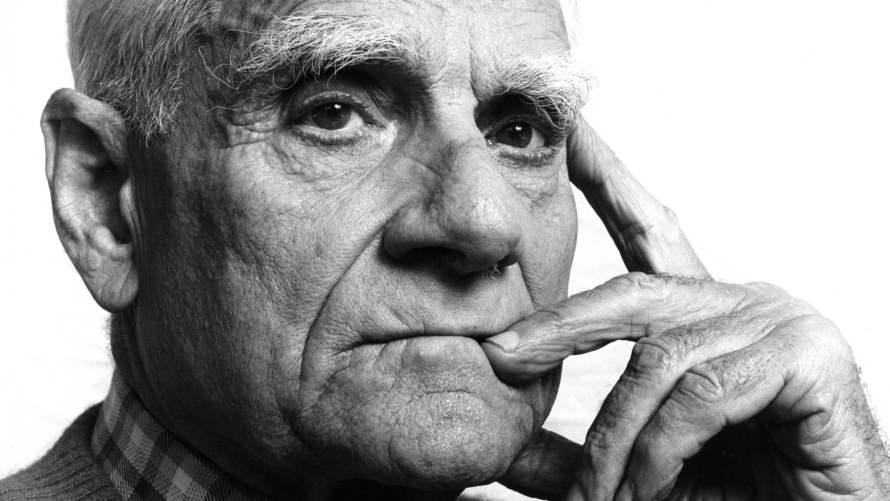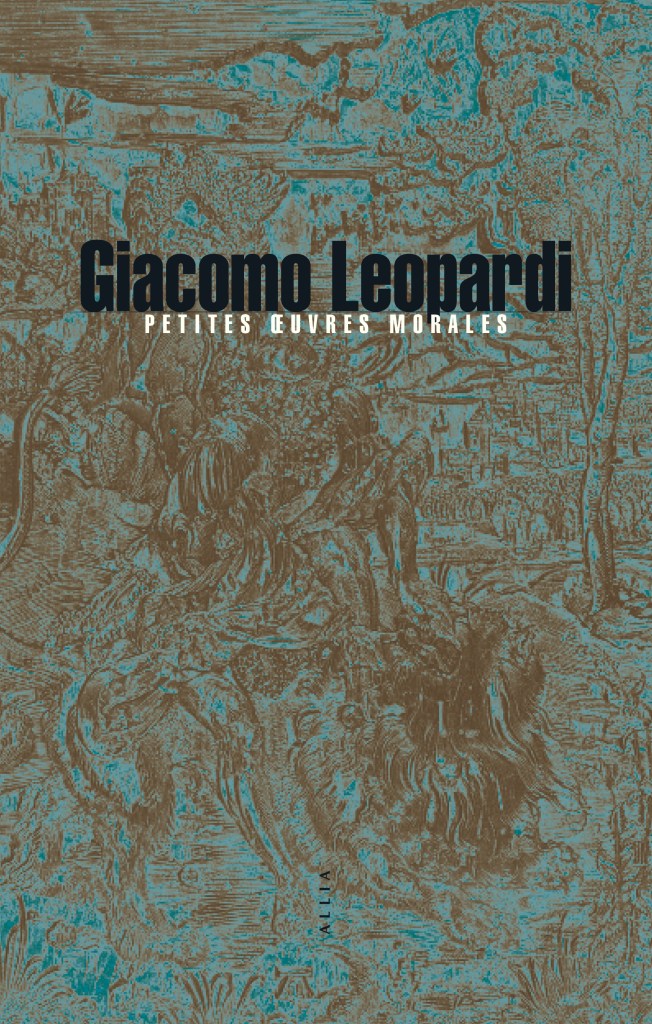De la Modernité, on peut dire que l’engeance est déconcertante. Les enfants du Progrès se glorifient comme ils se détestent, et les très contemporains désirs d’évasion ne vont pas sans rappeler l’invitation baudelairienne à l’ivresse. Comme si rien ne guettait peut-être plus profondément la Modernité que l’excès, paradoxal, de lassitude. C’est cette brisure qu’exprime Moravia dans « L’Ennui. »
« La détente du corps culmine dans le sommeil ; celle de l’esprit culmine dans l’ennui », écrit Walter Benjamin dans Le raconteur. Et le philosophe de déplorer que l’ennui, cet « oiseau du rêve », tendrait à disparaître avec la Modernité : « Dans les villes – où il n’est plus d’activités qui soient intimement liées à l’ennui – il ne trouve déjà plus aucun endroit pour faire son nid et, même à la campagne, il lui est de plus en plus difficile de s’établir »[i].
Le diagnostic semble n’avoir jamais été aussi pertinent : nos vies sont volontiers décrites comme accaparées, et tout se passe comme si l’on n’avait jamais laissé aussi peu de place à l’ennui. Mais est-ce bien de la disparition de l’ennui que nous souffrons ? N’est-ce pas, au contraire, d’un excès de lassitude ? C’est la seconde hypothèse qu’on tente de soutenir ici, à partir d’une lecture de L’ennui de Moravia.
Paru en 1960, l’Ennui de Moravia relate l’histoire de Dino, riche bourgeois romain de trente-sept ans, qui s’ennuie depuis toujours. Cherchant à rompre avec sa douleur, il décide de s’installer dans le quartier des artistes, où il se consacre à la peinture. Mais très vite, l’ennui ressurgit, Dino renonce et décide de retourner vivre chez sa mère. Cette régression, toutefois, est un nouveau fiasco. S’apprêtant à retrouver le vide de son atelier, il fait alors la connaissance de Cécilia, une jeune modèle. Décidant d’entamer une liaison avec elle, Dino s’aperçoit cependant très vite que l’ennui reparaît ; il décide alors de rompre. C’est à ce moment que la jeune fille, ordinairement si prévisible, décide de ne venir pas à un rendez-vous, sans éprouver le besoin de se justifier.
De parfaitement ennuyeuse qu’elle était, Cécilia prend alors les contours d’un être mystérieux, insaisissable ; la suite du roman décrira toutes les tentatives faites par Dino, dont l’ennui a laissé place à une autre forme de souffrance, pour cerner les contours d’un être qui lui échappe.
Ennui et incommunicabilité
Commençons par mentionner les raisons de l’ennui, telles qu’elles sont exposées dans le prologue. Moravia y insiste, Dino s’ennuie parce qu’il souffre de n’entretenir aucun rapport avec le réel : « La sensation de l’ennui naît en moi, je l’ai déjà dit, de l’impression d’absurdité d’une réalité insuffisante, c’est-à-dire incapable de me persuader de sa propre réalité effective », déclare-t-il. Et d’ajouter un peu plus loin que, dès qu’un objet se présente à ses yeux comme « absurde », comme quelque chose avec lequel il n’a « aucun rapport », alors « de cette absurdité jaillira l’ennui, lequel en fin de compte (…) est fait de l’incommunicabilité et de l’incapacité en d’en sortir) ».
Corrélat d’une absence de sens, l’ennui exprimerait donc l’incapacité du sujet à adhérer au monde.
Dino n’est donc pas loin d’éprouver le malaise ressenti par Roquentin dans La Nausée de Sartre, qui s’« ennuyait profondément » en Indochine comme il s’ennuie à Bouville, dans sa chambre aussi bien qu’au café, dans la Bibliothèque municipale aussi bien que dans la rue. Mais alors que chez Sartre, l’ennui naît d’une sensation quasi-obscène de l’existence (où toutes les choses « sont de trop »), c’est plutôt l’inverse qui est vrai chez Dino, où c’est l’insuffisance du sentiment d’existence qui est en cause ; excès dans un cas, donc, et manque dans l’autre.
Reste que le diagnostic, lui, est le même : l’ennui survient quand l’individu échoue à élaborer du sens, c’est-à-dire à justifier le réel, à jeter un pont entre soi et le monde.
L’ennui, une problématique globale
On pourrait tenter de relier cette problématique à des motifs strictement autobiographiques : cette coupure d’avec le monde, l’auteur l’éprouve dans sa chair lorsqu’à l’âge de neuf ans, la maladie le contraint à s’isoler durant de longues années. Mais ce serait oublier que Moravia revendique explicitement la portée globale de son thème. Dans un entretien donné au magazine La table ronde en 1958, il déclare ainsi : « Le problème des rapports de l’homme et de la réalité est le problème dominant de notre époque (…) L’homme se retrouva tout à coup incapable d’entrer en relations avec son propre monde : le monde était tout à coup devenu obscur, indéchiffrable. Ou même, pis encore, inexistant ».
« Corrélat d’une absence de sens, l’ennui exprimerait donc l’incapacité du sujet à adhérer au monde. »
Si le texte se focalise bien sur une histoire d’amour, il y a donc tout lieu de penser, comme l’écrit Gilles de Van, que c’est l’amour qui « permet de vérifier, sans tricherie, l’aptitude du héros à établir un rapport avec réalité »[ii].
Le personnage de Cécilia
C’est ce qui apparaîtra pleinement si l’on se focalise sur les traits prêtés par l’auteur au personnage de Cécilia, la jeune modèle dont s’éprend Dino. Car ce qui frappe avant tout chez cette femme, c’est, pourrait-on dire, son caractère irréel, dû à une absence totale de psychologie. Cécilia, en effet, se distingue avant tout négativement, par son manque d’intériorité : « Dedans, je ne suis personne », déclare-t-elle. Et Moravia d’accentuer le trait par la mise en scène – répétée – de ces dialogues impossibles, où son héroïne déjoue, par un usage quasi tautologique du langage, toute tentative de communication réelle[iii].
On pourrait, du reste, multiplier les exemples qui prouvent que Moravia tend à déréaliser un personnage qui, tout au long du roman, semble étranger à ce qui fait le patrimoine humain : incapacité à exprimer le moindre sentiment, indifférence aux valeurs ainsi qu’à la culture, manque absolu de toute épaisseur temporelle (Cécilia vit dans le pur présent, ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle considère son père, mourant, en parfaite santé, pour la simple raison qu’en toute logique, il n’est pas mort), sexualité mécanique, réduite à la pure animalité[iv] etc.
« L’ennui survient quand l’individu échoue à élaborer du sens, c’est-à-dire à justifier le réel, à jeter un pont entre soi et le monde. »
L’hypothèse de la nature allégorique du personnage s’en trouve ainsi renforcée. Certes, Cécilia retrouve une forme d’intérêt dès qu’elle échappe à Dino, en entament une liaison parallèle avec un acteur ; mais c’est toujours à l’échec qu’aboutissent les tentatives répétées de celui-ci pour établir un rapport. Cécilia est donc trop inhumaine pour ne pas revêtir une dimension mythique : elle incarne, à elle seule, tout ce que la réalité peut relever de non-sens.
Ennui et manque
S’il est donc question d’amour, c’est surtout des modalités d’imprégnation de l’ennui dans une réalité spécifique, celle du monde d’après-guerre et des débuts de la société de consommation, qu’il s’agit. Cet ennui, le lecteur en suit le brouillard dans un monde qui, s’il est de part investi par le régime l’utilité, paraît cependant vide de tout intérêt ; le style même de Moravia, sobre, presque indifférent, paraît épouser le contour de choses réduites à la pure matérialité[v].
Par-là, c’est au sentiment d’une atmosphère de désenchantement que l’auteur rend sensible : s’il est impossible d’établir un rapport avec les choses, si les êtres échouent à communiquer, c’est que la réalité dans son ensemble apparaît – à l’instar de Cécilia – traversée par une absence, et donc comme insuffisante : « L’ennui pour moi est véritablement une sorte d’insuffisance, de disproportion ou d’absence de la réalité », déclare Dino. Reste donc à poser la question : de quoi cette absence est-elle le nom ?
Ennui et modernité
Pour répondre, on fera l’hypothèse que Moravia ne fait qu’exprimer, dans le cadre de son époque, la sensibilité moderne par excellence ; en décrivant les contours d’un monde dévitalisé, le romancier propose un texte de facture typiquement romantique : il exprime l’angoisse propre à la modernité, à toute la modernité.
Il n’est qu’à relever la résurgence du thème de l’ennui tout au long du XIXe siècle pour s’en convaincre : parmi d’innombrables exemples, on pourrait citer René, héros des Nachez de Chateaubriand, qui déclare à sa femme Céluta : « Je m’ennuie de la vie ; l’ennui m’a toujours dévoré » ; Oberman, qui, dans le roman éponyme de Sénancourt, se lamente : « l’ennui consume ma durée dans un long silence » ; Le Tasse dans les Œuvres morales de Léopardi, qui déplore que « La vie humaine n’est qu’un tissu de douleur et d’ennui » ; Musset, qui, dans la Confession d’un enfant du siècle, fait l’analyse de l’ennui, de « sentiment de malaise inexprimable » ; Altamira qui, dans le Rouge et le noir de Stendhal, déclare : « Il n’y a plus de passions véritables au XIXe siècle : c’est pour cela que l’on s’ennuie tant en France ».
« Cécilia est donc trop inhumaine pour ne pas revêtir une dimension mythique : elle incarne, à elle seule, tout ce que la réalité peut relever de non-sens. »
Quant au XXe siècle il n’est pas en reste : de ce « venin » qu’est « l’ennui de vivre » d’après Valéry, à « ceux qui crèvent d’ennui le dimanche après-midi parce qu’ils voient venir le lundi » d’après Prévert, en passant par « L’ennui fondamental d’exister » de Jankélévitch, le diagnostic paraît faire l’unanimité : ennui et modernité sont liés.
L’angoisse de la séparation
Toutefois, la particularité de Moravia consiste à se situer du côté de ceux qui rattachent l’ennui au problème de la communication ; l’auteur y insiste, Dino souffre de ne pas réussir à établir de contact avec les choses et les êtres. Il paraît donc opportun de lire L’ennui à la lumière de textes qui – comme chez Baudelaire et Kafka notamment[vi] – insistent sur le sentiment d’isolement et de séparation vécu par l’homme moderne[vii].
On comprend alors que c’est à la disparition d’un monde commun qu’il revient, certainement, d’avoir engendré celle de la communication. Comme si le surgissement de l’individu moderne, corrélat de la dissolution des communautés, avait créé la nostalgie d’une harmonie révolue, celle d’un monde où chaque personne s’éprouvait comme traversée d’une substance qui la reliait aux êtres et aux choses (c’est la communauté substantielle dont parle Hegel) ; d’un monde, donc, où tout est justifié d’avance par un ordre (divin ou naturel) transcendant, et où le problème de la communication ne se pose pas.
« Moravia exprime l’angoisse propre à la modernité, à toute la modernité. »
Or, c’est l’inverse qui paraît vrai aujourd’hui : si le surgissement de l’individu signe une libération de l’individu par rapport à la communauté, cette libération se paie d’un sentiment de coupure, ainsi que d’une apparente déréalisation du monde. Mais cette déréalisation, en réalité, n’est peut-être qu’apparente : si Dino se trompe lorsqu’il perçoit le monde comme absurde, ce n’est pas parce que le réel est irrationnel ; c’est plutôt que sa rationalité lui échappe.
L’ennui, une problématique de classe
On le comprendra si l’on ajoute que Dino, en raison de sa position de riche bourgeois romain, est certainement plus sujet qu’un autre à éprouver l’ennui. Car le vécu de la nécessité – celle qui lui manque si cruellement quand il s’ennuie – ne peut qu’échapper à un être qui ne travaille pas : son rapport au monde étant décorrélé d’une praxis, Dino échoue à communier avec un réel dans lequel il ne se reconnaît pas. Ainsi le narratif bourgeois, celui qui s’incarne dans les affres de Dino, exprime-t-il une inquiétude, celle du doute quant à la nécessité de sa propre existence.
À l’inverse, la production ouvrière et paysanne se situerait, elle, du côté du faire ; elle n’a pas donc pas à se soucier de justifier une réalité dont elle est l’être même, puisqu’elle la produit ; elle n’a, en un sens, pas d’autre discours que son faire. À quoi l’on peut ajouter que l’impératif de production, s’il est ce qui relie le monde au moi, implique également le relationnel : le rapport au monde est solidaire du rapport aux autres.
Or la culture bourgeoise, parce qu’elle est repose sur un agir avorté, signe le vécu de l’isolement : elle relève quant à elle moins de l’être que du discours sur l’être, et vire à la glose de sa propre existence. Une glose qui, inévitablement, aboutit à l’impasse : l’impossibilité de se justifier débouche toujours sur l’ennui. Il serait donc vain de dissoudre cette névrose en une problématique œdipienne : si Dino fuit sa mère, il souffre – d’abord – de son être de classe, parfaitement incarné par elle. Inconscient de l’inconscient !
Loin d’avoir disparu, l’ennui paraît donc solidaire d’une condition qui, aujourd’hui encore, est la nôtre. On pourra certes invoquer les multiples pôles d’attraction en usage, et dont tous les hochets visent à nous divertir ; on niera cependant difficilement que ces derniers peinent à combler le manque constitutif de l’homme moderne. Qui ne voit que, dans un monde dit hyperconnecté, chacun ne cherche pourtant qu’à à se re-connecter (avec lui-même et, entend-on souvent, la nature) ? Mais de quel lien manquons-nous, sinon de celui qui nous lie aux autres dans l’héritage d’une praxis commune ?
Pierre Soubiale
Nos Desserts :
- Sur Le Comptoir, lire notre article « De la théatrocratie du pouvoir à la société de communication »
- Nous nous étions entretenu avec Dominique Pagani à propos de son ouvrage Féminité et communauté chez Hegel
- Émission « Alberto Moravia (1907-1990), l’équilibriste » sur France Culture
- « L’ennui du voyageur Moravia » par Nelly Fray
Notes
[i] Walter Benjamin, Le raconteur, 1936.
[ii] Préface à L’ennui, GF, 2023.
[iii] C’est ce dont témoigne par exemple l’échange suivant, initié par Dino : « – Ton père malade ? – Oui – De quoi est-il malade ? – D’un cancer. – Que disent les médecins ?- Ils disent qu’il est malade d’un cancer.- Non, je veux dire : pensent-ils qu’il puisse guérir ? – Non, ils disent qu’il ne peut pas guérir. – Alors, il va bientôt mourir ? – Oui, ils disent qu’il va mourir d’ici peu. – Cela te fait de la peine ? – Quoi ? – Que ton père meure -Oui (…). »
[iv] « les mouvements de son ventre qui, à mesure que l’étreinte acquérait rythme et force, se faisaient de plus en plus fréquents, avaient la puissance et la régularité d’un mécanisme désormais déchaîné qu’il ne dépendait ni de moi ni d’elle d’arrêter ».
[v] Voir, par exemple, Cécila qui décrit des meubles.
[vi] Le poème La cloche fêlée de Baudelaire et le texte d’Un message impérial de Kafka se démarque par leur insistance sur le sentiment d’isolement vécu par l’homme moderne.
[vii] Voir, sur ce point, les analyses de Dominique Pagani sur la solitude de l’homme moderne dans Pagani sans détours, éd. Delga, pp. 148-149
Catégories :Culture