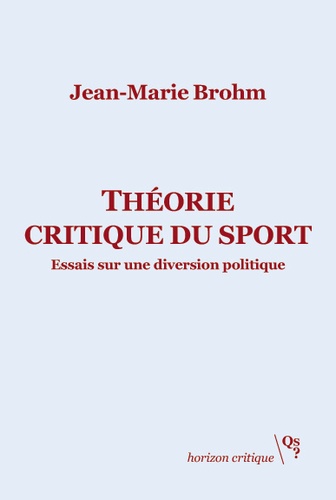Quels liens unissent le yogi amateur au footballeur professionnel, le cycliste du dimanche au champion de NBA pour qu’il soit possible de faire rentrer indistinctement cette multitude de pratiques dans une seule et même catégorie : celle du « sport » ?
Qu’est-ce que le sport ? Cette question prête à sourire tant elle nous paraît évidente : il s’agit d’une pratique mettant le corps à contribution, pouvant se pratiquer seul ou en équipe, reconnue pour ses bienfaits corporels… Le corps est donc fondamental dans la définition que nous nous donnons du sport.
Mais est-ce seulement cela, le sport ? Tel qu’il nous apparaît, le sport fait figure de vérité transhistorique, pratiquée de tout temps et en tous lieux, un « fait social total » au sens de Mauss, qui « met en branle […] la totalité de la société », une immense positivité indiscutable à laquelle personne n’échappe. Et il n’est pas un dirigeant politique – de l’URSS aux États-Unis en passant par l’Allemagne nazie – qui ne s’affirme contre le sport : tous, sans exception, célèbrent à l’unisson le sport et ses innombrables vertus : l’amitié entre les peuples, la vitalité de la nation, le fair-play…
C’est précisément cette unanimité qui nous le rend suspect, et doit nous amener à questionner l’ « objet sport ». Il faut dès lors s’interroger sur ses angles morts, ses impensés, ses « valeurs »… Se demander qu’est-ce que le sport ? impose d’abord un détour par l’histoire dans le but de déconstruire un objet naturalisé à tel point qu’il nous est devenu difficile de le saisir dans toute sa complexité. Le sport a-t-il toujours eu la forme qu’on lui connaît ? Ses valeurs ont-elles évolué dans le temps ? Et si oui, comment ?
Nous verrons que l’histoire du sport épouse celle du capitalisme et de l’industrialisation, que sports d’hier et d’aujourd’hui ont finalement peu de choses en commun, pour finir nous nous demanderons si une autre pratique du sport ne correspondant pas à sa définition hégémonique est possible. Mais d’abord, remontons le temps.
Le sport : une pratique intemporelle ?
Longtemps, la lecture dominante chez les historiens du sport fut celle d’une continuité historique entre pratiques anciennes et modernes, qualifiant de « sport » les jeux de l’Antiquité comme du Moyen Âge. Le baron de Coubertin contribuera à alimenter ce récit en inscrivant les premiers Jeux olympiques de l’ère moderne – inaugurés en grande pompe en 1896 à Athènes – dans la filiation directe des jeux d’Olympie.[1]
Si des activités sportives furent bel et bien pratiquées de tous temps dans l’histoire, et que certaines pratiques peuvent s’apparenter à des formes modernes de sport, à l’image de la soule, jeu traditionnel considéré comme l’ancêtre tout à la fois du football et du rugby, il existe des différences fondamentales entre le sport – au sens moderne du terme – et ce que certains appellent les « jeux traditionnels ».
Chartier et Vigarello expliquent ainsi que la pratique de la soule était « toujours transposition, mise en scène ou en jeu de différences et de clivages qui sont donnés d’avance. »[2] Chaque partie s’organisait selon les divisions existantes du corps social, que l’on peut résumer à trois oppositions fondamentales : entre paroisses voisines, entre deux partis ou deux bandes, enfin entre célibataires et hommes mariés d’un même village.
La plupart du temps les parties ne se déroulaient pas à n’importe quel moment de l’année, mais s’inscrivaient et s’organisaient en fonction du temps religieux, avec « pour temps de prédilection les cycles de Noël et de Carnaval »[3], ou, lorsqu’elles se déroulaient à une date sans signification particulière, c’était toujours après les messes ou les vêpres.
Le jeu traditionnel se déroulait dans les lieux de l’existence ordinaire sans qu’un endroit soit fixé une fois pour toutes, c’était ainsi tout l’espace communautaire qui était en mesure d’être investi : « on « croche » (= lutte) près des églises, on « choule » sur les grèves ou les chemins, on « boule » à côté des maisons. »[4] Si le jeu était profondément ancré à l’espace géographique et social, ses règles variaient également d’un lieu à l’autre, le nombre de participants, la durée du jeu, les règles ou les objets utilisés différant « d’une région à l’autre, d’une communauté à l’autre, voire d’une partie à l’autre ».[5]
« Il existe des différences fondamentales entre le sport – au sens moderne du terme – et ce que certains appellent les « jeux traditionnels ». »
L’éthique sportive et l’esprit du capitalisme
Portée par le sociologue Jean-Marie Brohm, la théorie critique du sport constitue sans conteste le courant de pensée ayant le plus systématisé la dimension politique du sport. Ainsi, la différence fondamentale entre sport moderne et antique réside dans la notion de performance, illustrée par la devise olympique : « Citius, Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, plus fort). Il s’agit d’encourager au dépassement de soi, à « la violence, l’excès, l’imprudence » pour reprendre les mots du baron de Coubertin, et, finalement, à la glorification des forts et l’écrasement des faibles.
Absente de la culture antique, la notion de performance entraîne subséquemment un rapport différencié au corps envisagé dès lors comme une machine de rendement qu’il s’agit de faire fructifier. Miroir aux alouettes, l’idéologie sportive est travestie sous l’apparence du simple divertissement, sorte de cheval de Troie agissant comme une entreprise de légitimation de l’ordre capitaliste. Pour paraphraser Debord, on pourrait affirmer que le sport se présente comme une immense positivité indiscutable qui inonde toute la surface du globe.
Cette similitude ne doit rien au hasard puisque le sport moderne émerge dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, berceau du capitalisme et de l’industrie, du marché et de la marchandise, raison pour laquelle, à l’image de l’ouvrier d’usine, le sportif est chronométré, évalué, soumis à une injonction permanente de toujours plus de performance, à une division du travail le contraignant à se spécialiser, chacun de ses gestes est scruté, décomposé, disséqué afin d’être rendu plus efficient, rentable. De fait, les premiers clubs sportifs voient le jour au sein des entreprises pour qui il s’agit tout autant d’un moyen d’occuper les travailleurs pendant leur temps libre que d’assurer un esprit de corps et de compétition, inculquer un système de valeurs et de conduites, ainsi qu’une meilleure identification à l’entreprise.
Cette quête de toujours plus de performance se paye au prix de la santé des athlètes : repousser sans cesse les limites physiques impose en effet un « coup de pouce chimique ».[6] Loin de constituer un épiphénomène circonscrit à quelques brebis galeuses, le dopage est consubstantiel d’une industrie avide de profits où prime l’augmentation du rythme des compétitions, et où la fabrique de « surhommes » se doit de tourner à plein régime afin d’assurer la perpétuation des records : show must go on.
Comme l’exprimait Eduardo Galeano au sujet du foot spectacle : « Dans le football, comme ailleurs, le sport professionnel est plus dopé que les sportifs eux-mêmes. C’est lui, grand intoxiqué, converti en grande entreprise de l’industrie du spectacle, qui accélère toujours plus le rythme de travail des athlètes et les pousse à ravaler leurs scrupules pour atteindre des rendements de surhommes […] C’est l’impératif de gagner à tout prix qui oblige à consommer les drogues de la réussite. »[7]
Pour autant, on passerait à côté de l’essentiel si on oubliait de considérer le sport comme une activité physique institutionnalisée[8], c’est-à-dire portée par des fédérations qui s’arrogent le droit d’imposer leurs conditions pour la tenue d’une compétition (CIO, FIFA…). Ainsi le sport entraîne une structuration du temps et de l’espace. Le temps de la compétition remodèle l’espace urbain à travers son appropriation par les entreprises privées (affichages, messages publicitaires…), l’expropriation des résidents d’un quartier pour y édifier des équipements sportifs (la « rénovation urbaine »), mais aussi sa militarisation[9] : l’espace public se métamorphose alors en une « immense société du spectacle de la compétition généralisée ».[10]
Formidable machine à cash, le sport autorise tous les excès : corruption, violence, dopage… Il dispose d’une temporalité propre au travers de compétitions toujours plus nombreuses et médiatisées, de même qu’il est sa propre fin : celle d’une célébration infinie de ses « valeurs ».
« Pour paraphraser Debord, on pourrait affirmer que le sport se présente comme une immense positivité indiscutable qui inonde toute la surface du globe. »
Le sport moderne institutionnalisé s’apparente donc à un spectacle, c’est-à-dire produit non pas par le peuple, mais pour le peuple, une marchandise de masse qui crée un « public socialement situé et intrinsèquement absent de la pratique »[11] réduit au rôle de simple spectateur, de consommateur. Et, si les dirigeants politiques entrevoient la tenue d’un grand événement sportif sur leur territoire comme une occasion d’insuffler parmi la population un élan à la pratique sportive, force est de constater que ceux qui consomment le plus de sport sont aussi ceux qui pratiquent le moins : le supporter de foot est bien souvent celui qui y joue le moins.[12]
Un sport populaire est-il possible ?
Est-il cependant possible d’imaginer un sport qui soit réellement populaire, c’est-à-dire qui ait trait au peuple et représente le plus grand nombre ? Si la théorie critique du sport s’avère on ne peut plus salutaire, mettant en lumière de manière implacable la logique capitaliste à l’œuvre dans l’entreprise sportive, celle-ci souffre cependant de sa systématicité et de sa vision élitiste qui tend à considérer les individus comme de simples spectateurs passifs dépourvus de tout esprit critique, incapables de capacités de résistance face à la machinerie capitaliste, ni même d’usages distanciés du sport. S’il est indéniable que l’esprit sportif jouit d’une capacité inouïe à propager les valeurs capitalistes dans la société, il faut cependant distinguer ce que le sport fait aux gens de ce que les gens font avec le sport.
Certes le sport spectacle constitue une formidable machine à générer du profit, mais la frontière entre sport spectacle et sport populaire n’est cependant pas étanche. Ainsi, un club comme le FC Barcelone illustre à la fois les pires dérives du foot business avec ses joueurs multi-millionnaires et son immense empire médiatique, tout en ayant constitué un haut lieu de la résistance culturelle durant la dictature franquiste, et continue aujourd’hui à jouer un rôle important dans la lutte indépendantiste catalane ou comme symbole pour de nombreux palestiniens s’identifiant à cette lutte.
Le stade peut ainsi faire office de tribune politique, du slogan ACAB des supporters anglais des eighties aux ultras égyptiens scandant des chants hostiles au régime annonciateurs du printemps arabe, les gradins sont un exutoire reflétant les tensions au sein d’une société.[13]
D’autre part il est indéniable que la pratique sportive permet une forme d’émancipation. Le Parti communiste va s’impliquer dès le début du XXe siècle dans la lutte contre l’accaparement du sport par le patronat en créant des fédérations sportives : le congrès de l’Internationale de 1921 affirme que le sport est un moyen au service de la lutte des classes dont le but est le renversement du capitalisme. L’horizon révolutionnaire s’estompant avec l’avènement du franquisme dans les années 30, l’objectif sera désormais d’étendre la pratique sportive au plus grand nombre en affirmant un « droit au sport » pour tous : les maires communistes octroient des subventions aux clubs locaux, allouent des budgets importants pour la construction d’installations sportives ou l’organisation de manifestations sportives…[14]
Si le sport peut constituer un instrument d’émancipation, ses vertus intégratrices sont cependant à relativiser. Ainsi, si l’on prend les seuls exemples de la boxe et du basket-ball, soit deux disciplines souvent présentées comme offrant un espoir d’ascension sociale aux jeunes issus des classes populaires, la plupart de ceux qui réussissent ne proviennent pas des fractions les plus précarisées de la classe ouvrière mais sont issus de familles où le père exerce un emploi « stable », préalable nécessaire afin de s’adapter « aux rigueurs de l’entraînement au quotidien, qui exige stabilité personnelle, frugalité et embrigadement »[15], et dans le cas de la NBA la majorité des joueurs compte un parent sportif professionnel.[16]
Les salaires astronomiques des sportifs les plus médiatisés ne doivent non plus pas faire oublier une autre réalité : nombre de sports « amateurs » sont beaucoup moins rémunérateurs, à l’instar du judo ou de l’escrime, et, lors des JO de Rio, la moitié des 450 athlètes de la délégation française vivait avec moins de 500 euros par mois.[17] La pratique sportive professionnelle ne met donc pas nécessairement à l’abri de conditions d’existence parfois précaires.
« Le congrès de l’Internationale de 1921 affirme que le sport est un moyen au service de la lutte des classes dont le but est le renversement du capitalisme. »
La pratique amateure constitue sans doute un remède au sport moderne, et permet de « déspectaculariser » ce dernier. La pratique du foot de rue renoue par exemple sur certains aspects avec les jeux traditionnels : celui-ci peut se pratiquer partout, n’importe quand, avec des cages ou un ballon improvisé…
Le roller derby offre une illustration de ce que pourrait être un sport populaire, inclusif et émancipateur. Intimement lié au mouvement féministe, ce sport est uniquement pratiqué par des amateurs et offre une possibilité d’empowerement aux personnes LGBT, rompant avec les injonctions à une féminité unidimensionnelle promue par le capitalisme patriarcal. Ce sport se distingue également dans sa gouvernance, question ô combien essentielle tant la démocratie s’arrête souvent aux portes des fédérations : la Women’s Flat Track Derby Association, fédération qui chapeaute plus de 400 ligues à travers le monde, fonctionne sur le modèle de l’autogestion, gérée par les athlètes elles-mêmes.
Le sport est politique
Lorsque le Président Macron affirme qu’ « il ne faut pas politiser le sport » suite aux appels au boycott du mondial de football au Qatar, celui-ci – par ignorance ou par mauvaise foi – fait fausse route : loin de constituer uniquement une pratique mettant le corps à contribution, le sport est politique. À l’image de Janus, il revêt deux visages : à la fois spectacle issu du capitalisme marchand décrit par les auteurs de la théorie critique du sport ; mais également vecteur d’émancipation comme a pu le défendre le Parti communiste et que l’on peut aujourd’hui retrouver dans une discipline comme le roller derby.
« La pratique sportive professionnelle ne met donc pas nécessairement à l’abri de conditions d’existence parfois précaires. »
Si le sport est intimement lié à la guerre comme l’observait Orwell en son temps, qui, suite à la tournée anglaise du Dynamo de Moscou en 1945, vilipendera l’« esprit sportif » et la soi-disant amitié entre les peuples que le sport serait censé susciter, celui-ci n’étant à ses yeux ni plus ni moins qu’« une guerre, les fusils en moins »[18], il participe également d’un processus de civilisation qu’Elias mettait en exergue, à l’image de la « diplomatie du ping pong », témoignage de la normalisation des relations sino-étasuniennes, ou de la France « black-blanc-beur » triomphant de la fracture sociale.
La trajectoire du sport illustre la tendance du capitalisme à tout recycler en un instrument de profits (droits de rediffusion, équipementiers, paris sportifs…) et comme moyen d’assurer son hégémonie (culte de la performance). Reste que si nous avons pu – en partie – mettre à jour le sport sous ses différentes dimensions, une question cependant demeure : un sport réellement populaire qui ne soit pas confiné aux marges est-il possible dans une société capitaliste ?
Nos Desserts :
- Pour George Orwell « Au niveau international le sport est ouvertement un simulacre de guerre »
- Lire notre analyse sur « La lutte des classes sur le terrain de football »
- Ainsi que notre portrait de « Maradona : Le football du peuple, par le peuple et pour le peuple »
- Lire aussi notre papier « Le sport est mort »
Notes
[1]Terret, Thierry. Histoire du sport. Presses Universitaires de France, 2011
[2]Chartier Roger et Vigarello Georges, « Les trajectoires du sport » Pratiques et spectacle, Le Débat, 1982/2 n° 19, p. 35-58.
[3]Ibid.
[4]Ibid.
[5]Ibid.
[6]Christian De Brie, « Comment on fabrique des « champions » », Le Monde diplomatique, 1992, pp. 28-29.
[7]Eduardo Galeano, « Le sport chimique », Le Monde diplomatique, 2001, p. 23.
[8]Vassort, Patrick, « Pour une Théorie critique de l’institution sportive », Staps, vol. 143, no. 5, 2023, pp. 123-140.
[9] Thomas Jusquiame, « Des villes verrouillées au nom de la sécurité », Le Monde diplomatique, janvier 2024, p. 21.
[10]Jean-Marie Brohm.,« Pernicieuse idéologie », « Manière de voir », numéro 30, mai-juin-juillet 1996.
[11]Chartier Roger et Vigarello Georges, « Les trajectoires du sport », Pratiques et spectacle, art. cit.
[12]Philippe Descamps, « Introuvable ruissellement du sport d’élite », Le Monde diplomatique, mai 2024, p. 11.
[13] « Mickaël Correia : « le football : un instrument d’émancipation » », Revue Ballast, 28 avril 2018
[14]Igor Martinache, « Le sport populaire : oxymore ou idéal ? », Revue Ballast, 14 mars 2023
[15]Loïc Wacquant, « La vie et l’honneur des boxeurs américains », Le Monde diplomatique, août 2022, pp. 6-7.
[16]Julien Brygo, « Le rêve américain au miroir du basket-ball », Le Monde diplomatique, juin 2017, pp. 4-5.
[17]Medias, « JO : la moitié des sportifs français vivent sous le seuil de pauvreté », Le Point, 20 mai 2016
[18]« George Orwell : « Au niveau international le sport est ouvertement un simulacre de guerre » », Le Comptoir, 26 juin 2016
Catégories :Société