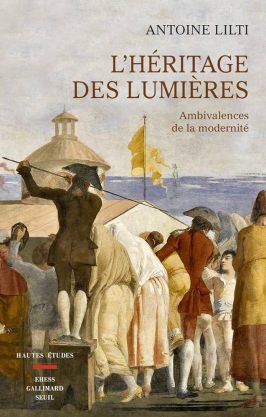L’été 2023 a malheureusement vu ressurgir des scandales liés aux pratiques policières, mettant en évidence la brutalité des répressions, la culture du secret, la solidarité corporative et, en fin de compte, l’impunité dont jouissent certains agents. Or, les récents événements, dont en particulier les affaires Naël, Hedi et Mohammed, s’inscrivent dans une continuité de violences structurelles qui, bien loin d’être nouvelles, réveillent les tensions profondes qui sous-tendent les relations entre la population et l’institution chargée de sa protection.
Pour saisir la véritable essence du système policier et comprendre les enjeux des conflits contemporains entre la police et sa population, il est essentiel de remonter aux origines mêmes de cette institution. Quelle est la philosophie qui a présidé à sa création ? Comment s’est renforcé la police ? Quels sont les rapports de force qui la traversent ? Nous explorerons ici la philosophie modernisatrice et rationalisatrice qui a guidé la création de la lieutenance générale de police au XVIIe siècle, ainsi que les formes concrètes prises par ce système policier moderne.
La « police », un horizon d’attente de la monarchie
Il s’agit dans un premier temps de considérer la notion de « police » dans son sens historique. Depuis l’Antiquité, le terme « police », dérivé du grec « politeia », revêt une signification multidimensionnelle : il englobe à la fois le gouvernement, la sécurité publique et l’administration des villes au sens large, incluant l’approvisionnement alimentaire, l’hygiène et l’organisation des mobilités. Sous l’Ancien Régime, les autorités adoptent cette acception et, tout comme le concept de « Bien Commun », la « police » devient l’un des piliers structurants du pouvoir monarchique, reflétant un idéal social et politique basé sur l’ordre. Pour parvenir à l’idéal d’une société ordonnée et disciplinée, la monarchie possède dès lors le pouvoir d’établir des normes, que ce soit sous forme d’édits (concernant des sujets spécifiques) ou d’ordonnances (portant sur des domaines plus vastes).
Ce pouvoir de régulation sociale repose en partie sur un arsenal théorique résultant de la redécouverte du droit romain par les universitaires médiévaux. Dès le XIIe siècle, notamment à l’université de Bologne, des juristes revitalisent le concept de souveraineté impériale. Cela signifie que le dirigeant, qu’il soit empereur, roi ou prince, détient le pouvoir d’agir sur la société. Aux XIIIe et XIVe siècle, une renaissance du pouvoir législatif d’origine romaine s’observe alors en Europe occidentale ; le roi, se proclamant princeps et imperator, exerce dorénavant une prérogative autrefois réservée à l’Empereur romain. Des juristes de la Renaissance, à l’instar de Jean Bodin (Res publica, 1576), reprennent cet idéal politique pour légitimer le pouvoir absolu du roi. Reste qu’en théorie ce pouvoir absolu de la monarchie est limité par les lois fondamentales du royaume (telles que la succession héréditaire au trône, l’inaliénabilité du domaine royal) et la présence de corps intermédiaires (tels que les parlements, les états provinciaux, villes ou encore les corporations de métiers).
Particulièrement, la véritable rupture en matière de réflexions sur la police trouve son origine au XVIIe siècle, dans le contexte de l’absolutisme et de l’affirmation d’une volonté visant à instaurer l’ordre au sein de la société. Cette période se caractérise en effet par une intensification de l’autorité royale, dynamique qualifiée d’absolutiste par la plupart des historiens. Sous l’influence de personnalités telles que Richelieu (ministre de 1624 à 1642), Mazarin (ministre de 1642 à 1661), et tout particulièrement durant le « règne personnel » de Louis XIV (1661-1715), le pouvoir de l’État, personnifié par le roi, s’immisce de manière de plus en plus profonde dans l’organisation et la gestion de la société au sens large. Cette montée en puissance du pouvoir royal se traduit d’abord par une augmentation et une multiplication des impôts directs et indirects : le « tour de vis fiscal », initié sous Richelieu, dans les années 1630, qui conduit à un triplement de la fiscalité. Cela se traduit également par un renforcement de la surveillance des déplacements à travers la création du passeport durant le règne de Louis XIV, qui vise à surveiller les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du royaume. De surcroît, à partir de 1690, un impôt spécifiquement destiné aux étrangers est instauré, conditionnant désormais la reconnaissance en tant que sujet du roi à la justification de la présence de ses ancêtres dans le royaume depuis au moins quatre-vingt-dix ans.
Purifier, classer, quantifier : le tryptique de la modernité
Au-delà de l’absolutisme, les actions politiques et urbanistiques des XVIIe et XVIIIe siècles reflètent l’influence des premières théories hygiénistes. Ces théories consistent à envisager les pratiques sociales en se fondant sur des prescriptions et des règles médicales. Cela se traduit par une volonté croissante d’aérer les villes et d’assurer une salubrité améliorée. Dès le Moyen Âge, de nouvelles conceptions médicales inspirées par la redécouverte de la théorie des humeurs de Gallien suggèrent en effet de rétablir un équilibre des humeurs dans la ville, la concevant comme un organisme humain. L’une des répercussions sociales de ces théories, visant à purifier l’espace public de ses éléments nuisibles, est l’exclusion des marginaux (comme les vagabonds et les prostituées), au nom de la préservation de l’ensemble urbain et de la lutte contre les facteurs de maladies.
« La morale de l’assistance et de la charité, qui avait dominé les représentations depuis l’époque médiévale, semble céder du terrain à une philosophie de l’ordre et de la purification de l’espace. »
Comme l’a démontré Michel Foucault dans son ouvrage sur l’histoire de la folie à l’âge classique (1963), cette période voit également se développer un classement croissant des individus, processus renforcé par l’émergence des sciences naturelles, notamment la taxinomie de Linné au XVIIIe siècle, qui vise à classer les organismes vivants. Cette philosophie du classement trouve son application dans la réforme des hôpitaux, avec l’avènement en France, au XVIIe siècle, des premiers Hôpitaux généraux, d’immenses institutions de confinement et de mise au travail des populations perçues comme marginales, institution caractéristique de la période dite du « grand renfermement des pauvres » (Histoire de la folie, 1965). Plus précisément, ces hôpitaux généraux possèdent une double mission, à la fois caritative et sécuritaire, visant à accueillir, de gré ou de force, diverses populations marginalisées, telles que les mendiants, les vagabonds, les fous, les orphelins, les prostituées, les infirmes et les personnes atteintes de maladies vénériennes. À Paris, l’hôpital de Bicêtre pouvait par exemple accueillir jusqu’à 3000 résidents, de même que l’hôpital de la Salpêtrière, qui était lui destiné aux femmes. De plus, toujours à mettre en relation avec cette dynamique d’exclusion des marginaux, il convient également de considérer les politiques d’envoi de prostituées et de vagabonds en Nouvelle-France et en Louisiane au début du XVIIIe siècle. Pensons ici aux passages de Manon Lescaut qui relatent les départs forcés de prostituées de la Salpêtrière vers la Louisiane, sous la Régence (1718-1721) ou surtout à ces sources hospitalières et policières qui attestent de ces envois, manu militari, de femmes et d’hommes, dont les élites parisiennes ne supportaient de moins en moins la vue dans l’espace public des grandes villes. Le triage, le classement et, in fine, la mise en ordre des populations marginales semble être devenu, à partir du XVIIe siècle, le nouveau paradigme dominant des politiques d’assistance. La morale de l’assistance et de la charité, qui avait dominé les représentations depuis l’époque médiévale, semble céder du terrain à une philosophie de l’ordre et de la purification de l’espace public, à partir de ce que Michel Foucault appelle « l’âge classique », qu’il fait débuter au XVIIe siècle.
N’oublions pas non plus que cette rationalisation de l’assistance résulte également d’un affinement des connaissances scientifiques, à l’époque dite des « Lumières », au XVIIIe siècle. Dans la continuité de « l’âge classique », l’utilisation de la cartographie et des statistiques se répand jusque dans les sphères politiques. Les cartes deviennent plus précises et les populations sont quantifiées de manière plus minutieuse ; les dispositifs répressifs puisent ici dans les outils de la modernité scientifique. À cet égard, comme l’a conclu Antoine Litli, dans L’héritage des Lumières (2019), il ne fait aucun doute qu’une certaine interprétation de la philosophie des Lumières a pu justifier des forces de pouvoir et d’exclusion au nom du primat de la science et du progrès. Mais comme le souligne aussi l’auteur, cette interprétation répressive des Lumières ne doit pas masquer la grande pluralité des Lumières et de leurs visions de l’Homme et de la société. Il apparait aussi nécessaire de souligner, à l’instar du travail récent de Laurence Fontaine, l’existence, minoritaire au XVIIIe siècle, de réformateurs des Lumières attachés à la dignité humaine et pour qui la coercition et la répression ne sont pas des réponses absolues au problème de la pauvreté. La fin du XVIIIe siècle voit aussi émerger les premières réflexions de type sociologique ainsi que des recherches visant à comprendre les causes sous-jacentes de la pauvreté.
Cette volonté de purifier l’espace public renforce donc l’idée d’une philosophie de l’ordre qui imprègne les représentations politiques, en particulier à partir du XVIIe siècle. Au-delà des discours politiques et philosophiques sur l’ordre, il est désormais nécessaire d’examiner les formes concrètes prises par cette construction policière.
Du millefeuille institutionnel à la centralisation policière
Il nous faut étudier, dans ce second temps, la situation antérieure à la réforme du XVIIe siècle, marquée par l’héritage médiéval et le poids des anciennes juridictions, puis la forme concrète prise par la construction policière.
Tout d’abord, si le tableau d’une France médiévale anarchique, dans laquelle le roi peinerait à imposer son autorité sur une population livrée aux luttes de pouvoir entre ses différents pouvoirs traditionnels doit être nuancé, il convient de rappeler, qu’effectivement, le pouvoir régalien, incarné par le roi, disposait d’une marge de manœuvre politique assez faible, encore au début de l’époque moderne. En cela, la France rurale est marquée par la grande autonomie des seigneurs, disposant de larges pouvoirs judiciaires, pondérés par la disposition, par le roi, depuis Louis IX, d’une justice en dernier ressort. De fait, le maintien de l’ordre régalien était quasiment inexistant, si l’on excepte les 3 000 cavaliers de la maréchaussée, au XVIIIe siècle, agents royaux, ancêtres de la gendarmerie, chargés d’intervenir sur les grands chemins et réprimer le vagabondage – force dérisoire si l’on pense que ces cavaliers doivent agir pour l’ensemble du royaume. Le maintien de l’ordre, dans les campagnes, était assuré par des agents du seigneur, baillis ou prévôts seigneuriaux, assisté d’hommes de main mais. Dans les campagnes, l’infrajudicaire, qui consiste en une justice non-institutionalisée exercée par les populations elles-mêmes, qui se manifeste par des actes de vengeance ou de négociations informelles, est encore très prégnant.

RAGUENET Nicolas Jean-Baptiste, Le Louvre, le Pont-Neuf et le quai des Orfèvres, vus du quai des Grands-Augustins, vers 1760, peinture à huile, Musée Carnavalet, Histoire de Paris
En ville, il n’existe pas non plus de cadre homogène, à la fin de l’époque médiévale et le pouvoir régalien n’était guère plus puissant qu’en campagne. Une dynamique d’autonomisation des ville, débutée au XIIe siècle, consacre en effet un large pouvoir judiciaire aux municipalités, qui disposent, de ce fait, de leur propre personnel policier : des chevaliers du guet, aidés par la milice, c’est-à-dire des bourgeois servant dans la protection de leur ville. De surcroit, la plupart des villes s’apparentent alors à des mosaïques institutionnelles, divisées entre plusieurs seigneurs (laïcs ou ecclésiastiques), maîtres de portions, plus ou moins grandes, de la ville. Ainsi est-il de la situation parisienne, enchevêtrée entre une multitude d’autorités seigneuriales. Concrètement, en vertu du droit féodal, Paris est divisé en fiefs, à l’instar des campagnes. Ainsi, Paris est maillé de nombreuses seigneuries ecclésiastiques (l’abbaye de Saint-Germain des Prés, l’abbaye de Sainte-Geneviève) et quelques seigneuries laïques : vingt-trois seigneuries ecclésiastiques deux seigneuries laïques. Enfin, le roi était lui-même seigneur d’une petite zone, dans le centre de Paris : le quartier du Châtelet, où était établi un tribunal royal. À ces fiefs sont rattachés des droits de justice, qui se manifestent par la présence de prisons, de juges seigneuriaux, dans chaque seigneurie, même les plus petites. Aux frontières des différentes seigneuries, des conflits de juridiction sont fréquents et il est souvent compliqué pour les justiciables de savoir précisément à quels juges s’adresser. En 1674, la monarchie décide ainsi de supprimer les justices seigneuriales avec l’idée que partout doit s’exercer la justice du roi. Cette suppression suscite de très vives résistances et la monarchie accepte finalement de rétablir certaines justices ecclésiastiques. Dans cette situation profondément complexe et difficilement intelligible pour les populations elles-mêmes, le maintien de l’ordre dans les villes, et en particulier à Paris, est donc encore très perfectible.
« Quasiment sans limite, la violence des répressions s’abat sur les corps, brisés et fustigés par les coups de verge des agents du commissaire de police. »
Face à cette mosaïque juridictionnelle, la monarchie tente, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, de réaffirmer son autorité. Effectivement, après les heurts de la Fronde (1648-1653), qui avaient vu éclater une véritable guerre civile, la réapparition de la peste, l’augmentation de l’insécurité et de la misère à Paris, la monarchie fait de la lutte contre les désordres un objectif politique, autant qu’un élément de son discours de renforcement de son autorité. La capitale est en cela pensée comme un laboratoire de la reprise en main politique de la monarchie, aussi bien sur le plan de l’embellissement, de l’assainissement et du perfectionnement de l’ordre public. Dans les années 1660, Paris est alors décrite comme une ville à l’insécurité chronique et pâtit d’une image de « capitale du crime » renforcée par l’assassinat par des truands, en 1665, en plein de cœur de l’île de la Cité, d’un haut responsable de justice parisien, Tardieu. Cela constitue le crime de trop pour Louis XIV qui décide alors de bouleverser le fonctionnement de la police à Paris. La monarchie, à l’initiative du ministre Jean-Baptiste Colbert, expérimente un conseil pour la police de Paris en 1666 qui comprend plusieurs ministres, des grands commis de l’État dans la perspective de réfléchir aux solutions pour réformer la police de Paris.

Dessin anonyme daté de la fin du XVIIIe siècle représentant le tribunal du Châtelet, siège de la justice royale
En 1667, est donc mise sur pied une administration policière renouvelée, chapeautée par un personnage très puissant : le lieutenant général de police. Cette charge de lieutenant de police n’est pas un office vénal, c’est-à-dire que l’on peut acheter et revendre, mais est une charge confiée directement par le roi et potentiellement révocable. Ce lieutenant général de police, pensé comme un administrateur de Paris, a des missions très diverses : la direction des audiences de police, la préparation de textes législatifs, la collecte d’information auprès de personnes arrêtée à la Bastille, la réception des plaintes des habitants et des familles qui souhaitent enfermer un de leur membre, l’information au roi de la situation à Paris etc. Cette confiance du roi à l’égard de son officier se traduit par la délégation de lettres de cachet en blanc qui permettent de décider l’emprisonnement d’un individu en dehors de toute procédure judiciaire : le lieutenant général de police a le pouvoir effectif d’arrêter tout individu dont il estime qu’il représente une menace pour l’ordre public à Paris, ce qui lui confère un rôle politique immense.

Portrait de Gabriel-Nicolas de La Reynie (1625-1709), premier lieutenant général de police de 1667 à 1709, peint par Nicolas Mignard
Pour mener à bien ses missions, le lieutenant général de police a sous sa direction des subordonnés : les commissaires du Châtelet et des inspecteurs. Ainsi, il y a dans Paris une quarantaine de commissaires qui relèvent du Châtelet – ils étaient moins de dix à l’époque médiévale. Souvent recrutés parmi d’anciens militaires, les commissaires ont à leur charge un quartier de Paris. Concrètement, ces hommes reçoivent les plaintes des habitants, répondent à certaines tâches civiles (signature de contrats, respect des normes par les communautés de métiers) et peuvent mener des enquêtes criminelles, rémunérées à la tâche. Certains commissaires des responsabilités dans des domaines particuliers à l’échelle de tout Paris ; il y a un commissaire de Police qui s’occupe par exemple de la surveillance des prostituées ou des spectacles. De manière quotidienne, les commissaires doivent rendre compte de leur journée au lieutenant général de police. Très vite, il apparaît que ces commissaires sont débordés par leurs différentes missions et pointe la nécessité de leur adjoindre des inspecteurs, pour les aider dans leurs tâches criminelles. Il existe en effet à partir de 1709 entre vingt et quarante inspecteurs, selon les années.
À la différence des commissaires, les inspecteurs portent l’épée et sont plus mobiles sur le terrain. Ils ont pour mission de capturer des individus, parfois avec violence, d’inspecter le nettoyage des rues et de surveiller les lieux d’hébergement, en particulier les garnis, considérés comme des lieux interlopes où se retrouvent une population flottante, considérée comme dangereuse. Aussi bien les commissaires que les inspecteurs peuvent avoir recours à des indicateurs (des « mouches »), dont le nombre est estimé à 3 000 à Paris vers 1750. Recrutés au sein du milieu des petits malfaiteurs, ces indicateurs sont chargés d’identifier les têtes des réseaux criminels. Enfin, sous la direction d’un chevalier du guet, une centaine de sergents à verge (qui possèdent un bâton à fleur de lys), recrutés parmi les bourgeois de Paris, parcourent les rues pour maintenir l’ordre. Ceux-ci peuvent être mobilisés par les commissaires et les inspecteurs, lors de leurs différentes interventions.
« Copie de la lettre écrite à Messieurs les syndics, ce 14 décembre 1776.
Il est nécessaire, Messieurs, pour que l’enlèvement des boues puisse être fait chaque jour, dans cette saison, de le commencer à 8 heures du matin au plus tard, et qu’une partie des rues soit déjà balayée. Il convient en conséquence de faire marcher la sonnette exactement tous les jours à 7 heures 1/2. Je vous prie d’en prévenir promptement Mrs vos confrères anciens de chaque quartier, de les prier d’en donner l’ordre au sonneur et de veiller à ce qu’il s’y conforme, et à ce qu’il parcoure chaque jour un très grand nombre de rues. Je suis informé que les sonneurs en général font mal leur travail. Recommandez à Mrs vos confrères, je vous prie, de leur prescrire la plus grande exactitude, de commencer leur service par les rues où l’enlèvement se fait d’abord et de parcourir les rues lentement, en finissant par celles où l’enlèvement des boues doit finir, afin qu’il y ait assez et moins d’intervalle possible, entre le balayage et l’enlèvement des boues.
Je suis très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé Lenoir
[Copie adressée] à Monsieur le commissaire Gillet, rue du Petit Pont »
Copie d’une lettre circulaire du lieutenant général de police, adressée au commissaire Gillet, 14 décembre 1776. Paris, Archives nationales, Y//13728
De fait, cette ambition de la police d’accroître son contrôle de la société s’accompagne d’une obsession nouvelle des autorités pour le contrôle de la vie des hommes et en particulier des corps – un paradigme politique que Michel Foucault a qualifié de « biopouvoir » (Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979) 2004). Les archives judiciaires et hospitalières comportent des exemples de mendiants, prostituées, arrêtés brutalement dans les rues. Quasiment sans limite, la violence des répressions s’abat sur les corps, brisés et fustigés par les coups de verge des agents du commissaire de police. Si les archives policières peuvent nous renseigner sur les modes opératoires policiers à l’époque moderne, de rares sources émanant de prisonniers offrent le témoignage direct des violences physiques et psychologiques portées par l’institution. Citons ici un extrait des mémoires de Jean Marteilhe, jeune artisan condamné aux galères, au début du XVIIIe siècle, en raison de son appartenance au protestantisme, dans lequel il raconte son expérience d’une prison parisienne, le château de la Tournelle, avant son départ pour les galères :
« Nous descendîmes devant le château de la Tournelle, qui sert présentement de lieux d’entrepôt aux malheureux condamnés aux galères pour toutes sortes de crimes. On nous fit entrer dans le vaste et lugubre cachot de la grande chaîne. Le spectacle affreux qui se présenta à nos yeux nous fit frémir. J’avoue que, toute accoutumé que j’étais aux cachots, entraves, chaînes et autres instruments que la tyrannie a inventés, je n’eus pas la force de résister au tremblement qui me saisit et à la frayeur dont je fus frappé en considérant cet endroit »[1].
Au cours du XVIIe siècle et surtout, au XVIIIe siècle, le Châtelet acquiert donc une grande importance, sous l’impulsion du lieutenant général de police, institution qui préfigure, dans une certaine mesure, la préfecture de police de Paris, créée après la Révolution. Le plafond de la galerie des glaces de Versailles, réalisé dans les années 1680 par Charles le Brun, insiste sur le passage vers une capitale plus sûre grâce au renforcement de la police. Cette volonté de purification de l’espace public, aussi bien dans le domaine de la salubrité publique que sur le plan du contrôle des populations, corrobore l’idée d’une philosophie de l’ordre, qui imprègne les représentations politiques, à partir surtout du XVIIe siècle. Toutefois, dans les faits, nous observons bien des limites à ce contrôle policier des villes et à l’impossible appropriation totale de l’espace urbain par la police.

LE BRUN Charles, « Police et Sûreté établies dans Paris », 1665, (C) RMN-Grand Palais (Château de Versailles)
Les failles du système policier
Tout d’abord, il faut souligner le manque de moyens de la lieutenance générale de police et, plus globalement, des agents de la monarchie. Les commissaires et les inspecteurs opèrent en effectifs limités, leurs rétributions sont modestes, ce qui engendre un manque d’investissement et une submersion par les tâches civiles, empiétant sur leurs missions d’enquête criminelle. Quant aux agents du guet, ils se trouvent en effectifs insuffisants : au début du XVIIIe siècle, on compte seulement un agent de police pour 4 000 résidents parisiens[2], en comparaison d’un policier pour 1000 Parisiens aujourd’hui. La présence de la police semble également souffrir d’un manque de visibilité dans le paysage urbain. Bien que les patrouilles et les arrestations, mises en œuvre par le guet ou les archers de l’Hôpital, se multiplient, les agents se heurtent à la réalité de ne pas pouvoir accéder à toutes les ruelles et quartiers. Certaines parties du tissu urbain, notamment les faubourgs, demeurent opaques, et l’on observe occasionnellement des formes de solidarité entre le milieu clandestin, composé de délinquants variés, et les citadins issus des catégories populaires. Ces deux univers sont confrontés à l’arbitraire et à la tendance croissante des autorités policières à réglementer leurs activités ainsi que l’espace public dans son ensemble.
En cela, il faut mettre en évidence les fortes résistances des populations urbaines à cette intrusion de la monarchie dans leur espace social. Prenons ici l’exemple des rumeurs sur l’affaire des enlèvements d’enfants, entre 1749 et 1750, épisode d’une violence cathartique. Lors ce soulèvement populaire, une foule de parisiens, issus pour la plupart des catégories populaires, agressent des représentants de la police parisienne, et assassinent un agent de l’inspecteur connu pour ses abus lors de ses interventions policières. Dès décembre 1749, en effet, des bruits circulent sur de possibles enlèvements de jeunes gens dans Paris, pour peupler les colonies américaines. La colère populaire se dirige alors contre le lieutenant général de police, Berryer, accusé d’être l’instigateur de ces enlèvements, mais aussi contre ses subordonnés, les commissaires et inspecteurs. Cet exemple d’une explosion de violences à l’égard du personnel policier témoigne ainsi de la méfiance des populations populaires à l’égard de la police, dénoncée pour ses pratiques immorales.
En dernier lieu, il faut souligner l’émergence de débats critiques à l’égard de la police. Des écrivains réformateurs, dont Louis-Sébastien Mercier (Tableau de Paris, 1783) est le représentant le plus connu, tendent de plus en plus à critiquer la supposée omnipotence policière, et sa volonté de tout connaître de la population parisienne, à travers ses indicateurs. La surveillance de l’espace public est parfois sévèrement dénoncée, d’autant plus que l’absolutisme royal, et son pouvoir arbitraire, font l’objet de critiques croissantes, à la veille de la Révolution française. Ces critiques s’articulent souvent avec une critique des inégalités sociales et des inégalités en matière de maintien de l’ordre et de justice.
In fine, cette construction d’un système policier moderne à Paris dévoile une intention politique et philosophique visant à fortifier l’ordre social. Toutefois, loin d’être omnipotente et infaillible, la police des XVIIe et XVIIIe siècles se heurte à des résistances et dispose en réalité de ressources relativement restreintes pour faire face avec efficacité aux troubles de l’ordre public. À bien des égards, les autorités contemporaines, et le ministre de l’Intérieur au premier chef, demeurent sous l’emprise de cette philosophie de l’ordre. Cependant, à la différence de l’Ancien Régime, les dispositifs policiers actuels se sont aujourd’hui considérablement sophistiqués, s’appuyant sur des technologies de vidéosurveillance et des armes prétendument non létales, comme le LBD, introduit depuis 2005.
Héritant d’une préoccupation quasi-obsessionnelle pour l’ordre et dotée d’un appareil policier renforcé, notre société contemporaine pourrait finalement être soumise à un contrôle encore plus subtil et plus pervers qu’il y a trois cents-ans.
Nos Desserts :
- Sur Le Comptoir, lire notre article « Les forces aux ordres »
- Notre analyse sur « Le « Bien Commun », histoire d’un concept »
- Retour sur les « insoumises populaires sous l’Ancien Régime »
- L’interview de la journaliste Maïlys Khider sur la répression des Gilets jaunes
- « Comment la police met fin à l’État de droit » sur la revue Frustration
Notes
[1] MARTEILHE Jean, Mémoires d’un galérien du roi soleil, Mercure de France, p. 202, cité dans l’ouvrage La déchirure (Bayard), d’Arlette Farge, en 2013.
[2] VIDONI Nicolas, La police des Lumières, Perrin, 2018, p. 122.
Image de Une : « Transport de prostituées à la Salpêtrière », JEAURAT Étienne (1699-1789), 1755, Paris, Musée Carnavalet.
Catégories :Politique