Impossible, ces derniers mois, de parler de Karl Marx sur les réseaux sociaux sans qu’immédiatement, le nom de Francis Cousin n’apparaisse dans la discussion. Ce philo-analyste de profession, docteur en philosophie, n’hésite pas à répondre aux sollicitations de Radio Courtoisie, de TV Libertés ou encore à discuter pendant plus de trois heures avec Étienne Chouard, le tout en professant dogmatiquement une pensée marxienne qui serait celle des origines, débarrassée des rajouts successifs qui n’auraient fait qu’altérer sa substance subversive initiale. Enfilant les perles et les poncifs éculés jusqu’à la corde, son audience n’a pourtant cessé d’augmenter, jusqu’à devenir celle d’un leader d’opinion.
« Francis Cousin se veut héritier des courants critiques issus de la Première Internationale qui, à partir de Karl Marx et en récusation de toutes les droites et de toutes les gauches du Capital, ont toujours fermement rappelé la nécessité de l’abolition de l’argent, du salariat et de l’État, dans la perpétuation de l’extrémisme anti-étatique et anti-mercantile qui va de la Commune de Paris en 1871 à toutes les Communes qui ont suivi, de Berlin en 1919, de Kronstadt en 1921 et de Budapest en 1956 en passant par celle de Barcelone en 1936-37 jusqu’à la grève sauvage incontrôlable de Mai 68. […] Francis Cousin s’attache essentiellement à dénoncer toutes les mystifications étatiques du fétichisme de la marchandise en signalant que l’auto-émancipation humaine impliquera le refus complet et absolu de tous les rackets gouvernementalistes dans la nécessaire liquidation de l’assujettissement économique et du dressage politique. »
Vaste programme. Puisqu’il s’agit – en partie – du nôtre, nous avons souhaité remettre certaines pendules à l’heure, afin de permettre à tout un chacun d’y voir plus clair dans cette profusion d’idées qui semble être le marqueur de notre époque contemporaine. Puisque tout le monde ne dispose pas des centaines d’heures nécessaires à la lecture dans le texte de Karl Marx, seule à même de repérer les failles dans le discours cousiniste et d’en faire jaillir les lignes de rupture et les fantasmes, nous avons souhaité nous y atteler de façon non exhaustive. Nous passerons également en revue d’autres idées que Francis Cousin emprunte à certains penseurs tout en leur tordant le cou (et la pensée), afin de jeter un éclairage aussi limpide que possible sur l’impossibilité théorique – et ce faisant, pratique – de la mise en œuvre du projet d’émancipation tel que projeté par lui.
“Critique de l’auto-mouvement réifié de la radicalité stellaire du temps subversif incarné dans la totalité de l’immanence cosmique de l’humanité vraie”
« Lorsque l’individu se met à tourner en rond dans le cercle vicieux de la fausse conscience ou l’on répète préalablement et continûment que le JE, avant toute autre revendication, est un MOI spectaculaire et égocentriste et qu’il n’a plus son existence dans le monde de l’origine en l’être mais uniquement dans la civilisation des parcours de l’avoir, celui-ci ne peut plus se croire, se penser et se vivre que narcissiquement en tant que nomade pathologique atomisée. »
« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », disait Victor Hugo. Francis Cousin, quant à lui, définit ainsi la langue : « La langue se définit comme la forme la plus expressive et la plus significative de la communauté humaine naturelle ». La naturalité de la langue semble pourtant avoir disparue, ou être voilée, lorsque l’on prend la peine de le lire. Le discours de Francis Cousin, qui mobilise autant de termes jargonnants qu’il est possible d’en recenser dans l’histoire des idées, est séduisant d’abord parce qu’il est ésotérique. Il répond à la nécessité sociale de se mettre en valeur, que ce soit d’un point de vue intellectuel ou même – et surtout – d’un point de vue purement rhétorique. Que l’on ait su se débarrasser de toute trace de vanité ou non, l’esprit de l’homme postmoderne est ainsi fait qu’il sera toujours valorisant de se montrer en situation de supériorité intellectuelle, tant que les structures de domination capitalistes favoriseront cet état de fait : il n’est que d’errer sur les réseaux sociaux pour s’en convaincre. Francis Cousin l’a parfaitement assimilé, et ainsi, à grand renfort de figures de style alambiquées et de concepts savamment tricotés, il épate et esbroufe, et – reconnaissons-lui cela – contraint à l’acquisition d’une certaine densité culturelle afin de simplement comprendre son discours.
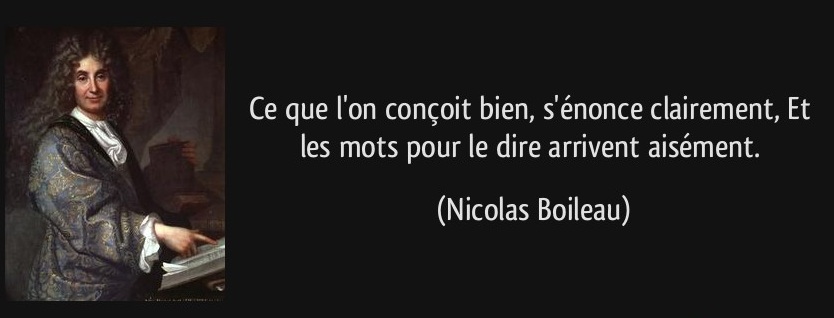
Soyons pragmatiques et prenons un exemple, tiré au hasard de son livre L’être contre l’avoir. La page 108 nous dit ainsi : « Tant que l’homme vit directement en la communauté de l’être, tout s’éprouve directement en l’immanence du cosmos de nature ». Traduisons : « Quand l’homme vit simplement, tout est simplifié ». On voit bien qu’il est tout à fait possible de dire deux choses de manière différente, et pendant que l’une d’elles est compréhensible par tous, l’autre se révèle totalement cloisonnée et marque sa limite dans le champ social par le prisme philosophique qu’elle emprunte. Cette critique, que l’on pourrait fort bien adresser à une multitude d’autres philosophes, ne prendrait pas sens en ce qui les concerne, mais peut tout à fait être faite à Francis Cousin : il se fixe comme objectif de parler au prolétariat. Or – et que l’on se garde de voir ici une trace quelconque d’un mépris de classe – le prolétariat n’a ni le temps ni l’énergie de s’approprier semblables concepts philosophiques. C’est bien là le propre de l’aliénation du travail, superbement décrite par la philosophe Simone Weil.
Francis Cousin oppose ainsi un « faire narcissique de représentation fétichiste du militantisme » à un « faire intelligent ». De deux choses l’une, parce que cette assertion prête à rire, mais donne aussi à pleurer. Premièrement, c’est insulter l’intelligence de milliers de militants, et les reléguer à un rôle d’agents utiles du Capital, ce qu’ils ne sont tout simplement pas. Avec Cornelius Castoriadis, nous pensons que dès lors qu’un individu s’éveille, il s’évertue à s’autonomiser et à s’insérer dans une praxis, « ce que nous appelons praxis [étant] un faire dans lequel l’acteur ou les acteurs sont visés comme être autonomes et considérés comme les agents essentiels du développement de leur propre autonomie ». Deuxièmement, cet embrouillaminis n’a guère de sens, mis à part pour celui qui l’exprime. Il n’y a ainsi pas de différence de nature entre les militants, mais des différences de degré. Celui qui tague les affiches publicitaires n’a pas plus de mérite que celui qui refuse de consommer les produits vantés par ces dernières. À plus forte raison, le militant qui se convainc avec Francis Cousin que « Marx a tout dit » ne semble pas se diriger vers un « faire intelligent » mais bien plutôt vers un dogmatisme qui pourrait tout aussi bien voir remplacé le nom de Marx par celui de Jésus, ou encore celui de Christine Angot. Prétendre tout dire est la marque des fous ou des prophètes, et les deux sont dangereux à côtoyer.
Si nous pensons avec Marx que le prolétariat est ainsi « la seule classe révolutionnaire jusqu’au bout », il nous apparaît impératif de parler un langage qui ne lui soit pas étranger et qui ne vise pas à produire plus de confusion que celle qui s’étale quotidiennement tout autour de nous. Non que nous souhaitions dire par là que le prolétariat serait stupide par essence et que ces concepts lui seraient dès lors inaccessibles, nous l’avons dit plus haut et nous le martelons, simplement, en populiste cohérent, nous soulignons avec Franck Lepage que « l’ouvrier qui rentre chez lui crevé de ses huit heures de boulot n’a pas envie d’ouvrir un bouquin de sociologie ». Ce que Simone Weil avait déjà dit, en soulignant l’immense mérite de « ces ouvriers qui parviennent à se donner une culture ». De même, lorsque cet ouvrier cesse d’acheter du Nutella afin de ne plus participer directement aux déforestations en cours, il apparaît sordide de lui répliquer qu’il ne fait que « s’agiter narcissiquement dans un militantisme du spectacle ». L’un des enjeux principaux de la théorie radicale est de parvenir à recréer les conditions d’un sentiment d’appartenance de classe au sein du mouvement ouvrier, puisque celui-ci, enfermé dans une bureaucratisation complète, n’affiche plus comme volonté de « changer la vie » mais simplement de tendre vers de meilleurs salaires (ce qui, en période capitaliste, n’en reste pas moins une lutte à mener).

Pour conclure, rappelons que George Orwell, dont se réclame inlassablement Francis Cousin, disait ainsi dans un article intitulé La politique et la langue anglaise (1946), semblant prendre le contre-pied de tous ces intellectuels modernes qui rivalisent de sophistication pour dire la même chose que leurs prédécesseurs avec d’autres mots (leur présence médiatique dépendant étroitement de ce qu’ils viennent y vendre) :
- N’utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de rhétorique que vous avez déjà lue à maintes reprises ;
- N’utilisez jamais un mot long si un autre, plus court, peut faire l’affaire ;
- S’il est possible de supprimer un mot, n’hésitez jamais à le faire ;
- N’utilisez jamais une expression étrangère, un terme scientifique ou spécialisé si vous pouvez leur trouver un équivalent dans la langue de tous les jours.
Le genos originel
Francis Cousin s’attache à démontrer que le « genos » (le communisme primitif, qui aurait régi l’histoire de la communauté humaine dès son apparition jusqu’à l’avènement du Néolithique) éclate et se scinde avec l’apparition brutale du Néolithique et la spécialisation qui en découle. Avant cela, « l’homme n’est pas chasseur ou peintre : il chasse le matin, et peint sur les grottes sa chasse l’après-midi ». Ainsi, il tente de démontrer que la cristallisation des savoirs et la spécialisation des tâches ne serait apparues qu’en rupture avec un mode de vie nomade qui permettait à tout un chacun d’occuper à part égale le même rôle au sein de la tribu. Or, il y a lieu de s’interroger sur ce point.
En effet, nous ne savons que peu de choses sur cette époque, et ce peu de choses ne permet en aucun cas d’affirmer de manière péremptoire que l’homme vivait ainsi et pas autrement. Ainsi, on imagine difficilement comment le biface, qui apparaît au Paléolithique inférieur, n’a pu être l’objet d’une spécialisation au sein des différents groupes humains, en vue de sa fabrication, et au regard de la complexité et de la difficulté technique – et donc physique, puisque nous parlons d’une époque où la machine ne faisait pas à la place de l’homme – que représente sa production. Le biface est un outil dont les deux faces opposées ont été travaillées dans le but d’améliorer de manière exponentielle le coupant de la « lame ». Au-delà des spécifications purement techniques, il apparaît que pour un très grand nombre d’ethnologues, la spécialisation est normale et inhérente à toute société humaine.

Démonstration de fabrication d’un biface à Teyjat en Dordogne
Il est à noter que la plupart des sociétés dites primitives y avaient recours il y a encore peu de temps, notamment les Guayakis. Ainsi, dans cette société « contre l’État » sur laquelle l’anthropologue Pierre Clastres a travaillé toute sa vie, la division du travail est simple : les hommes chassent, et les femmes portent. Ce que Clastres a démontré dans un texte resté célèbre : L’arc et le panier, publié en 1974. Cette division du travail, fondée sur la différenciation sexuelle, repose sur deux moments particuliers de la vie : elle est à la fois matérielle – ce sont les hommes qui chassent, et ce faisant, qui produisent et mettent à disposition de tous les ressources alimentaires – et symbolique – ainsi, les hommes sont représentés par leur arc, mode de production qui leur permet une chasse efficace, tandis que les femmes sont représentées quant à elle par leur panier, qui leur permet d’assurer la charge de la reproduction de la société, en déplaçant les éléments nécessaires à la survie de cette dernière au sein de la jungle amazonienne qui constitue leur territoire.
On aurait tort de voir ici une quelconque hiérarchie : pour qu’il y ait hiérarchie, il faut qu’une valorisation de telle ou telle tâche soit permise et acceptée par le corps social. Or, il n’en est rien, et la division du travail qui débouche sur une spécialisation particulière (les uns chassent et sont donc assignés à une tâche, pendant que d’autres soignent ou produisent, et ont donc quant à eux une fonction particulière) n’est pas le lieu d’un affrontement mais bien l’endroit où se situe l’interdépendance de la société guayaki : si les tâches sont différentes, elles sont néanmoins équivalentes, en ceci que la disparition de l’une d’elles entraîne de fait la disparition de toutes les autres.
Dans De la division du travail social (1893), le sociologue Émile Durkheim pointe les formes pathologiques de la division du travail de nos sociétés utilitaristes, tout en leur assignant néanmoins une fonction de cohésion sociale : les individus étant interdépendants (on retrouve la même idée chez les Guayakis, puisque le chasseur ne peut en aucun cas consommer le produit de sa chasse), ils sont donc de fait complémentaires, et cette division « crée entre les hommes tout un système de droits et de devoirs qui les lient les uns aux autres d’une manière durable ».
Jusqu’au niveau symbolique, la distinction s’opère chez les Guayakis : les hommes étant dépositaires d’un chant rituel nocturne et puissant, visant à la valorisation des exploits du chasseur dans ses chasses passées, pendant que le chant se trouve chez la femme diurne et triste, épousant ainsi une forme de nostalgie et de préservation de la mémoire. La division du travail doit être abolie, afin qu’une société sans classe n’émerge. C’est bien là l’un des cœurs les plus vibrants du projet marxiste. Seulement, il faut penser ce renversement à venir sans falsifier les faits dont nous disposons, et surtout, sans distordre la réalité afin de l’adapter à nos souhaits. Ainsi que l’écrivait l’écrivain Robert A. Heinlein, « un être humain devrait savoir changer une couche-culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant, prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l’engrais, programmer un ordinateur, cuisiner un bon repas, se battre efficacement, et mourir bravement. La spécialisation, c’est bon pour les insectes. » Mais pour ce faire, il convient d’abord de penser dans quelle mesure la société pourrait être aménagée de manière à ce qu’aucune spécialisation ne soit nécessaire, et donc, à ce qu’aucune division du travail ne puisse émerger.

Art pariétal : chevaux, aurochs et rhinocéros
De même, il semble absurde d’imaginer que l’art aurait connu un avant et un après, une historicité sans courbe (cette distinction que Cousin opère entre le sacré et le sacral – qui témoigne d’une lecture linéaire, progressiste et positiviste de l’épopée humaine), en témoignent le magdalénien, époque à laquelle domine un art figuratif, et l’azilien, où l’art devient beaucoup plus schématique et introduit ainsi des figures géométriques. La lecture matérialiste de l’histoire trouve ainsi ses limites naturellement, dans la mesure où le procédé et l’analyse marxistes sont contraints d’appliquer en permanence et quelle qu’en soit la pertinence leurs propres catégories aux époques qui lui sont antérieures, quitte à devoir faire l’impasse sur les éléments factuels qui sont ceux dont nous disposons du point de vue de l’archéologie.
Durkheim, ne disait-il pas ainsi dans Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) que « si, par origine, on entend un premier commencement absolu, la question n’a rien de scientifique et doit être résolument écartée. Il n’y a pas un instant radical où la religion ait commencé à exister et il ne s’agit pas de trouver un biais qui nous permette de nous y transporter par la pensée. Comme toute institution humaine, la religion ne commence nulle part. Aussi toutes les spéculations de ce genre sont-elles justement discréditées ; elles ne peuvent consister qu’en constructions subjectives et arbitraires qui ne comportent de contrôle d’aucune sorte. » De fait, il convient de rappeler que Marx lui-même, moquant les penseurs bourgeois de son époque qui cherchaient à appliquer des catégories n’ayant un sens que relativement au capitalisme de leur propre époque, disait que « pour eux, il y a eu de l’histoire, mais il n’y en a plus », ouvrant ainsi la voie au socio-centrisme (l’idée selon laquelle chaque société se pose comme étant le centre névralgique du monde, observant toutes les autres à travers le prisme déformant de son point de vue particulier).
Essentialisation du discours
Francis Cousin essentialise son discours et joue un jeu dangereux en permanence (et c’est en partie, selon nous, la principale raison pour laquelle il est relayé par des sites tels que TV Libertés ou encore Égalité & Réconciliation). En effet, ce dernier n’hésite pas à substituer à l’analyse « d’armée de réserve du capital » marxiste une analyse qui rejoint bien plus celle du « grand remplacement », chère aux identitaires et conceptualisée par Renaud Camus. Dans l’une de ses dernières interventions vidéo, Francis Cousin se laisse ainsi aller à parler de la possibilité pour le Capital d’organiser une « guerre civile ethnique » lors du « grand chaos terminal industriel et financier » à venir.
Ce que Marx entendait par armée de réserve, il l’énonce ainsi dans Le Capital : « L’accumulation capitaliste elle-même […] produit constamment, et à raison directe de sa propre énergie et de son expansion, une population relativement redondante des travailleurs, c’est-à-dire une population plus grande que celle des besoins moyens nécessaires à la valorisation du capital, et donc un surplus de la population […]. C’est l’intérêt absolu de chaque capitaliste de s’appuyer, pour une quantité donnée de travail, sur le plus petit nombre de travailleurs, plutôt que sur un plus grand nombre, si le coût est sensiblement le même, […] plus étendue est l’échelle de production, plus fort est ce motif. Sa force augmente avec l’accumulation du capital. […] La surpopulation relative est donc le pivot autour duquel s’articulent la loi d’offre et de demande du travail. » C’est par ce biais que se constituent les masses énormes de chômeurs, et que se fait la création d’une « surpopulation relative » qui entraîne toujours plus de précarité pour la masse des travailleurs, et qui permet à la bourgeoisie d’ajuster en permanence la masse salariale disponible par le jeu des embauches et des licenciements, n’hésitant pas à créer misère de tous et pauvreté pour chacun.

Francis Cousin avec Martial Bild, cadre du Front national de 1980 à 2008, cofondateur de TV Libertés en 2014
Marx ne s’arrête pas là. En effet, il analyse et dénonce les stratégies immigrationnistes mises en œuvre par le patronat afin de mettre en compétition les travailleurs présents sur le sol où se situe l’emploi recherché, et les travailleurs qu’il fait venir d’autres pays, dans lesquels l’offre de travail est moins abondante. Il écrit ainsi dans Le Capital : « À cause de la concentration croissante de la propriété de la terre, l’Irlande envoie son surplus de population vers le marché du travail anglais, et fait baisser ainsi les salaires, et dégrade la condition morale et matérielle de la classe ouvrière anglaise. Et le plus important de tout ! Chaque centre industriel et commercial en Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles, les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L’ouvrier anglais moyen hait l’ouvrier irlandais comme un concurrent qui abaisse son niveau de vie. Par rapport au travailleur irlandais, il se sent un membre de la nation dominante, et ainsi se constitue en un instrument des aristocrates et des capitalistes de son pays contre l’Irlande, renforçant ainsi leur domination sur lui-même. Il nourrit des préjugés religieux, sociaux et nationaux contre le travailleur irlandais. Son attitude envers lui est très semblable à celle des “pauvres blancs” envers les “nègres” des anciens États esclavagistes des États-Unis. L’Irlandais lui rend d’ailleurs la pareille, et avec intérêts. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois le complice et l’instrument stupide de la domination anglaise en Irlande. Cet antagonisme est artificiellement maintenu et intensifié par la presse, les orateurs, les caricatures, bref, par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, en dépit de son organisation. C’est le secret grâce auquel la classe capitaliste maintient son pouvoir. Et cette classe en est parfaitement consciente. » On comprend bien ici que les tensions dont parle Marx, entre ouvriers anglais et irlandais, ne sont pas résultantes de ce que sont par essence un Irlandais et un Anglais, mais bien du rôle social et historique que la bourgeoisie leur assigne.
Francis Cousin, quant à lui, voit dans la stratégie immigrationniste du système marchand un processus qui viserait à « substituer au prolétariat offensif de la vieille histoire européenne, la diversité docile des multiples différences prosternées devant la loi du pécule » (page 227 de L’Être contre l’Avoir). Il n’est plus du tout question de marxisme ici, et nous nous trouvons devant un racialisme pur et dur. Laisser penser que seuls les Européens, en vertu de leur histoire populaire de contestation sociale et des multiples insurrections qui ont vu le jour sur ce continent, seraient à même de porter le combat contre le capitalisme, ne peut faire sens. En premier lieu parce que ce serait oublier un peu vite que si le capitalisme a été contesté ici plus que n’importe où ailleurs, c’est bel et bien parce qu’il a germé sur notre propre sol particulier, qu’il s’est imposé au reste du monde dans la mesure où nous le lui avons imposé, et que les communautés indiennes pourtant si chères à Francis Cousin, pour ne citer qu’elles, vivaient tranquillement loin de l’économisme mortifère qui gangrène nos sociétés actuelles, pendant que dans le même temps, nous autres Européens avions déjà commencé à nous entre-tuer et à saper les fondements moraux de nos sociétés dans le seul but d’accaparer les richesses communes. Deuxièmement, c’est délibérément faire fi de la potentialité d’émancipation inhérente à la condition humaine qui vise à l’accomplissement de sa propre autonomie : on ne voit pas qu’un salarié français ressente plus violemment l’aliénation et la privation de sa liberté dans sa chair en 2017, qu’un esclave mauritanien du XVIIIe siècle.
Nous plaçant sous le mot d’ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », nous refusons donc d’abonder dans le sens de Francis Cousin, et nous sommes totalement conscients de la division créée artificiellement entre prolétaires immigrés et prolétaires français, et de la paralysie permanente qu’implique cette division.
Marx, es-tu là ?
 Commençons par tordre le cou à l’énoncé cousinien d’une absurdité sans nom, selon lequel « personne n’aurait lu Marx », en rappelant que des penseurs tels que Karl Korsch ou encore Georg Lukacs n’ont finalement fait que ça. Ceci étant posé, il est étonnant de constater que si Francis Cousin s’évertue à démontrer que chaque chose, chaque rapport social, suit une trajectoire qui était déjà contenue en lui-même dès l’origine – ainsi, les syndicats auraient toujours été des instruments d’oppression et de compromission avec le patronat – il refuse d’assigner ce principe au marxisme lui-même. En effet, les théories élaborées par Marx ont été mal comprises, partout et par tous, sauf par lui-même, et l’épopée communiste de l’URSS ne lui devrait ainsi absolument rien. S’appuyant sur une phrase prononcée à l’automne 1882 par Marx, à savoir : « Tout ce que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste », Francis Cousin développe ainsi l’idée selon laquelle toutes les idéologies se réclamant du marxisme ne l’étaient tout simplement pas, marxistes. Or, la majeure partie des marxistes (quoiqu’hétérodoxes), Castoriadis en tête, acceptèrent très bien l’idée selon laquelle le marxisme, en accord avec ses principes dialectiques, s’était accompli – certes sous une forme abâtardie, comme ne manquera pas de le démontrer Rosa Luxemburg, qui expliquera que le point de vue léniniste et centralisateur pouvait être compris comme anti-marxiste – dans les pays communistes du XXe siècle.
Commençons par tordre le cou à l’énoncé cousinien d’une absurdité sans nom, selon lequel « personne n’aurait lu Marx », en rappelant que des penseurs tels que Karl Korsch ou encore Georg Lukacs n’ont finalement fait que ça. Ceci étant posé, il est étonnant de constater que si Francis Cousin s’évertue à démontrer que chaque chose, chaque rapport social, suit une trajectoire qui était déjà contenue en lui-même dès l’origine – ainsi, les syndicats auraient toujours été des instruments d’oppression et de compromission avec le patronat – il refuse d’assigner ce principe au marxisme lui-même. En effet, les théories élaborées par Marx ont été mal comprises, partout et par tous, sauf par lui-même, et l’épopée communiste de l’URSS ne lui devrait ainsi absolument rien. S’appuyant sur une phrase prononcée à l’automne 1882 par Marx, à savoir : « Tout ce que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste », Francis Cousin développe ainsi l’idée selon laquelle toutes les idéologies se réclamant du marxisme ne l’étaient tout simplement pas, marxistes. Or, la majeure partie des marxistes (quoiqu’hétérodoxes), Castoriadis en tête, acceptèrent très bien l’idée selon laquelle le marxisme, en accord avec ses principes dialectiques, s’était accompli – certes sous une forme abâtardie, comme ne manquera pas de le démontrer Rosa Luxemburg, qui expliquera que le point de vue léniniste et centralisateur pouvait être compris comme anti-marxiste – dans les pays communistes du XXe siècle.
La vision du monde développée par Francis Cousin provient ainsi d’une lecture particulière de Marx. Marx est – avec Michel Foucault – l’un des penseurs en sciences sociales le plus cité dans le monde, et tout le monde se revendique de lui, soit pour se ranger derrière son patronage, soit pour y voir l’ennemi absolu, tout en s’arrangeant pour lui faire dire ce qu’il n’a jamais dit. Ainsi, l’extrême gauche n’a de cesse de lui jurer fidélité et chacun y va de sa compréhension personnelle (et forcément meilleure) du marxisme, pendant que dans le même temps, l’extrême droite critique le « marxisme culturel » à l’œuvre dans nos sociétés actuelles comme étant la matrice de la crise du monde moderne. Cette lecture particulière de Marx donne naissance chez lui à une pensée ante-prédicative absolument contrariée par les faits et l’histoire (curieux, dès lors, d’accepter cette posture, quand on se revendique du matérialisme historique marxiste). Imaginer qu’en se débarrassant du seul capitalisme et du seul spectacle, l’être humain tendrait nécessairement vers un état de naturalité paradisiaque relève de la foi, pas de l’étude minutieuse des groupes et événements radicaux (sur lesquels Cousin s’appuie néanmoins). Cette aspiration à un homme nouveau, qui n’est pas sans rappeler le plus pur dogmatisme religieux, est dangereux en ce sens qu’il empêche les individus présents de s’auto-instituer d’ores et déjà et de se penser comme autant de sujets autonomes et visant à l’autonomie collective. À cet égard, difficile de ne pas songer à la soriétologie et à la manière dont le schéma déterministe cousinien renvoie parfaitement à celle-ci : passage d’un Éden au péché originel, puis retour à l’état de bonheur initial. La palingénésie appliquée au marxisme, avec l’être générique comme figure religieuse.
Pour saisir cela, il faut en revenir au Marx jeune, qui, s’appuyant sur l’idée hegelienne d’une volonté à l’œuvre dans le monde visant sans cesse à sa propre perfection, substitua simplement la matière à l’esprit. Seulement, ainsi que le remarquait Simone Weil dans son ouvrage majeur Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934) : « Par un paradoxe extraordinaire, il a conçu l’histoire, à partir de cette rectification, comme s’il attribuait à la matière ce qui est l’essence même de l’esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. Par là il s’accordait d’ailleurs profondément avec le courant général de la pensée capitaliste ; transférer le principe du progrès de l’esprit aux choses, c’est donner une expression philosophique à ce “renversement du rapport entre le sujet et l’objet” dans lequel Marx voyait l’essence même du capitalisme. L’essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d’une sorte de religion dont Marx a subi malgré lui l’influence en élaborant sa conception de l’histoire. Le terme de religion peut surprendre quand il s’agit de Marx ; mais croire que notre volonté converge avec une volonté mystérieuse qui serait à l’œuvre dans le monde et nous aiderait à vaincre, c’est penser religieusement, c’est croire à la Providence. D’ailleurs le vocabulaire même de Marx en témoigne, puisqu’il contient des expressions quasi mystiques, telles que “la mission historique du prolétariat”. Cette religion des forces productives au nom de laquelle des générations de chefs d’entreprise ont écrasé les masses travailleuses sans le moindre remords constitue également un facteur d’oppression à l’intérieur du mouvement socialiste ; toutes les religions font de l’homme un simple instrument de la Providence, et le socialisme lui aussi met les hommes au service du progrès historique, c’est-à-dire du progrès de la production. C’est pourquoi, quel que soit l’outrage infligé à la mémoire de Marx par le culte que lui vouent les oppresseurs de la Russie moderne, il n’est pas entièrement immérité. »
Qui plus est, la conception purement matérialiste de l’histoire est intenable (et encore plus quand elle est grossièrement énoncée) à l’échelle du temps long. Castoriadis, dans son livre L’Institution imaginaire de la société (1975) disait ainsi « Dans le rapport historique, le non-causal est un moment essentiel », ce qu’Engels dira autrement : « L’histoire est le domaine des intentions inconscientes et des fins non voulues ». Une philosophie qui se dit radicale – et marxiste – reste ainsi prisonnière d’elle-même à jamais, et de ce qu’elle a critiqué, en ce sens qu’une révolution consciente nécessiterait un savoir absolu, et que ce faisant, elle exige du projet révolutionnaire qu’il soit fondé sur une théorie complète en assimilant la politique et le rapport historique à une technique, posant son domaine d’action comme objet possible d’un savoir fini et exhaustif. « Brièvement parlant, s’il y a Savoir absolu concernant l’histoire, l’action autonome des hommes n’a plus aucun sens », écrivait encore Castoriadis. Or, ce sont bien dans les lignes de fuite, les marges des mouvements officiels, et les inconnues multiples que se créent les possibilités d’une révolution concrète. Ainsi, de Barcelone à la Commune de Paris, ce ne sont pas de plans détaillés et préparés en amont qu’ont surgi les possibilités d’une autonomisation collective, mais du conseillisme ouvrier et des rapports entre les acteurs nouvellement créés. Castoriadis, toujours : « Marx dit quelque part : S’il n’y avait pas le hasard, l’histoire serait de la magie – phrase profondément vraie. Mais l’étonnant est que le hasard dans l’histoire prend lui-même la plupart du temps la forme du hasard signifiant, du hasard objectif, du comme par hasard, comme le dit si bien l’ironie populaire ». Étant de facto le domaine de la création – de l’auto-institution permanente de ses membres – l’histoire ne peut ainsi être résumée à un simple schéma déterministe. Les sociétés ne semblent pas pouvoir échapper aux modèles physiques, et il est maintenant établi, par le truchement du comportement chaotique, que la nature déterministe des systèmes ne les rend pas pour autant prévisibles : la théorie cinétique des gaz, qui doit composer avec l’imprévisibilité des mouvements des molécules individuelles, est ainsi l’une des branches les plus rigoureuses de la physique.

Barricade place Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871
« Ainsi, cette idéologie fait du développement de la technique le moteur de l’histoire en dernière analyse et lui attribue une évolution autonome [or, Ellul a bien démontré que la Technique n’est pas neutre, NDA] et une signification close et bien définie. Elle essaie de soumettre l’ensemble de l’histoire à des catégories qui n’ont un sens que pour la société capitaliste développée et dont l’application à des formes précédentes de la société créent plus de problèmes qu’elle n’en résout. Enfin, elle est basée sur le postulat caché d’une nature humaine essentiellement inaltérable, dont la motivation prédominante serait la motivation économique. » (L’Institution imaginaire de la société)
En toile de fond, Francis Cousin projette un communisme universel (une fédération de communes) – qui ne serait donc que la résurgence du même communisme originel qui nous a été volé – qui verrait la communauté humaine se reconnaître comme une grande famille, qui serait régie par les modes d’organisation techniciens propres au capitalisme même. Les moyens technologiques qui sont les nôtres aujourd’hui serviraient ainsi à faire transiter les savoirs de par le monde, sans qu’aucun accapareur ne cherche à leur assigner une tâche néfaste pour la communauté. Or, Jacques Ellul l’a parfaitement démontré, il n’est pas possible d’abattre l’un sans abattre l’autre, et ce n’est pas le capitalisme qui a donné naissance au système technicien, mais précisément l’inverse. « J’ai été amené à me demander si l’analyse par Marx du capital et du capitalisme du XIXe siècle était toujours valable dans le premier tiers du XXe siècle. Par la suite, il nous paraissait, surtout au sein du mouvement personnaliste, qu’il y avait certaines tendances dans la société soviétique et dans la société capitaliste qui étaient extrêmement voisines, que l’on retrouvait au-delà des transformations économiques et des modalités politiques et juridiques. En particulier, on retrouvait la nécessité de développer à tout prix l’industrie et les objets de type technique. » écrivait-il ainsi dans Ellul par lui-même. À l’instar de Guy Debord, qui n’avait emprunté les chemins d’une critique de la société industrielle que très tardivement, Francis Cousin use et abuse de la seule critique sociale pour renverser l’hégémonie capitaliste, sans voir que cette dernière est portée par un ensemble plus vaste.
 Bien plus qu’une fonction d’émancipation, la structure même du discours cousiniste, qui a intégré mais mal digéré les critiques situationnistes, épouse donc parfaitement son temps, en ceci qu’elle rend impensable les conditions mêmes d’une quelconque révolution, puisque le champ social se fait spectacle permanent et illusoire d’une révolution introuvable. Voir le spectacle partout, c’est ainsi le rendre impensable – et en somme, ne plus le voir nulle part. Lorsque Debord parle de spectacle, il ne fait jamais que reprendre les catégories marxistes de réification, d’aliénation et de fétichisme, et si l’on s’accorde pour dire avec lui que « le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images », il nous semble impératif d’aider à penser matériellement ce que peut être le spectacle, puisque nous n’avons rien à gagner à lui laisser la part d’ombre qu’il comporte en creux, et qui permet d’asseoir une critique qui resterait à l’état de jachère ad vitam æternam. Les catégories sus-citées, reprises par Debord, avaient l’avantage indéniable d’être conceptuellement définies, et ainsi, de renvoyer à des objets concrets. Or, lorsque Francis Cousin évoque l’auto-mouvement du monde, il faut bien convenir que cette formule ne renvoie à rien qui ne soit conceptuellement défini. De même, la récitation quasiment religieuse des catégories de « spectacle », « d’être générique » ou encore de « marchandise » semble répondre à une logique purement et simplement rhétorique : si tous les événements passés, présents et à venir peuvent être expliqués uniquement grâce à ces catégories, alors les événements inverses peuvent l’être exactement de la même manière. Pour le dire avec Castoriadis, « en affirmant que tout doit être saisi en termes de causation et qu’en même temps tout doit être pensé en termes de signification, qu’il n’y a qu’un seul et immense enchaînement causal, qui est simultanément un seul et même enchaînement de sens, [le marxisme] exacerbe les deux pôles qui l[e] constituent au point de rendre impossible de l[e] penser rationnellement. »
Bien plus qu’une fonction d’émancipation, la structure même du discours cousiniste, qui a intégré mais mal digéré les critiques situationnistes, épouse donc parfaitement son temps, en ceci qu’elle rend impensable les conditions mêmes d’une quelconque révolution, puisque le champ social se fait spectacle permanent et illusoire d’une révolution introuvable. Voir le spectacle partout, c’est ainsi le rendre impensable – et en somme, ne plus le voir nulle part. Lorsque Debord parle de spectacle, il ne fait jamais que reprendre les catégories marxistes de réification, d’aliénation et de fétichisme, et si l’on s’accorde pour dire avec lui que « le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images », il nous semble impératif d’aider à penser matériellement ce que peut être le spectacle, puisque nous n’avons rien à gagner à lui laisser la part d’ombre qu’il comporte en creux, et qui permet d’asseoir une critique qui resterait à l’état de jachère ad vitam æternam. Les catégories sus-citées, reprises par Debord, avaient l’avantage indéniable d’être conceptuellement définies, et ainsi, de renvoyer à des objets concrets. Or, lorsque Francis Cousin évoque l’auto-mouvement du monde, il faut bien convenir que cette formule ne renvoie à rien qui ne soit conceptuellement défini. De même, la récitation quasiment religieuse des catégories de « spectacle », « d’être générique » ou encore de « marchandise » semble répondre à une logique purement et simplement rhétorique : si tous les événements passés, présents et à venir peuvent être expliqués uniquement grâce à ces catégories, alors les événements inverses peuvent l’être exactement de la même manière. Pour le dire avec Castoriadis, « en affirmant que tout doit être saisi en termes de causation et qu’en même temps tout doit être pensé en termes de signification, qu’il n’y a qu’un seul et immense enchaînement causal, qui est simultanément un seul et même enchaînement de sens, [le marxisme] exacerbe les deux pôles qui l[e] constituent au point de rendre impossible de l[e] penser rationnellement. »
Qu’on ne s’y méprenne pas : il n’est pas question ici de mettre en accusation la critique radicale, puisque nous nous en réclamons et qu’il nous parait plus que nécessaire de la porter sur tous les aspects possibles du fait social total que représente le capitalisme. Seulement, il y a lieu de dénoncer une certaine critique radicale (puisqu’il n’en existe pas une seule et unique, n’en déplaise à Francis Cousin) qui se fixerait comme objectif d’expliquer la totalité de l’histoire humaine : lorsque l’on ne cherche plus à élaborer une théorie après une étude minutieuse des faits, mais que l’on s’obstine à appliquer une théorie sur des faits, que ces derniers en donnent une confirmation ou non, en déformant parfois volontairement le matériau disponible, alors, il n’y a plus de critique radicale qui tienne, mais tout simplement une absence de cette dite critique, et un enfermement dogmatique dommageable. En s’inscrivant dans l’actualité et en se faisant son commentateur direct, Francis Cousin s’évertue à appliquer à la totalité du monde une grille de lecture qui ne se trouve jamais modifiée par l’expérience, mais qui, bien au contraire, trouve une justification en ce sens qu’elle cherche – parfois désespérément – à confirmer toujours les postulats initiaux qui était les siens.
S’il est vrai que tout est clou pour celui qui n’a qu’un marteau, alors, tout semble devoir devenir spectacle et marchandise pour celui qui n’a que Marx.
Nos Desserts :
- Aymeric Monville avait publié en 2017 un texte contre Cousin : « Francis Cousin, volontaire contre le bolchevisme »
- Lire « La politique et la langue anglaise » de George Orwell
- Lire le chapitre « L’arc et le panier » dans La Société contre l’État de Pierre Clastres
- Lire De la division du travail social d’Émile Durkheim
- Lire Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale de Simone Weil
- Au Comptoir, nous avons interviewé Franck Lepage à propos des Gilets jaunes
Catégories :Politique


La critique radicale c’est bien… mais la critique critique c’est un peu mieux. Et le problème c’est comme toujours de passer de l’arme de la critique à la critique des armes .. Bref quand je lis « Critique de l’auto-mouvement réifié de la radicalité stellaire du temps subversif incarné dans la totalité de l’immanence cosmique de l’humanité vraie », je m’enfuis en courant. Peut-être ai-je tort, mais franchement là je ne peux plus. J’ai assez souffert sur Marx (je lui ai consacré cinq livres) pour refuser s’engloutir cet auteur éminent sous le jargon.
Effectivement, vous avez tort.
Quand tu lis… Au lieu de Lire les âneries qu’on raconte sur Cousin, tu ferais mieux de vérifier et de lire Cousin directement… En fait, c’est simple… A rebours de toutes les décompositions social-démocrates et bolchéviques de la gauche marchande, il y a la réalité du mouvement réel posé par Marx lui-même: abolition de l’argent, du salariat et de l’Etat contre tous les chiens de garde syndicaux et politiques de l’économie de la servitude rénovée…Tu devrais lire la Critique du programme de Gotha, Pannekoek, Luxembur et Bordiga…On est ainsi immunisé contre toutes les veuves Lénine de l’imposture du capitalisme d’Etat…
J’ai déjà essayé de regarder une conférence de Francis Cousin et effectivement j’avais abandonné devant la complexité de son jargon.
Je suis globalement d’accord avec l’article et de toute façon je pense que l’on devrait arrêter de parler de marxisme car de nombreux penseurs ont dépassé le philosophe allemand dans son propre sillon : il y a eu enfance du socialisme comme il y a eu enfance de l’art. Quitte à choisir un personnage il vaudrait mieux parler de jaurésisme car il me semble que le politicien français n’a pas commis d’erreur théorique et a dans son action fait preuve d’une grande intelligence tactique et stratégique dont on devrait s’inspirer.
Autre point, outre que la théorie du grand remplacement est une absurdité statistique, il est effectivement faux de considérer les immigrés comme docile par essence. Si il leur faut certes un moment avant de comprendre les enjeux politiques de la société dans laquelle ils ont émigrés, ils pourront ensuite comme les autres développer une pensée radicale à partir leur expérience personnelle. Les premiers socialistes considéraient qu’il faudrait à peu prés vingt ans avant de pouvoir intéresser les travailleurs étrangers au socialisme. (voir ici, un texte très important : https://www.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2017-3-page-109.htm)
« l’ouvrier qui rentre chez lui crevé de ses huit heures de boulot n’a pas envie d’ouvrir un bouquin de sociologie ». Qu’en sais-tu petit bourgeois Leniniste ? Vous ne nous aurez plus avec votre ‘avant-garde’.
Tu n’as pas du rencontrer beaucoup d’ouvriers….
En quoi Francis Cousin aurait-il tort de voir la marchandise et le spectacle partout ? Quand je regarde autour de moi je ne vois que marchandise et spectacle, mais peut être vois-je mal. Votre critique est un spectacle que je lis par le biais d’une marchandise. Un spectacle en ce sens que votre critique distrait le prolétaire du combat révolutionnaire en focalisant son attention sur l’idole Francis Cousin, plutôt que vers la convergence des êtres dans la perspective d’un mouvement commun radicalement opposé à toutes les mystifications institutionnelles qui par l’abrutissement qu’elles exercent sur ces mêmes êtres les asservissent. Et enfin une marchandise en ce sens que je lis votre critique sur mon téléphone portable, objet que je n’ai pas construit de mes mains (un être asservi l’a fait pour moi, et pas par amour de l’être) et qui est le produit de la domination réelle du Capital en mouvement, de la marchandisation de la totalité du marchandable.
À bas le spectacle déviant de la déviation du regard prolétaire de ce qu’il a à accomplir !
À bas la marchandise qui fait de nos vies des misères !
À bas l’Etat, ce terroriste qui terrorise les êtres pour ne pas qu’ils quittent les usines et s’autoorganisent dans un mouvement de reappropriation de leur propre substance générique !
À bas le Salariat, cet outil de torture qui consubstantiellement à l’Etat asservit les êtres !
À bas l’Argent, marchandise ultime, garant de la possibilité d’échanger des forces contre un peu de sous, maquereau des êtres qui les condamne à faire la pute au bistrot ou sur les plateaux télé !
Et, j’oubliais, vive la communauté universelle émancipée ! Patience ! Elle arrive, et gesticuler narcissiquement d’impatience ne la fera pas venir plus rapidement.
Spectacle anti-spectaculaure signé Thomas Esclatine, pour vous servir.
Parfait.
Merci Thomas Eslatine pour ta lucidité. Tout a fait d’accord.
Je ne suis pas un spécialiste de Marx, donc je me garderai de toute remarque sur votre propos relativement aux rapports que vous établissez d’avec le travail de F. Cousin.
Cela étant, la critique sur la terminologie de cet auteur est, à mon sens, pleinement applicable à une foule d’autres penseurs (vous l’avez écrit) ; il n’y a qu’à lire les ouvrages de phénoménologie d’un Husserl (notamment les « Recherches logiques », les « Méditations cartésiennes », etc…), d’un Heidegger (Etre et temps), d’un Sartre, d’un Fink, la liste s’étendant magistralement…
Pour ma part, à chaque philosophe, son vocabulaire et sa formulation propre, conditions nécessaires pour rendre compte de l’originalité de sa pensée.
Après, je le conçois, y a t-il forcément quelques abus de langage chez qui veut davantage paraître qu’être et assurément est-il souhaitable de préférer des vocables accessibles lorsque la compréhension de l’idée l’autorise…
…néanmoins me semble t-il extrêmement difficile d’exposer des abstractions toujours plus précises sans les présenter sous les formes adéquates avec lesquelles elles atteignent leur pertinence pleine et entière ; à moins de créer une « logistique », peut-être ? Ce qui devient tout aussi (sinon plus) complexe (Husserl, mathématicien de formation, l’avait envisagé avant d’y renoncer).
Bien à vous,
Marx est très clair si on le cite jusqu’au bout:
Le progrès industriel, qui suit la marche de l’accumulation, non seulement réduit de plus en plus le nombre des ouvriers nécessaires pour mettre en œuvre une masse croissante de moyens de production, il augmente en même temps la quantité de travail que l’ouvrier individuel doit fournir. A mesure qu’il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de travail, le système capitaliste développe aussi les moyens de tirer plus de travail du salarié, soit en prolongeant sa journée, soit en rendant son labeur plus intense, ou encore d’augmenter en apparence le nombre des travailleurs employés en remplaçant une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l’homme par la femme, l’adulte par l’adolescent et l’enfant, un Yankee par trois Chinois. Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l’offre surabondante, en un mot, pour fabriquer des surnuméraires.
Le Capital – Livre premier, VII° section : Accumulation du capital
Chapitre XXV : Loi générale de l’accumulation capitaliste
Il y’aura malheureusement toujours de petits bourgeois qui penseront comprendre les choses avec leur subjectivité narcissique de leur minuscule expérience captant des phénomènes superficiels dans un monde ou tout est renversé par le spectacle de la marchandise. Cousin dans la trajectoire de Marx, Debord, et tant d’autres écrit compliqué, car la réalité dans sa profondeur est compliqué ! S’il choisi un mot complexe plutôt qu’un autre plus simple issue jargon c’est que le premier exprime plus de choses ou autre chose que son synonyme apparent !
L’histoire a montré que Marx n’a jamais été dépassé que pour être renversé ! Quand je lis Marx aujourd’hui je comprends qu’il a écrit pour notre époque !
Parfait.
On doit tout accepter. Cependant, il ne faut être surpris de manquer à son devoir de critique quand on ne rempli plus cet objectif. Je prépare une réponse. A bientôt.
Toute l’analyse réside dans cette synthèse : l’essentiel n’est pas d’avoir raison mais de ne pas avoir tort.
Bonjour,
N’étant pas un érudit, un historien, un lettré, un boulimique de la lecture d’ouvrages de réflexions stratosphérique bref n’étant qu’un païen, un « simplet » citoyen mais qui sent le vent tourner, je déboule là dans cette dimension de la réflexion qui est propre à ce site et dont en lisant les commentaires je sonde l’abîme qui me sépare des intervenants qui commentent et de fait je me pose cette réflexion intériorisée :
Un langage complexe pour un fond « caché » et complexe je dis « OUI » et je comprends la nécessité pour plus d’amplitude d’expression du message à passer. Mais pourquoi, finalement, ne pas « marchandiser » en quelque sorte « ce savoir permettant l’éveil » dans un langage plus simple pour toucher plus d’humain et susciter une étincelle à l’instant « T » qui pourrait allumer le feu de l’éveil même plus tard.
Marchandiser ce message « oui » combattre le feu par le feu, répandre l’idée dans sa globalité et de loin pour attirer les gens petit à petit à plus de profondeur dans la compréhension plutôt que finalement faire fuir avec des monologues fleuves trop « élevés » lexicalement générant chez « nous ces petites gens » (dont nous semblons être dépeint comme acceptant ignarement notre condition de consommateur esclave et qui ne semble pas susciter de compréhension, ni de compassion de la part d’érudit comme Cousin ou les commentateurs ici), plus la « fuite », les « maux de tête », « l’humiliation ou dénigrement de soi du fait de ne pas comprendre les tournures de phrases », « l’image de vieux profs donneur de leçons magistrales sans échanges possible »
L’éveil se doit d’être progressiste en soit car face à la baisse du niveau de « comprenette » actuel de la populace, sans compter le déni de leur condition de consommateur esclave et narcissique car « addict à la récompense immédiate : 1 pouce bleu, 1 flamme, 1 coeur » et au « je possède donc je suis », je pense que les armes de propagation de l’alarme de l’échouage sociétal et humain doivent utiliser les mêmes codes d’endoctrinement que ceux « du spectacle et de la marchandisation » :
Divertissements (tik-tok / snapchat / instagram/netflix/Ocs/amazone prime/Fornite/WOW/League of légende/call of duty …etc) anesthésient l’humain car facilité d’accès, facilité d’utilisation et récompenses rapides, immédiates voilà le but dans la vie de beaucoup de gens de nos jours et même dans des pays pauvres (Asie, Afrique, Amérique du sud) ils et elles font des tik-tok, des selfies et attendent le pouce bleu, la flamme, le like, le coeur
L’ennemi est en grande parti là dans le divertissement pendant que l’état profond fomente et met en place ses pions dans ce grand échiquier. Sans compter sur la division toujours plus alimentée via les médias et réseaux dit sociaux : couleur 1 contre couleur 2 – genre 1 contre genre 2 – mœurs 1 contre mœurs 2 – religion 1 contre religion 2 ….etc
Voilà certes surement décousu pour vous ici je pense mais la scène du théâtre de la tragédie est tellement immense car mondiale que mettre tout en ordre ça ne met pas facile mais dans l’idée je sens bien que ça sent le souffre. Ai je tors dans ce que je viens d’énoncer ? surement par manque de savoir mais ai je tors totalement ? je souhaiterai un retour sur mon commentaire (et si possible accessible à la compréhension d’un paien)
cdt
Cousin c du « marxisme » pour Identitaires (autrefois on disait racistes).
Dans une vidéo d’il y a plus ou moins 10 ans, il appelait, au nom de Marx, à arrêter l’immigration.
Dans d’autres vidéos, il s’insurge contre l’esclavage des noirs en lui opposant l’esclavage des blancs irlandais (bien que le sujet ait été débunké il y belle lurette).
Le prolétariat « blanc » serait révolutionnaire (car chrétien) et l’immigré (sous-entendu le musulman) ne le serait pas.
A noter qu’il est publié par la même maison d’éditions qui a publié cet autre « intellectuel » de renom, Serge Ayoub. On comprend alors mieux ses passages sur Radio Courtoisie, TVL et E&R.
Cousin n’est pas là pour combattre le capitalisme et il affirme : « nous ne sommes pas un groupe d’action mais de réflexion ». Avec une telle attitude de révolutionnaires chaise de bureau/écran, le capitalisme à encore de beaux jours devant lui.
La dialectique sous l’angle de Francis Cousin est chargée de la complexité hégélienne et marxienne,. (10 années de vie ne me permettraient pas d’en saisir la richesse.) La triade de la phénoménologie nous parle de l’enfance dans son « en soi », espèce de creuset universel, (inconscient collectif de C.G.Jung).
Pour cette raison, l’intuition de l’enfant est surprenante, seulement il ne trouve pas » les mots pour le dire » . Dans la seconde partie de sa vie, il se fracasse dans l’univers du « pour soi ». C’est la phase dite adulte, le règne du chaos et souvent dans une souffrance qui plombe en partie sa créativité. Seulement dans la dernière partie de sa vie, si son désir et sa curiosité l’on maintenu dans la joie de vivre, c’est une espèce de complétude, à la manière d’Edgar Morin…un sage rayonnant, c’est le « pour soi qui revient en soi ».
La recherche, la méditation, la culture, l’amitié et l’amour ont traversé sa longue et belle vie. C’est là que les penseurs matinaux excellent. Pythagore, Empédocle, Xénophane, Héraclite, Parménide et aussi Jésus, dans ses paroles subversives.
La liberté d’être et de penser peuvent nous aider à marcher dans les sentiers d’Edgar Morin. Hélas la médiocrité et la violence habitent ce monde dont il faut savoir s’extraire dans le respect de notre différence.
Hier j’étais encore un enfant, intérieurement et dans mon apparence, Aujourd’hui il parait que je suis un senior mais mon enfant intérieur est toujours rieur, frondeur et plein de vie. Un conseil, pensez à vous aimer, à vous respecter…le système immunitaire, ça vous dit quelque chose? C’est l’une des clés d’une vie meilleure loin des politiques ambiantes mortifères et microniennes.
Francis Cousin ne dit-il pas lui même à travers Hegel : «Le tout est le vrai, le vrai est le tout»
Il monte à l’assaut passionnément de la vie des idées, comme un guerrier à découvert et bien entendu très exposé.
C’est un fourmillement de concepts aux horizons évoluant entre infini, essentialisme et existentialisme parménidien. Entre Hegel l’évangéliste dialecticien, en toile de fond christique et Marx né malgré lui dans l’univers du pentateuque mais fruit d’Epicure, de Démocrite et formé à la triade hegelienne qu’il a renversé sans pour autant l’abolir. Cela m’évoque les deux perspectives qui semblent contradictoires, puisées à Babylone par Abraham 15e.siècle avant Jésus : « Dieu créa l’homme à son image» repris autour du 8e.siècle par Homère «to eon esti» l’étant est, «l’existence est essence»l’homme est Dieu. La forme est inversée, le très fond similaire. Des mots, nous n’avons que des mots pour traduire nos limites humaines abyssales, pourtant auréolées de l’essentiel.
J’avais oublié ma première intervention.
Encore moi, cela devient indécent. Il est vrai que le langage de Francis est fréquemment baroque, ampoulé, complexe, mais pas uniquement. Amateur de tous les arts, les débordements colorés et bruyants me rappellent nos confrontations à l’art lyrique depuis le pâle quotidien de nos jours répétitifs. Comme à l’opéra il faut se laisser porter par la puissance musicale en oubliant la signification du livret.
Le baroquisme n’est pas tout chez Francis Cousin, ses déferlantes vocales viennent aussi du ventre, un autre cerveau que bien des intellectuels glaçants semblent ignorer. Ce cerveau en prise avec l’inconscient collectif jungien, nous parle sans doute des penseurs matinaux, dans leur solipsisme, les physiologues… »ces fragments inachevés, ces papyrus de marbre dont la lumière, comme celle des étoiles mortes nous vient d’un autre temps »…les messages sont captés par les humains dans leur simplicité. C’est un aspect de la pédagogie. Certains nivaux de consciences nous sont finalement inconnus, mais la magie opère. La critique, bien sur, la critique de la critique également, mais la poésie traverse l’inspiration philosophique par delà les tragédies de la Grèce archaïque et nous enseigne toujours. L’inconvénient majeur c’est que je n’obtiens pas de réponse mais il m’est permis de me laisser aller. Merci pour cela.
Francis Cousin est indépendamment des paroisses idéologiques, indépendamment des vérités qu’il pourrait énoncer, qu’un pervers manipulateur.
L’attaquer sur ce qu’il dirait n’a pas de sens, il faut l’attaquer sur ce qu’il est, un pervers.
Abstraction faîtes des couleurs de l’arc-en-ciel moins la couleur du ciel, c’est à dire bleue, n’est pas profond. C’est du verbiage alambiqué provenant des universités allemandes décadentes, dont Hegel est le remarquable représentant.
Pauvre Felts. On ne sait pas forcément qui tu es mais on voit tout de suite d’où tu viens: le territoire frustré des pauvres produits incultes de la contre-révolution.
Le riche Charles qui ne sait parler que par le négatif mettant en lumière sa nature, racontant forcément qui il est – on – nous en apprend sur son lieu de résidence, dont je me fiche, un territoire produit de cultures, avantagé en soi et révolutionnaire.
Moins le langage alambiqué et le récit de textes appris par coeur que reste-t-il du pervers ?Une effluve nauséabonde.
L’outrecuidance du monde des artifices de la crise mortelle du Capital est pleine d’insultes stupides de petit format destinées à l’auto-glorification de déchets existentiels accessoires qui n’ont pour seul mérite de grandeur ratée que de ne pouvoir nous parler que de leur nombril réformiste blessé de pauvres types incapables radicalement de saisir l’Histoire accomplie de la sève présente.
Leur système narcissico-dépressif est sans intérêt et leurs opinions d’esclave sans valeur.
La grande différence qui signale les destins d’épaves est que de toute évidence, les nains impuissants tourmentés se souviennent plus de Hegel,Marx, Debord ou Cousin que l’histoire, elle, gardera la moindre trace de ces obscurs représentants de commerce du capitalisme pathologique le plus trivialement habituel.
Allons donc à l’essentiel:
« Au lieu du mot d’ordre conservateur: « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire: « Abolition du salariat ». »
Salaire, prix et profit
Karl Marx, 1865
Diane Claire Cousin, mesdames, si vous pouviez cessez vos enfantillages puérils. Un petit pas pour l’homme un bond de géant pour nos oreilles.
Kévin aime le sociétal, vous-même en tant que révolutionnaire amoureux de la libre parole, pourquoi donc en incarnation transcousinienne ne pas aller, d’une main fraternelle et plus si affinité, féconder ces terres fertiles, arides voir ménopausées de vos riches conseils, ce catéchisme syncrétique des présocratiques, du Christ jusqu’à Hegel, Marx et Debord, ainsi en le lâcher inonder les organes prêts à recueillir le div logorrhée sacral et laisser les pauvres types à leurs croyances contre-révolutionnaires.
Certains se croient révolutionnaires radicaux à jacter à propos de faits divers sordides sur YouTube, l’histoire les reléguera aussi, inutile dans faire tout un fromage. Fromages dont Chesterton nous a rappelé que les poètes avaient été peu prodigues à leurs sujets.
Finalement, tout se résume à cet essentiel:
» Au lieu du mot d’ordre conservateur: « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », les prolétaires doivent inscrire sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire: « Abolition du salariat ». »
Salaire, prix et profit
Karl Marx, 1865
» Ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d’État ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident. Et l’État moderne n’est à son tour que l’organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L’État moderne, quelle qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’État des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. »
Anti-Dühring
F. ENGELS, 1878
Tout le reste est sans intérêt et nous rappelle que la gauche est bien simplement la gauche du Capital.