Le projet politique coagulé par Donald Trump et celui de la gauche libérale issue de la déconstruction, désignée plus médiatiquement sous la bannière « woke », sont moins hétérogènes que ce qu’il n’y parait. Toutes deux conséquentes à la frustration éprouvée par les masses américaines envers la faillite de la promesse libérale – mythologie fondatrice du contrat social américain – ces mouvances politiques proposent une exaspération des finalités axiologiques du projet néolibéral plutôt qu’une alternative concurrente. Cependant, la surprenante propriété de ces deux mouvances est qu’elles défient, voire récusent frontalement, la procédure politique libérale elle-même. L’éthique de la discussion, la référence à l’universel, la tolérance sont autant de principes qui, mis à mal, cèdent la place à des mécanismes violents de confrontation que le libéralisme, cru triomphant, devait pourtant avoir extirpés.
Crise de la mythologie libérale
La crise de civilisation interne qui traverse les États-Unis est à mettre en lien étroit avec la crise de la mythologie libérale. Support axiologique du contrat social anglo-saxon, fondation autant que téléologie, la doctrine philosophique du libéralisme constitue le socle inaliénable sur lequel se formule et développe la pensée politique et sociale des États-Unis. Mais à l’épreuve de l’histoire et de ses rapports de force matériels ─ qui eux, bien réels, s’affranchissent volontiers des cadres d’une éthique philosophique structurée comme celle du paradigme libéral ─ force est de constater que la promesse libérale a connu un effritement dramatique depuis la crise financière de 2008, devenue par la suite crise structurelle et civilisationnelle.
Cette promesse, typiquement relayée dans l’infortunée idée d’une fin de l’histoire, épouse les thèmes connus du modèle américain : une classe moyenne prépondérante et hautement consumériste ; un individu empowered libre de disposer de ses choix et de ses contraintes ; une relative égalité des chances faisant de contrepoids aux inégalités de départ ; une conception forte de la liberté de penser et d’agir ; et enfin une prospérité économique apte à compenser l’augmentation des inégalités de revenu établies par la politique reaganienne depuis les années 1980.
Mais cette mythologie sur laquelle se fonde le contrat social a été trahie à l’épreuve des faits. Progressivement, depuis les années 2000 la classe moyenne est en chute libre, la mobilité sociale diminue et des dynamiques féodales trouvent terreau fertile dans la déliquescence du pacte commun. La prospérité économique promise s’est mutée en un ralentissement de la croissance, les délocalisations d’industrie et la tertiarisation aliénante des bas salaires, avec un transfert majeur de richesse vers la rente financière.[1] La méritocratie est bloquée, le mécanisme ayant été coopté par les familles patriciennes pour garantir leur reproduction sociale. La liberté de penser et le débat sont offusqués par des déferlantes de violence, une culture du soupçon diffus et la polarisation exacerbée des idées.
« La doctrine philosophique du libéralisme constitue le socle inaliénable sur lequel se formule et développe la pensée politique et sociale des États-Unis. »
Ce décalage entre promesse et réalité n’a cessé de se creuser depuis l’époque reaganienne jusqu’à sembler aujourd’hui s’être transformé en un abysse. Ce même abysse qui sépare les communautés cloisonnées qui composent la société américaine, cultivant un entre-soi qui correspond à autant de chambres d’écho. Les victimes des politiques néolibérales de redistribution des richesses vers le haut, c’est-à-dire l’extrême majorité des citoyens, sont happées dans la frustration de l’idéal trompé, la douche froide de la trahison. C’est ainsi que la mythologie libérale en crise produit un ressentiment croissant dans tous les pans de la société : non aiguillé vers une lecture structurelle des rapports sociaux – anti-marxisme oblige – il sera façonné par les discours identitaires et culturels qui proposent, à la carte, des ennemis typés et facilement identifiables.
L’exaspération néolibérale
Les phénomènes que je désignerai, par raccourci, « woke » et « Trump » sont tous deux les produits de cette frustration. Mais il ne faudra pas s’y tromper : plutôt que de proposer une alternative au néolibéralisme qui inexorablement érode le périmètre du commun, ces deux mouvements en constituent à leur manière un projet de revitalisation.[2] C’est que dans la culture politique américaine contemporaine il n’y a pas d’au-dehors possible au néolibéralisme, ou du moins, de ses axiomes : l’individu comme méthodologie, le contrat comme opérateur, le marché comme institution. Les projets woke et Trump proposent ainsi de corriger la promesse faillite du libéralisme par… l’exaspération du néolibéralisme.

Donald Trump lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC), Floride, février 2022, sous le slogan politique « Awake Not Woke ». Crédits : Hermann Tertsch et Victor Gonzalez.
Du coté de Donald Trump, il s’agira de restaurer les promesses classiques qui firent le succès du siècle américain : consumérisme, pouvoir d’achat diffus, baisse des impôts, propriété, libre entreprise, État minimal, primauté internationale. En somme, les canons de l’American dream. Du coté liberal, la restauration portera la matrice de la Cultural theory théorisée dans les milieux universitaires depuis les années 1980 : exaltation des identités spécifiques, émancipation de l’individu, déconstruction méthodique des contraintes résultant de son encastrement dans le rapport social, avec pour effet de masquer la progressive érosion des droits économiques et sociaux par la prolifération de droits individuels. Du refus fanatique de la contrainte, Trump en est enfin l’archétype. Une idée commune permet de juxtaposer ces deux mouvances : si la promesse libérale a failli c’est qu’elle n’a pas été déployée pleinement, quand bien même l’effritement du commun et les inégalités croissantes semblaient déjà en dévoiler les limites.
« La méritocratie est bloquée, le mécanisme ayant été coopté par les familles patriciennes pour garantir leur reproduction sociale. »
Typologie des mouvances
Toutefois, jusque-là on ne saurait s’étonner : si les deux mouvements proposent une vision incapable de dépasser la grammaire de l’individualisme et du marché, c’est que l’horizon politique des possibles dans la matrice anglo-saxonne contemple difficilement un « ailleurs » de la grammaire néolibérale. Cette promesse inachevée, voire trahie car effectivement dérobée par les élites, on ne pourra donc la réaliser qu’en exaspérant ses principes. En ce sens, les deux camps adverses prolongent l’affrontement déjà établi entre un libéralisme de gauche empreint de Cultural studies, déconstruction et intersectionnalité, et un libéralisme de droite conservateur orienté à la croissance économique et à l’entreprenariat.
Le but ici est de mettre ces deux mouvements en vis-à-vis pour découvrir qu’ils ont plus en commun que leur seule axiomatique. Je vais essayer de mettre en lumière plusieurs traits distinctifs qui assimilent leur mode opératoire, leur « façon de faire », qui les distinguent des formes militantes politiques précédentes.
1/ Le ressentiment généralisé est érigé en lanterne politique. De la cancel culture à la violence verbale et symbolique de Trump, l’animosité est désormais devenue vecteur légitime de la façon même de faire et de communiquer la politique, mais également d’en définir les fins.
2/ Méfiance vis-à-vis du débat démocratique et de l’éthique discursive. Le procédé classique du débat d’idées fondé sur un référent universel et unique, celui de la raison objectivable, est mis à mal. D’une part, certains héritiers de la déconstruction parachèvent l’élimination méthodique du référent externe, ce « troisième pôle » pourtant indispensable à l’éthique de la discussion. Écartant la possibilité même que puisse exister un débat paritaire ─ car les « règles du jeu » incorporent et reproduisent immanquablement la domination d’un groupe sur les autres ─ le dialogue argumenté ne peut en toute logique que servir des intérêts spécifiques.[3] Du côté du trumpisme, la possibilité d’un débat illuminé est écartée d’emblée par la logique assumée de la loi du plus fort.
3/ Pratique de la censure. Les faits de censure de conférences et de professeurs qui ont lieu dans les universités américaines, évacuant les positions non alignées sur le paradigme de la gauche woke, forment un pendant significatif avec la censure institutionnelle de livres et manuels scolaires, voire de théories entières, dans certains États conservateurs. Le passage de la cancel culture d’une pratique individuelle puis collective et enfin institutionnelle n’est vraisemblablement qu’affaire de degré.
4/ Essentialisation de l’adversaire à son « appartenance » de race, genre, orientation sexuelle, position sociale, clan, etc. C’est peut-être la tendance la plus dangereuse, d’autant plus surprenante que ce vice devait être finalement vaincu par le constructivisme, qui s’est établi justement contre l’idée qu’il existe des « essences » propres aux groupes humains. Mais ce qui fut évacué par la porte revient par la fenêtre : car les mouvements militants issus de l’intersectionnalité montrent une propension à assigner les individus à des traits distinctifs essentialisés comme l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la race, le statut, l’histoire nationale, les faisant finalement rentrer de force dans des catégories a-historiques dont l’hérédité les définit sans échappatoire, ce qui permettra de mettre en lumière les rapports de domination entre individus. Les relations entre ces groupes seraient agencées par une dynamique mécaniste et prévisible, dont la domination serait la seule lecture pertinente.
Ainsi l’individu est dépossédé de l’échappatoire du libre arbitre, pourtant socle fondateur de la philosophie européenne, et sera plutôt qualifié par son appartenance choisie ou héritée. Ce qui par ailleurs ne manque de reproduire la vielle logique de la délégitimation via la culpabilité héritée, cette fois selon un mode bourreau-victime dont le périmètre s’étend de l’homme occidental blanc hétéro jusqu’aux individus à l’intersection de races subalternes, handicaps, genre et orientations sexuelles minoritaires, dans un continuum que la recherche sociale se fixe de révéler.[4] Dans le camp réactionnaire représenté par Donald Trump, la même essentialisation servira à figer les ennemis de l’Amérique dans leur adversité : noirs, latinos, gauchistes, non croyants, musulmans, et ainsi de suite. Les catégories foisonnent, la logique est analogue.
5/ Communication ajustée aux réseaux sociaux. Il est fait un usage intensif et préférentiel des réseaux sociaux pour la communication stratégique et la diffusion des idées. De la cancel culture à la communication mystificatrice et pulsionnelle de Trump, ce sont les modalités de communication propres aux réseaux sociaux qui débordent sur la réalité plutôt que l’inverse. Ainsi l’appauvrissement du langage, la brévité des contenus, la rapidité de connexion et déconnexion, la surenchère cognitive apte à générer de l’audience, la sémiotique pulsionnelle plutôt que rationnelle, en somme les traits distinctifs de l’arène social media, ne constituent pas tant le canal communicatif majeur de ces mouvements, qu’ils ne sont devenus les conditions mêmes de la production et circulation des idées : immédiates, simples, transposables, scalables, clivantes.
« Le procédé classique du débat d’idées fondé sur un référent universel et unique, celui de la raison objectivable, est mis à mal. »
6/ Banalisation de l’adversaire et polarisation violente des camps. De l’inflation quantitative de la communication coïncidant avec sa déflation qualitative, s’ensuit la polarisation violente entre les camps dont le « clash » est la forme de typique de rapport. Si le flux continu des réseaux sociaux ne permet même pas l’approfondissement des contenus nécessaire à soutenir une confrontation d’idées, ce sont plutôt l’accusation, la délation, l’insulte et le débordement émotionnel impulsif qui balisent le champ expressif. D’une part, les adversaires du camp woke seront définis par renvoi sans appel aux catégories ennemies : racistes, sexistes, passéistes, spécistes, fascistes, -istes dont la continuelle prolifération éveille pourtant des soupçons quant à la consistance de l’apparat théorique d’ensemble.
D’autre part, la virulence et la facilité avec laquelle le trumpisme renvoie ses adversaires à des catégories non moins abstraites telles que les « ennemis de l’Amérique », les « traîtres » et les « criminels », étiquettes assez larges pour héberger tous les critiques envers le regain réactionnaire ou envers les faux de la post-vérité, dénote la même tendance à banaliser l’adversaire. Voire à le construire de façon idéale par le biais de torsions linguistiques et d’interprétations abusives de la réalité destinées à assigner les personnes aux catégories préfabriquées qui, tant elles sont vides de substance nécessitent de prouesses rhétoriques, voire de diffamations, pour accueillir un spectre d’ennemis variable mais nécessaire selon le combat spécifique.[5]

« Five Years, Thousands of Insults: Tracking Trump’s Invective » : https://www.nytimes.com/2021/01/26/insider/Trump-twitter-insults-list.html
7/ Si face à l’accélération du creusement des inégalités, en particulier de distribution du patrimoine, l’on pouvait s’attendre à la reformulation du concept de classe, donc d’une lecture au moins partiellement matérialiste de la réalité, il n’en est rien. La classe sociale est le grand absent. L’évacuation du concept de classe est à juxtaposer au foisonnement de catégories de matrice culturelle et identitaire, dont l’ontologie est par définition toujours flottante et incertaine, puisque produite uniquement par des « narrations ». Un marxisme désormais désuet entendait réduire l’intégralité du monde social à des rapports matériels économiques ; les mouvements woke et Trump à des représentations.
8/ Enfin, l’attitude sur le terrain judiciaire a le goût amer du tribunal sommaire. Réseaux sociaux aidant, les deux camps se livrent à un feu croisé de condamnations immédiates, sans débat et sans recours. La culture spectaculaire du clash se matérialise dans la cancel culture et le naming and shaming qui, employés par les deux camps, sont les nouveaux modes d’un règlement des différends dont la forme est inquisitoire : mes valeurs sont les bonnes, tu es un ennemi, tu es condamné et écarté. Il convient de rappeler que ce mode sape les fondements de la conception libérale de justice qui repose sur le droit à la défense et la primauté du doute.
Le fait surprenant est que les instruments mis en œuvre par les camps adverses nient les procédures de traitement du conflit propres au paradigme libéral. Car celui-ci encadre typiquement la conflictualité politique dans un débat exigeant le respect de la personne, la tolérance envers l’adversaire, la liberté de parole et d’expression, l’auto-censure de l’impulsion émotive, mais surtout la référence commune à une forme de rationalité à même de révéler une réalité objective que toutes les parties reconnaissent au terme du processus de délibération rationnelle.
Ce « troisième pôle » que les développements théoriques la déconstruction ont précisément œuvré à démanteler. Ce paradigme qui, somme toute, a régi le gros de la confrontation politique mainstream depuis l’après-guerre jusqu’aux années 2010, semble aujourd’hui imploser. L’étonnement ne découle donc pas tant du fait de l’adhésion au projet néolibéral commune aux deux camps, qu’à leur recours diffus à des procédés illibéraux dont la brutalité et la célérité épousent l’air du temps. Car la liquidation de la référence à un instance régulatrice tierce, que ce soit la vérité ou la procédure, débouche mécaniquement sur le renfermement diffus dans sa propre chambre d’écho. En rendant impossible la reconnaissance de l’altérité, elle évacue la potentialité même de son intégration.
Aggravation néolibérale
Pourquoi j’estime que ces mouvements constituent-ils une exaspération du projet néolibéral et non pas une critique via une alternative ? Car en premier lieu il me semble que dans les deux projets politiques, le rapport à l’altérité demeure typiquement instrumental à la réalisation du sujet-individu. D’une part, la déconstruction de gauche exalte les propensions individuelles et les spécificités dans une vision négative de la liberté entendue comme affranchissement des contraintes, évacuant tout ce qui dans la physique des relations voire du langage pourrait constituer un obstacle à la libre détermination, dont une imaginaire volonté originaire et pure du sujet constituerait le fondement.
D’autre part, la mythologie trumpienne offre l’imaginaire de liberté propre au rêve américain : individu souverain, État minimal et refus des contraintes posées par la vie en société, par l’écosystème et jusqu’au droit international. La politique étrangère américaine pourrait bien se renouveler sur un mode de prédation qui semblait pourtant avoir été chassé hors de l’arène du multilatéralisme. Au moins l’un des mythes du paradigme libéral a-t-il enfin été déboulonné : l’histoire ne suit pas un progrès linéaire.

Elon Musk et le président argentin Javier Milei à la convention CPAC, la grand-messe des conservateurs américains près de Washington
La Critical theory issue de la déconstruction, qui plasme massivement la vie politique américaine contemporaine, défend que l’intégralité des convictions de chacun ne soit que le fruit des procédés socioculturels dans lesquels la personne s’est constituée. La nature humaine est infondée ; par conséquent, aucune essence transversale aux humains n’est envisageable. Il n’y a donc pas d’objectivité possible mais uniquement des « régimes de vérité » au sens foucauldien, encastrés dans les narrations concurrentes de chaque groupe qui vise à dominer les autres. La seule issue est donc naturellement le conflit des narrations entre groupes dans un horizon de lutte purement culturaliste, où il s’agira d’opposer notre discours de vérité aux discours dominants en s’identifiant dans un groupe occupant une position subalterne.
Cette conception du monde des idées comme un marché vaste, fluide et atomisé où se joueraient la concurrence entre identités individuelles opérant entre elles des alliances temporaires et localisées, rappelle le voisinage du courant woke avec la grammaire néolibérale. La conséquence est la tribalisation de la vie politique et sociale américaine, vieille hantise nationale contre laquelle la fondation des institutions gouvernementales devait pourtant servir de balance.
Dans cette optique, les mots et les discours eux-mêmes ne sont autre que le vecteur de la volonté d’imposer sa propre narration sur celle des autres, la possibilité d’une vérité objective ayant été évacuée. Mais ici se joue l’abysse discret qui différencie la Critical theory américaine à la Théorie critique sociale de matrice européenne. Pour la première, reconnaitre un sujet, un adversaire, un concurrent, signifie déjà l’encastrer dans une certaine narration, partant l’étiqueter afin de le manipuler en contraignant ce qui émanerait d’une « liberté originaire » du sujet.
« L’individu est dépossédé de l’échappatoire du libre arbitre, pourtant socle fondateur de la philosophie européenne, et sera plutôt qualifié par son appartenance choisie ou héritée. »
En revanche, la théorie critique européenne considère l’Autre non seulement comme un potentiel obstacle, mais aussi comme une ressource pour la fabrication de ma propre identité. C’est que dans la tradition continentale, la singularité de l’individu est comprise et forgée dans une nature positivement relationnelle de l’humain, permettant ainsi de dégager une objectivité et donc d’identifier des caractéristiques transversales à tous les humains : en premier lieu, une notion de rationalité partagée ainsi que la reconnaissance légitime du point de vue de l’autre, éléments constitutifs du logiciel politique libéral. Éléments qui semblent être devenus définitivement ringards dans l’affrontement politique contemporain aux États-Unis. Si les mouvements politiques aux États-Unis se focalisent sur une acception négative de la liberté (être libre des contraintes), la théorie critique européenne en développe plutôt une acception positive (être libre de faire).
Processus de tribalisation
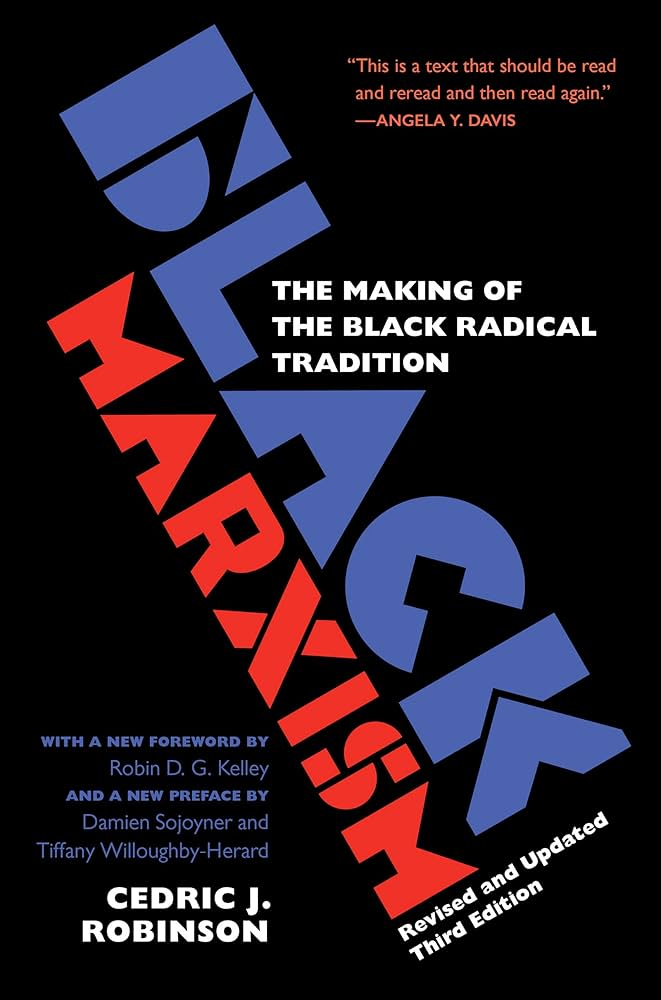 La tribalisation en cours nie la possibilité de dépasser les frontières, souvent superficielles, de son « groupe » possédant sa propre « narration ». Il devient ainsi soupçonneux de tenter de se mettre à la place des autres pour en comprendre l’univers ; le faire ne correspond pas à de l’empathie mais à une « appropriation » utile à voiler l’entreprise de domination. Dans la guerre des narrations il n’y a pas de singularité du sujet au-delà de son appartenance tribale, ni de possibilité d’adopter une attitude réflexive, c’est-à-dire de savoir se placer au-dehors de sa propre condition.
La tribalisation en cours nie la possibilité de dépasser les frontières, souvent superficielles, de son « groupe » possédant sa propre « narration ». Il devient ainsi soupçonneux de tenter de se mettre à la place des autres pour en comprendre l’univers ; le faire ne correspond pas à de l’empathie mais à une « appropriation » utile à voiler l’entreprise de domination. Dans la guerre des narrations il n’y a pas de singularité du sujet au-delà de son appartenance tribale, ni de possibilité d’adopter une attitude réflexive, c’est-à-dire de savoir se placer au-dehors de sa propre condition.
C’est pourquoi autant les mouvements culturalistes de gauche que de droite n’arrivent plus à historiciser, mais établissent des paramètres de jugement absolus et rétroactifs. Plus rien ne peut contenir la création de vérités alternatives, vu qu’il n’y a pas d’au-dehors de la narration. En toute logique, il conviendra donc de censurer dans l’enseignement des livres qui incommodent nos propres vérités, que cela vaille pour la théorie de l’évolution ou la théorie du genre, jusqu’à la suppression de pans entiers des lettres classiques car produites par des auteurs qui à l’époque actaient des comportements aujourd’hui considérés sexistes.
Ce cadrage conflictuel « Woke vs Trump » est abondamment importé en Europe par un calque quasiment acritique. Réflexe européen invétéré qui consiste à se parer des habits usés du maître en oubliant d’y apporter les nécessaires retouches par translation, débouchant souvent sur un effet clown. Il faudrait pourtant se pencher sur l’affaire et se demander quelle est la valeur de cette transposition. L’histoire politique européenne présente un éventail de ressources analytiques et procédurales assez large pour mettre en lumière l’étroitesse du champ dans lequel se joue le débat américain contemporain.
Tout d’abord, en Europe il existe un hors-champ du libéralisme qui, bien que monté en épouvantail par la doxa néolibérale de tous partis, alimente néanmoins les imaginaires politiques. De la tradition communiste à celle sociale-chrétienne, à l’antirépublicanisme réactionnaire pour faire quelques exemples, la dimension du rapport à l’Autre est plus articulée dans la philosophie politique continentale que dans l’univocité contractualiste de la tradition anglo-saxonne.
« Un marxisme désormais désuet entendait réduire l’intégralité du monde social à des rapports matériels économiques. »
L’importation de ce cadrage conflictuel en Europe, entrepris à la fois par les milieux de la déconstruction critique et par une extrême droite avec le vent en poupe, risque de dissoudre dans le trou noir du nihilisme conséquent au constructivisme exaspéré nombre de ressources philosophiques et politiques émanant à la fois de l’histoire de la pensée européenne que des apports contemporains résultant du métissage par les migrations. Aux États-Unis, là où la liberté individuelle reste à tous égards la valeur cardinale, la déconstruction et les théories culturalistes portaient un projet compatible avec le mythe libéral de l’extension indéfinie du périmètre de liberté individuel. Rendue vaine l’adhésion à une vérité partagée, chacun a pu éprouver à son avantage la fabrication d’une identité et de convictions singulières ne devant rendre de comptes à personne.
Mais à l’ère de la post-vérité et de la tribalisation violente, c’est en fin de compte le camp du plus fort qui l’emportera : celui qui a les meilleures assises institutionnelles, médiatiques et financières. Ainsi la victoire de Donald Trump. L’exaspération de la grammaire néolibérale aura donc réussi à produire la hantise du libéralisme classique, ce contre quoi ont été bâties ses institutions et ses procédures : la guerre de tous contre tous, donc la victoire du plus fort.
Andrea Comin
Nos Desserts :
- Sur Le Comptoir, lire notre article « Le fascisme, nous y voilà : quelques clarifications sur la situation actuelle »
- Nous avons interviewé Renaud Garcia par deux fois : « L’aliénation est un phénomène central du capitalisme » et « Le militantisme “woke” ne cherche pas à convaincre mais à régenter la vie des autres »
- « « Wokisme » : pourquoi ce mot est piégé » sur Mediapart
- « L’ère du wokisme de droite : généalogie de l’arc Douguine-Musk » sur Le Grand Continent
- Analyse de l’idéologie Dark Maga sur la chaîne Osons Causer
Notes
[1] Sur ce thème voir les travaux de Thomas Piketty
[2] Dans cet article, je qualifie de « néolibéralisme » non pas tant la doctrine économique du Washington consensus, ni même les théories économiques néoclassiques et monétaristes, mais plutôt le projet politique d’extension illimitée du marché comme institution de régulation sociale, et de l’homo economicus comme seule forme légitime d’existence du sujet. Le terme « libéralisme » indique plutôt les valeurs et les principes républicains et démocratiques faisant de socle au contrat social.
[3] Voir Renaud Garcia, Le désert de la critique. Déconstruction et politique, L’Échappée, 2021.
[4] Cette structure de distribution et de circulation des culpabilités n’est pas sans rappeler l’influence importante de l’éthique protestante dans les mouvements mêmes qui se proposent de la dépasser.
[5] Voir à ce sujet Umberto Eco, Construire l’ennemi, Grasset, 2014.
Catégories :Politique



Merci aux lecteurs pour les premières importantes critiques qui me sont arrivées. Je me dois de faire quelques précisations.
Cet article ne veut absolument pas faire le jeu des néo-fascistes et des réactionnaires haineux qui supportent des identités essentialisées, un programme politique célébrant la loi du plus fort et se complaisant dans leur ignorance assumée de l’Autre. Je comprends que le recours à des catégories génériques comme « woke », « libéral » ou « trumpisme » est glissant. La cible de ma critique n’est pas l’ensemble des luttes militantes féministes, décoloniales, antispécistes, qui sont d’une diversité telle qu’on ne saurait y trouver une trame commune. La cible de ma critique est un ensemble spécifique de théories issues de la déconstruction (ou « French theory »), au paradigme libéral et d’origine anglo-saxonne, qui promeuvent « l’émancipation » comme critique radicale de toute dimension supra-individuelle et s’attellent à la négation de l’idée même de contrainte. Ces théories qui finalement trébuchent sur le fait que la contrainte, l’asymétrie, la tension sont incorporées déjà dans l’acte linguistique même. C’est cette vision-ci, vastement présente aussi dans les milieux libertaires post-marxistes, qui est homogène avec la grammaire néolibérale. C’est ce que je nommerai la déconstruction comme idéologie politique.
Au contraire, j’attribue un grand crédit à la déconstruction comme méthode philosophique. Elle a prouvé être puissamment fertile pour mener la critique des structures cognitives qui re-produisent des biais ou des inégalités structurelles: sexisme, spécisme, ethno-centrisme, racisme, rationalisme radical, etc.
C’est donc une part – minoritaire et surtout anglo-saxonne – des luttes « de gauche » et intersectionnelles que je vise dans l’article, en voulant montrer qu’elles ne sauraient être une alternative au programme de gouvernementalité néolibérale. Et qui de plus recourent à des modes intolérants, agressifs et a-rationnels, finissant hélas par se confondre avec leur adversaire!
Les mouvements féministes et décoloniaux de tradition marxiste; ceux de la perspective écologiste; ceux de la perspective chrétienne ou encore ceux qui nous invitent à un décalage avec l’épistémologie occidentalo-centrique, sont, au contraire, des idées qui pensent une émancipation hors des cadres du néolibéralisme. Ainsi l’écart entre les Histoires, les traditions intellectuelles et les structures cognitives devraient nous rendre plus critiques envers les importations directes des Etats-Unis. Il faudrait du moins restaurer le filtrage par les « douanes »… 🙂
Salutations à l’auteur.Je n’aurais qu’un souhait à émettre à propos de cette critique, ou de ce panorama réflexif, dont les grandes lignes m’apparaissent à la fois argumentées et intéressantes.
Mon souhait est le suivant : si l’on conduit une analyse de la destruction du langage (par accaparement, polarisation, médiatisation interposée), il serait plus convaincant – de beaucoup- d’employer :
des mots qui existent. Brièveté, par exemple, plutôt que « brévité ».
Des mots dans leur sens propre : suspect = suscite la suspicion. Soupçonneux = attitude d’un sujet, qui éprouve le soupçon.
Traduire les forgeries fantaisistes : le verbe « plasmer » existe en moyen français. On ne le parle plus depuis le XVIIè siècle.
Autant je veux bien faire le deuil de l’auxiliaire « être » devant « convenir », quand bien même il est absurde et contraire à la logique de la langue (convenir est formé sur « venir ». On ne dit pas « j’ai venu ». Et donc on pourrait réfléchir, s’en rendre compte et conclure que « nous sommes convenu.es » se tient mieux), mais puisque l’ »évolution » orale l’atteste de plus en plus fréquemment, admettons-le.
Autant quand on défend dans un propos construit la possibilité que le terrain de la langue soit par excellence le lieu du commun, ce ne serait pas absurde de faire attention aux gens qui vous lisent. D’anticiper, donc, en se demandant si on parle de la même manière que son groupe social singulier, ou bien pour un groupe plus large, qui est tout le long de l’article visé comme étant le propre d’une société qui peut encore s’entendre.Veiller à ne pas miner de l’intérieur son argumentation. Vous pouvez apporter les corrections suggérées et effacer ce commentaire.
Bien à vous,
CM