- Le carrousel des ombres, Paul Serey, Éditions des Équateurs, 2019 [1]
- La recomposition des mondes, Alessandro Pignocchi, Le Seuil, 2019 [2]
- Le Corbusier, un fascisme francais, Xavier de Jarcy, Albin Michel, 2015 [3]
- Oreiller d’herbes, Natsume Soseki, Rivages, 2015 [4]
- Lettre au dernier Grand Pingouin, Jean-Luc Porquet, Verticales, 2016 [5]
- La force de l’ordre : Une anthropologie de la police des quartiers, Didier Fassin, Seuil, 2011 [6]
- La Promesse de l’aube, Romain Gary, Gallimard, 1973 [7]
Romantisme noir en Sibérie [1]
 Tout commence dans les méandres d’un esprit tourmenté, en proie aux affres du désespoir, dont nous suivons page à page les égarements et les doutes. « Exalté ou moribond, sur une lame tranchante ou sur un lit trop mou, je continuais la vie tout au bord de la mort. […]J’avais bien pensé mourir. Mais des forces énormes m’ont enveloppé, qui venaient de très loin, des terres infinies, du fleuve immense, là, aux confins des mondes, où j’avais échoué. » Ces forces, se sont en grande partie celles soulevées par les aventures du corps, en Sibérie, en Mongolie, aux Philippines, sur les traces du mystérieux baron Ungern-Sternberg ou au cœur d’une dérive sans but. Dans cet étrange et inclassable monologue, ni roman, ni poème, premier livre de son auteur, se mêlent romantisme noir, mysticisme ténébreux et haine viscérale du monde moderne, servis par une belle écriture.
Tout commence dans les méandres d’un esprit tourmenté, en proie aux affres du désespoir, dont nous suivons page à page les égarements et les doutes. « Exalté ou moribond, sur une lame tranchante ou sur un lit trop mou, je continuais la vie tout au bord de la mort. […]J’avais bien pensé mourir. Mais des forces énormes m’ont enveloppé, qui venaient de très loin, des terres infinies, du fleuve immense, là, aux confins des mondes, où j’avais échoué. » Ces forces, se sont en grande partie celles soulevées par les aventures du corps, en Sibérie, en Mongolie, aux Philippines, sur les traces du mystérieux baron Ungern-Sternberg ou au cœur d’une dérive sans but. Dans cet étrange et inclassable monologue, ni roman, ni poème, premier livre de son auteur, se mêlent romantisme noir, mysticisme ténébreux et haine viscérale du monde moderne, servis par une belle écriture.
La ZAD en BD [2]
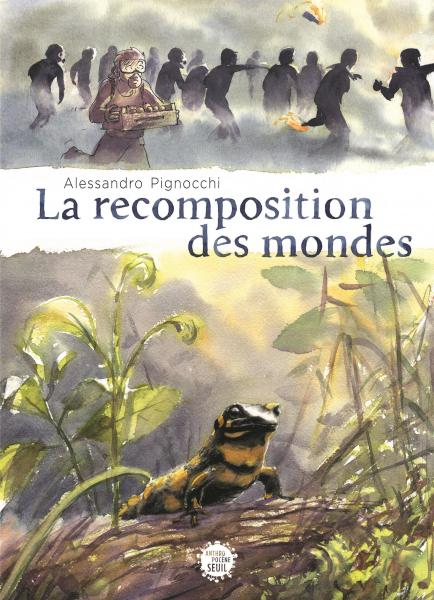 L’anthropologue-dessinateur Alessandro Pignocchi s’est rendu sur la ZAD de Notre-Dame des Landes au moment de l’opération policière et militaire qui a cherché à la détruire l’an passé. Dans ce petit livre plein d’humour et d’intelligence, il relate les événements tels qu’il les a vécus, les affrontements avec les forces de l’ordre et les tentatives pour sauver les maisons et les cabanes des machines venues pour les broyer, le tout dans le cadre si singulier du bocage, peuplé de boue, de tritons et de chouettes hulottes. Mais il ne se contente pas de relater les affrontements. Prenant acte du fait que la ZAD s’est opposée non seulement à l’aéroport mais aussi à son “monde”, il cherche également à montrer, en s’inspirant de l’anthropologue Philippe Descola, sous une forme très accessible et à travers de belles images, que les luttes dont celle-ci est le théâtre opèrent une véritable « recomposition des mondes ». Un peu à l’image des peuples amazoniens et d’autres peuples indigènes dans le monde, les habitants du bocage en résistance cherchent selon lui à instaurer un rapport à la Terre et aux animaux qui ne soit plus celui d’un sujet dominateur sur un objet dominé, mais des rapports de sujet à sujet, fondés sur l’égalité radicale et la réciprocité. Un beau livre, qui servira également à soutenir financièrement la ZAD, qui continue à en avoir besoin.
L’anthropologue-dessinateur Alessandro Pignocchi s’est rendu sur la ZAD de Notre-Dame des Landes au moment de l’opération policière et militaire qui a cherché à la détruire l’an passé. Dans ce petit livre plein d’humour et d’intelligence, il relate les événements tels qu’il les a vécus, les affrontements avec les forces de l’ordre et les tentatives pour sauver les maisons et les cabanes des machines venues pour les broyer, le tout dans le cadre si singulier du bocage, peuplé de boue, de tritons et de chouettes hulottes. Mais il ne se contente pas de relater les affrontements. Prenant acte du fait que la ZAD s’est opposée non seulement à l’aéroport mais aussi à son “monde”, il cherche également à montrer, en s’inspirant de l’anthropologue Philippe Descola, sous une forme très accessible et à travers de belles images, que les luttes dont celle-ci est le théâtre opèrent une véritable « recomposition des mondes ». Un peu à l’image des peuples amazoniens et d’autres peuples indigènes dans le monde, les habitants du bocage en résistance cherchent selon lui à instaurer un rapport à la Terre et aux animaux qui ne soit plus celui d’un sujet dominateur sur un objet dominé, mais des rapports de sujet à sujet, fondés sur l’égalité radicale et la réciprocité. Un beau livre, qui servira également à soutenir financièrement la ZAD, qui continue à en avoir besoin.
P. M.
Fascisme ou modernité ? [3]
Par son  titre le livre de Xavier Jarcy, Le Corbusier, un fascisme français, s’inscrit dans une controverse bien actuelle. Celle augurée dans les années 1970 par Zeev Sternhell dans son ouvrage La Droite révolutionnaire et qui, depuis, n’a cessé de faire couler de l’encre. Alors que la plupart des historiens français du fascisme tendaient à minorer la présence du fascisme dans la France de l’entre-deux-guerres, Sternhell, dans cet ouvrage polémique, affirmait que le fascisme était né dans la France d’avant la Première Guerre mondiale.
titre le livre de Xavier Jarcy, Le Corbusier, un fascisme français, s’inscrit dans une controverse bien actuelle. Celle augurée dans les années 1970 par Zeev Sternhell dans son ouvrage La Droite révolutionnaire et qui, depuis, n’a cessé de faire couler de l’encre. Alors que la plupart des historiens français du fascisme tendaient à minorer la présence du fascisme dans la France de l’entre-deux-guerres, Sternhell, dans cet ouvrage polémique, affirmait que le fascisme était né dans la France d’avant la Première Guerre mondiale.
Dans Le Corbusier, un fascisme français, Xavier de Jarcy prend d’emblée partie pour Zeev Sternhell et s’attache à démontrer les accointances fascistes du célèbre architecte, et le caractère fascisant de la modernité de béton qu’il promeut. L’auteur a épluché sa correspondance, épinglé ses amitiés suspectes (le docteur hygiéniste Winter, le maréchal Lyautey, quelques planistes ambigus, etc.) et pointe du doigt un réseau d’intellectuels et de revues (L’Esprit Nouveau, Plans, Préludes). Ces jeunes gens dynamiques rêvent d’un homme nouveau, façonné par le sport, le travail et le syndicat, qui « accepte de vivre en série », dans les « plans purs et les lignes simples ». Un taylorisme hygiéniste de la vie quotidienne, que ces technocrates théorisent sous la tutelle bienveillante des cercles patronaux. Reconnaissons-le, Xavier de Jarcy a mis en lumière le caractère prémédité de la “massification” – pour parler comme l’école de Francfort –, là où trop d’intellectuels y ont vu une conséquence inéluctable du capitalisme. Plus que ça, son travail permet d’entrevoir une généalogie de la technocratie à la française, prenant racine dans la France de l’entre-deux-guerres, prospérant sous le régime de Vichy, pour s’épanouir sous la IVe République.
On déplore néanmoins la hâte avec laquelle l’auteur relie à un fascisme nulle part défini tout ce que les intellectuels mentionnés ont de désagréable. La démonstration se fait donc par amalgame : Le Corbusier est scientiste, le fascisme est scientiste, donc Le Corbusier est fasciste ; ou bien, le docteur Winter prône l’hygiène par le sport, les fascistes aiment le sport, les deux hommes sont amis… Qu’importe que l’hygiénisme ou le scientisme fussent des doctrines en vogue depuis un siècle, ou que ces discours sur le sport fussent des lieux communs d’alors. On pourrait multiplier les exemples, déplorer que l’auteur cite surtout Bernard Henry Lévy et Sternhell, voire Anne-Marie Lacroix-Riz (l’auteur reprend la notion très polémique de « synarchie »), oubliant leurs contradicteurs… Le Corbusier, un fascisme français ouvre néanmoins un champ d’interrogations : la modernité était-elle un progrès, ou un projet de dystopie scientiste ? Si oui, quelle place a occupé le fascisme dans sa conception ? Espérons que d’autres travaux suivront, et éclaireront notre époque sous un jour nouveau.
Peindre avec des mots [4]
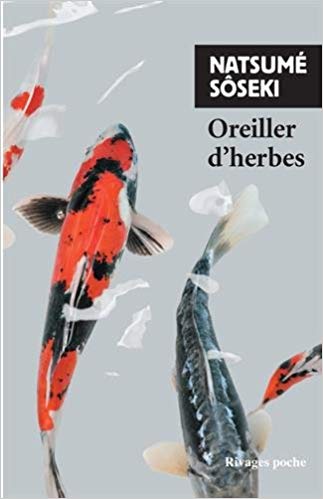 Oreiller d’herbes est un livre qui tient du génie. Il faut cependant ne pas être allergique aux grandes fleurs lyriques, ne pas avoir peur des eaux descriptives mouvantes et ne pas craindre le vertige des montagnes de détails ciselés. Cette œuvre n’est pas celle d’un poète mais bien d’un peintre qui utilise ses cinq sens pour capter la moindre vibration. L’extrême acuité de celui-ci, la délicatesse de son pinceau, permettent au lecteur un bond dans un univers sensible beaucoup trop absent de son quotidien. C’est un livre que vous ne réussirez pas à lire dans le métro, dans une salle d’attente ou même dans votre appartement. Il faut être dehors, avec le vent, le bruit des arbres, la chaleur du soleil, l’odeur des fleurs et les pieds-nus dans l’herbe fraîche du printemps. À ce moment-là, la lecture changera de forme, vous ne ferez plus attention ni aux mots, ni à l’histoire, vous deviendrez alors un personnage de son tableau en balade parmi les couleurs, les formes et les senteurs. Sans vous en apercevoir, vous regarderez l’horizon, fermerez le bouquin et vous serez toujours en train de le lire.
Oreiller d’herbes est un livre qui tient du génie. Il faut cependant ne pas être allergique aux grandes fleurs lyriques, ne pas avoir peur des eaux descriptives mouvantes et ne pas craindre le vertige des montagnes de détails ciselés. Cette œuvre n’est pas celle d’un poète mais bien d’un peintre qui utilise ses cinq sens pour capter la moindre vibration. L’extrême acuité de celui-ci, la délicatesse de son pinceau, permettent au lecteur un bond dans un univers sensible beaucoup trop absent de son quotidien. C’est un livre que vous ne réussirez pas à lire dans le métro, dans une salle d’attente ou même dans votre appartement. Il faut être dehors, avec le vent, le bruit des arbres, la chaleur du soleil, l’odeur des fleurs et les pieds-nus dans l’herbe fraîche du printemps. À ce moment-là, la lecture changera de forme, vous ne ferez plus attention ni aux mots, ni à l’histoire, vous deviendrez alors un personnage de son tableau en balade parmi les couleurs, les formes et les senteurs. Sans vous en apercevoir, vous regarderez l’horizon, fermerez le bouquin et vous serez toujours en train de le lire.
World penguin day [5]
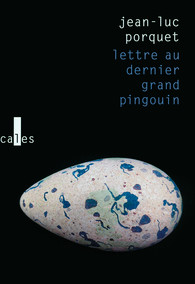 Alors que le 25 avril dernier avait lieu le World penguin day (certes plutôt dédié au manchot qu’au pingouin), se plonger dans le livre de Jean-Luc Porquet est de circonstance. Des espèces, il en disparaît silencieusement et imperceptiblement tous les jours – désormais la plupart du temps à cause de l’homme.
Alors que le 25 avril dernier avait lieu le World penguin day (certes plutôt dédié au manchot qu’au pingouin), se plonger dans le livre de Jean-Luc Porquet est de circonstance. Des espèces, il en disparaît silencieusement et imperceptiblement tous les jours – désormais la plupart du temps à cause de l’homme.
Dans ce flot continu d’extinctions, le cas de la disparition du Grand Pingouin (Pinguinus impennis) est probablement unique : on en connaît précisément le jour et le lieu. Après avoir été chassé par l’homme pendant des dizaines de milliers d’années, des pêcheurs islandais ont abattu les deux derniers spécimens connus de grands pingouins, sur l’île d’Eldey, le 3 juin 1844. Si Jean-Luc Porquet prend sa plume pour écrire au « dernier grand pingouin », c’est que la disparition de cette espèce constitue une allégorie tristement révélatrice du rapport de l’homme à la nature. En 1534, le navigateur Jacques Cartier notait dans son journal que les îles sur son passage étaient « si pleines [de grands pingouins] qu’il semble qu’on les y ait entassés », et que « tous les navires de France pourraient facilement [en remplir leur cale] sans que l’on aperçoive que l’on en a retiré ». Le grand pingouin servait alors de nourriture, de parure (ses plumes faisaient de magnifique chapeaux) et même… de combustible pour entretenir le feu sous les marmites des pêcheurs. Il faisait donc l’objet d’une chasse impitoyable. L’optimisme de Cartier sur l’inépuisable abondance de ces oiseaux fut vite démenti : à peine trois siècles plus tard, le dernier grand pingouin mourait étranglé de main d’homme. Pour ne pas que l’allégorie se transforme également en sombre prophétie, la lecture de Porquet (par ailleurs spécialiste d’Ellul) est salutaire. Mais une chose est sûre : à l’heure du désastre écologique et de la sixième extinction de masse, il faudra un peu plus que de dérisoires journées mondiales commémoratives.
Les baqueux et les bâtards [6]
 Pourquoi les jeunes de banlieues – et davantage les arabes et les noirs que les blancs – ont-ils raison de courir lorsque la police arrive ?
Pourquoi les jeunes de banlieues – et davantage les arabes et les noirs que les blancs – ont-ils raison de courir lorsque la police arrive ?
L’observation minutieuse d’une brigade anti-criminalité (BAC) de Seine-Saint-Denis nous permet de comprendre. L’ouvrage du sociologue Didier Fassin révèle les rouages de cette police de terrain, créée dans les années 1970, et devenue, vingt ans plus tard, le bras armé d’une politique sécuritaire renouvelée. Pour lutter contre le sentiment d’insécurité – l’auteur met en évidence la baisse constante et régulière des chiffres de la délinquance – deux cibles sont désignées : les banlieues et l’immigration.
L’étude, en forme d’enquête de terrain, plonge dans le quotidien de ces brigades, fait d’interminables patrouilles le plus souvent, plus rarement de courses poursuites à l’objet mal identifié ou d’arrestations musclées. On y découvre également leur fonctionnement et leur recrutement, fondé sur la cooptation de jeunes policiers issus de villes moyennes de province, avec pour seul bagage une formation qui leur enseigne “la jungle” des zones urbaines sensibles peuplées de “sauvages”. Dans le langage des “baqueux”, les jeunes de banlieue deviennent “les bâtards”. Élément de langage et de justification des pratiques en vigueur, à l’image des contrôles au faciès érigés en norme, des préjugés racistes et des provocations. Des méthodes indissociables de la “politique du chiffre” imposée par la hiérarchie : quoi de plus facile que d’arrêter un insignifiant vendeur de shit ou un sans-papier, voire, pour gonfler les statistiques, de provoquer outrages et rébellion.
Didier Fassin met ainsi en lumière l’absurdité d’une politique répressive qui fabrique la délinquance plus qu’elle ne la résorbe, à moins que l’objectif véritable soit de perpétuer un ordre social plutôt que de garantir la sûreté et la sécurité publique.
« Tu seras un homme, mon fils » [7]
 « Tu seras un homme, tu seras général, Gabriele D’Annunzio. Ambassadeur de France ! » Que ce soit tout gosse, dans les rues de Wilno, en Pologne, sur les marchés niçois ou bien devant ses comparses de l’Armée de l’Air pendant la guerre, Romain Gary a eu bien des occasions d’être embarrassé par sa mère. Trop excentrique, trop démonstrative, toujours dans l’exagération… Cette ancienne actrice russe n’aura eu de cesse de vanter les mérites de son fils, de les clamer haut et fort, le bras brandi vers le ciel, vitupérant à la face du monde. Prédictions performatives d’une mère qui aura deviné, dans les traits de son fiston, ses futurs exploits : seul écrivain français deux fois lauréat du prix Goncourt, aviateur héros de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, officier de la légion d’honneur, diplomate…
« Tu seras un homme, tu seras général, Gabriele D’Annunzio. Ambassadeur de France ! » Que ce soit tout gosse, dans les rues de Wilno, en Pologne, sur les marchés niçois ou bien devant ses comparses de l’Armée de l’Air pendant la guerre, Romain Gary a eu bien des occasions d’être embarrassé par sa mère. Trop excentrique, trop démonstrative, toujours dans l’exagération… Cette ancienne actrice russe n’aura eu de cesse de vanter les mérites de son fils, de les clamer haut et fort, le bras brandi vers le ciel, vitupérant à la face du monde. Prédictions performatives d’une mère qui aura deviné, dans les traits de son fiston, ses futurs exploits : seul écrivain français deux fois lauréat du prix Goncourt, aviateur héros de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, officier de la légion d’honneur, diplomate…
Dans La Promesse de l’aube, roman autobiographique, l’auteur rend hommage à celle qui sera finalement la femme de sa vie ; celle dont le travail et la ténacité lui ont permis de devenir celui qu’il est. Cette foi dans la destinée hors-normes de son fils la fit remuer ciel et terre pour apporter une éducation digne de ce nom à sa progéniture. Il bénéficiera des meilleurs cours, des meilleurs professeurs, car son fils sera un homme du monde. Ils iront en France, car la France est la plus grande des nations, celle qui a vu naître les plus grands artistes – un patriotisme exacerbé qui ne ferait pas rougir Déroulède ; la première littérature de Gary, c’est le roman national français que déclame sa mère… Elle l’assure aussi : il sera le plus grand écrivain, le plus célèbre, il aura des femmes par dizaines, par centaines même ! Romain Gary fera tous les efforts pour ne pas la décevoir, pour être à la hauteur de ses espoirs. Mais un amour maternel aussi puissant, aussi définitif, a ses revers. L’enfant ignoré, maltraité, est déstabilisé pour toujours ; il passe toute sa vie à combler un vide, à se créer des racines. Mais l’enfant follement aimé est également bousculé pour la vie. Devenu adulte, il n’aura de cesse de rechercher dans toutes les femmes l’amour primitif, la pureté originelle du premier lien – en vain. D’où le titre de l’ouvrage : « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. »
Nos Desserts :
- Au Comptoir, nous vous servons aussi depuis 2016 un cocktail de réjouissances imprimées
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Nous avions réalisé une sélection de livres à (se faire) offrir pour Noël 2015 et 2016 et 2017
Catégories :Shots et pop-corns

Cette sélection me donne super envie et tes dernières lectures aussi. J’ai beaucoup envie de lire Fassin et le livre sur Le Corbusier !
Et quelle joie de voir des livres de sciences humaines prendre de la place sur la toile … 🙂