Le livre d’Aude Lancelin (« Le monde libre », publié aux éditions Les liens qui libèrent) n’est pas passé inaperçu. Après une sortie discrète, les attaques et les dithyrambes n’ont pas manqué de s’abattre sur l’ancienne directrice adjointe de la rédaction de « L’Obs » (anciennement « Le Nouvel Observateur », « L’Obsolète » dans le livre). La semaine dernière, c’est le prix Renaudot essai qui lui a été décerné : une drôle de revanche quelques mois après son licenciement politique. Au-delà des récompenses et des brimades, Aude Lancelin a réussi à saisir avec un talent certain les errements et les pitreries d’un univers journalistique et intellectuel en décrépitude.
 Dans son fameux Abécédaire (1996), le philosophe Gilles Deleuze associe la crise intellectuelle, entre autres, à la conquête du livre par les journalistes. Mais, même dans ce monde rêvé où les journalistes sont empêchés de commettre des livres, il faudrait songer à délivrer une dérogation à des textes aussi salvateurs que celui-ci. L’honnêteté impose d’en souligner des qualités qui se font rares : une langue irréprochable, un style sincère et incisif, une dose raisonnable d’humour et des analyses fines et justes. C’est à se demander ce que son auteur pouvait bien faire dans un hebdomadaire insipide (formule devenue pléonastique), où elle s’attelait tant bien que mal à glisser entre des pages austères des bribes de pensée singulière, comme on fait avaler des comprimés amers à un enfant gâté. De ce point de vue, Aude Lancelin a été libérée du “monde libre”, comme elle le reconnaît elle-même.
Dans son fameux Abécédaire (1996), le philosophe Gilles Deleuze associe la crise intellectuelle, entre autres, à la conquête du livre par les journalistes. Mais, même dans ce monde rêvé où les journalistes sont empêchés de commettre des livres, il faudrait songer à délivrer une dérogation à des textes aussi salvateurs que celui-ci. L’honnêteté impose d’en souligner des qualités qui se font rares : une langue irréprochable, un style sincère et incisif, une dose raisonnable d’humour et des analyses fines et justes. C’est à se demander ce que son auteur pouvait bien faire dans un hebdomadaire insipide (formule devenue pléonastique), où elle s’attelait tant bien que mal à glisser entre des pages austères des bribes de pensée singulière, comme on fait avaler des comprimés amers à un enfant gâté. De ce point de vue, Aude Lancelin a été libérée du “monde libre”, comme elle le reconnaît elle-même.
Le livre remplit plusieurs fonctions à la fois : enquête sur les origines et la profondeur du mal, essai sur une intelligentsia délirante, pamphlet anti-libéral, autobiographie partielle et roman policier. Comme dans la série Columbo, le crime est mis en scène dès le début et les coupables sont désignés. En cause, notamment, le Groupe Le Monde, qui a racheté toutes les parts de L’Obs en septembre 2015, et principalement Le monde libre, la holding qui en est l’actionnaire majoritaire, fondée par Xavier Niel, Pierre Bergé et Matthieu Pigasse. Un trio d’hommes d’affaires sévèrement (mais assez justement) décrit : un vieux magnat de la haute couture taciturne et méprisant, un “ogre” des télécommunications au passé trouble et un jeune banquier dont les intérêts frustrent de vagues opinions politiques qu’il est d’usage de classer à gauche. Si l’enquête est imprécise – et comment peut-elle être précise quand on connaît l’opacité d’un tel milieu ? –, la journaliste pose deux bonnes questions : comment une corporation aussi jalouse de son indépendance dans le discours a-t-elle pu se laisser acheter aussi facilement ? Et pourquoi, y compris en souscrivant sans sourciller aux sacro-saintes lois du marché, les journalistes sont-ils ainsi condamnés à être les seuls vendeurs qui s’obstinent à refuser de satisfaire leurs propres clients ? Citant Les hauteurs béantes (1977) d’Alexandre Zinoviev, ouvrage dans lequel l’écrivain russe décrit la médiocrité comme faisant partie du programme, Aude Lancelin apporte ici une réponse qui permet de relativiser les accusations de cryptocommunisme à son encontre.
Les anesthésiants de la pensée
Le livre ne se résume toutefois pas au problème bien connu de l’actionnariat dans la presse. En bonne spécialiste de la “vie des idées” (et donc, accessoirement, de leur mort), elle profite de l’occasion pour délivrer des portraits croustillants de ce que le paysage intellectuel français compte de pire, tout en prenant soin de présenter au lecteur ses propres préférences sous le titre très chrétien « Dieu vomit les tièdes » (référence à l’Apocalypse). Des préférences qui se caractérisent donc, non pas par la couleur idéologique qu’on lui impute, mais par une certaine puissance qui n’a pas manqué d’aiguiser ses exigences : Rousseau, Nietzsche, Kafka, Pasolini… Noms auxquels s’ajoutent des amitiés mal perçues dans son journal pour diverses raisons : Badiou, Muray, Todd… Les portraits en question sont à la fois attendus et d’une sévérité savoureuse. Au-delà de leurs contradictions et de la mollesse de leur pensée viscérale (l’oxymore n’est pas d’elle), des personnages comme Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut sont présentés sous leur jour le plus mesquin : des “amis du journal” qui n’hésitent pas à abuser de leurs privilèges et de leurs amitiés éditoriales.
 Ainsi, lorsque la journaliste réussit à consacrer la une de l’hebdomadaire à l’essayiste Emmanuel Todd, pour son livre Qui est Charlie ? (2015), Alain Finkielkraut hurle au scandale et espère une sanction de la part des lecteurs du journal. L’ironie fera de lui, l’année suivante, la victime d’un groupe qui le chassera de la place de la République en marge de Nuit debout. On parlera alors de “censure”, comme si la plèbe avait les moyens de “censurer” le censeur. Quand Lancelin évoque le livre de Todd sur le sens des grandes manifestations du 11 janvier 2015, il est tentant de le comparer au sien : la cible est toujours la même, c’est-à-dire une gauche de gouvernement foncièrement inégalitaire, une montée des discours identitaires et un consensus à la fois mou et néfaste (un « flash totalitaire », selon la formule du démographe).
Ainsi, lorsque la journaliste réussit à consacrer la une de l’hebdomadaire à l’essayiste Emmanuel Todd, pour son livre Qui est Charlie ? (2015), Alain Finkielkraut hurle au scandale et espère une sanction de la part des lecteurs du journal. L’ironie fera de lui, l’année suivante, la victime d’un groupe qui le chassera de la place de la République en marge de Nuit debout. On parlera alors de “censure”, comme si la plèbe avait les moyens de “censurer” le censeur. Quand Lancelin évoque le livre de Todd sur le sens des grandes manifestations du 11 janvier 2015, il est tentant de le comparer au sien : la cible est toujours la même, c’est-à-dire une gauche de gouvernement foncièrement inégalitaire, une montée des discours identitaires et un consensus à la fois mou et néfaste (un « flash totalitaire », selon la formule du démographe).
Si Lancelin n’hésite pas à accabler le directeur de la rédaction – officiellement responsable de son renvoi – de délicieuses attaques (notamment son obsession managériale), c’est finalement le sommet de l’État qui est visé. Un président de la République attaché à la loyauté d’une presse censée lui être acquise. Une gauche au pouvoir qui ne voulait plus d’un agent de la gauche radicale à la tête d’un relais qui devait lui assurer la fidélité de classes moyennes susceptibles d’être subverties. L’actualité confirme largement la proximité déconcertante entre François Hollande et les journalistes, une illustration parmi d’autres d’une politique gangrenée par l’art si fade de la communication. L’histoire est d’autant plus ironique que l’anticommunisme du journal, qui justifie son éviction, évoque certaines méthodes d’anciens régimes communistes. Le sort de la journaliste n’est pas sans rappeler celui du protagoniste de l’écrivain tchèque Milan Kundera dans La Plaisanterie (1967) : un étudiant exclu à cause d’une carte écrite au second degré, preuve de la crispation d’un système. Un système tout aussi crispé s’est acharné contre elle, un système rêvant d’unité, d’unanimité, de “charlisme”.
Paradoxes et paternalisme
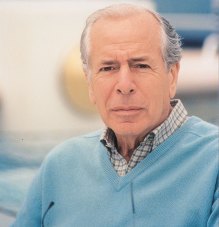 Une fois le caractère précieux du livre admis, il faut aussi en exposer les limites. Dès le début du livre, Aude Lancelin semble tout à fait lucide sur la genèse de son journal. Quand elle retrace le parcours de Jean Daniel (Jean Noël dans l’ouvrage), fondateur du Nouvel Observateur en 1964, le lecteur comprend bien que le ver est dans le fruit. Elle pousse la lucidité assez loin puisqu’elle décrit en réalité un système destiné à brider toute forme de radicalité depuis la naissance de l’hebdomadaire : dès les années 1960 et 1970, Jean Daniel est bien un représentant de la gauche anticommuniste. Avec la même finesse et la même lucidité, elle identifie un « triangle des Bermudes de la pensée », représenté par les revues Le Débat, Esprit et Commentaire. Pourvoyeurs de la « pensée tiède » (selon la formule de l’historien britannique Perry Anderson), que la fondation Saint-Simon viendra nourrir dans les années 1980 et 1990. Une gauche libérale dans laquelle s’inscrivent bien Jean Daniel et son journal. Pourtant, alors même qu’elle semble avoir fait ce constat, la journaliste décrit une chute, une déchéance. Le paradoxe est ainsi saisissant : entre la nostalgie exprimée ici ou là et l’identification d’un passé assez sombre. Une nostalgie ou une impression de nostalgie qu’expliquent peut-être des proportions inédites. L’autre paradoxe concerne le Renaudot lui-même : ceux qui l’ont récompensée méritent probablement le même type de diagnostic.
Une fois le caractère précieux du livre admis, il faut aussi en exposer les limites. Dès le début du livre, Aude Lancelin semble tout à fait lucide sur la genèse de son journal. Quand elle retrace le parcours de Jean Daniel (Jean Noël dans l’ouvrage), fondateur du Nouvel Observateur en 1964, le lecteur comprend bien que le ver est dans le fruit. Elle pousse la lucidité assez loin puisqu’elle décrit en réalité un système destiné à brider toute forme de radicalité depuis la naissance de l’hebdomadaire : dès les années 1960 et 1970, Jean Daniel est bien un représentant de la gauche anticommuniste. Avec la même finesse et la même lucidité, elle identifie un « triangle des Bermudes de la pensée », représenté par les revues Le Débat, Esprit et Commentaire. Pourvoyeurs de la « pensée tiède » (selon la formule de l’historien britannique Perry Anderson), que la fondation Saint-Simon viendra nourrir dans les années 1980 et 1990. Une gauche libérale dans laquelle s’inscrivent bien Jean Daniel et son journal. Pourtant, alors même qu’elle semble avoir fait ce constat, la journaliste décrit une chute, une déchéance. Le paradoxe est ainsi saisissant : entre la nostalgie exprimée ici ou là et l’identification d’un passé assez sombre. Une nostalgie ou une impression de nostalgie qu’expliquent peut-être des proportions inédites. L’autre paradoxe concerne le Renaudot lui-même : ceux qui l’ont récompensée méritent probablement le même type de diagnostic.
Le véritable épilogue de son livre a finalement été écrit par Jean Daniel lui-même. Et il illustre assez bien les critiques d’Aude Lancelin. Dans une réponse larmoyante, il reproche essentiellement une chose à la journaliste : sa supposée « ingratitude ». Attitude typique d’une gauche libérale et paternaliste : l’unanimisme et la fidélité sont préférés aux convictions politiques, fussent-elles sincères. On favorisera alors un monde injuste et silencieux au moindre petit conflit. Le totalitarisme discret d’une gauche “antitotalitaire”.
Nos Desserts :
- Au Comptoir, on vous proposait un article de Ludivine Bénard sur George Orwell et le journalisme
- Pour comprendre pourquoi la presse est rachetée par des grands groupes et « comment les actionnaire s’en mettent plein les poches »
- Nos articles sur Nuit debout
- Aude Lancelin reçoit le prix Renaudot essai
Catégories :Culture

Faisons un pas de plus: La conquête du livre par les journalistes… et la conquête du journalisme par la com… et l’idéologie du fait objectif comme métaphysique commode pour ne rien voir de ce qui se passe vraiment:
https://interstrates.wordpress.com/2017/02/28/fakeniouzologie-critique-de-la-raison-mediatique-reponse-a-frederic-lordon/
Peut être à cause de ça ? Pour un journaliste de gauche le devoir suprême est de servir non pas la Vérité mais la Révolution – Allende.
ou encore , sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ? Beaumarchais