Auteur de plusieurs travaux sur l’identité numérique et la publication en ligne, Olivier Ertzscheid est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Nantes. Il contribue à populariser les débats contemporains autour du numérique et des nouvelles technologies en utilisant les réseaux sociaux ou par l’intermédiaire de son blog, Affordance. Défenseur du logiciel libre, observateur compulsif de l’évolution de notre société et très critique du rapport aux nouvelles technologies qu’entretiennent nos politiques, il a aimablement accordé un entretien au Comptoir autour de ces questions.
Le Comptoir : Sur votre blog, vous avez récemment publié un billet dans lequel vous dénonciez l’argumentaire de la ministre de l’Éducation Nationale Najat Vallaud Belkacem, qui a conclu un partenariat avec Microsoft. Les établissements scolaires sont-ils en train d’être vendus aux grandes multinationales ?
 Olivier Ertzscheid : Non. Pour l’instant nous n’en sommes heureusement pas là. Mais le risque de dérive est réel, constaté et documenté. L’école en général, mais c’est la même chose à l’université, est prise dans un dispositif de “double contrainte” : d’un côté, il est bien entendu nécessaire de former les élèves aux solutions logicielles propriétaires les plus courantes, et de l’autre il est tout aussi important de les former sur des logiciels open source. Ce que je dénonce, c’est le systématisme des choix politiques qui font à chaque fois pencher la balance du côté des acteurs privés et des logiciels propriétaires plutôt que du côté du monde du logiciel libre alors que sur le terrain, un très grand nombre d’enseignants font, à chaque fois qu’ils le peuvent, plutôt le choix de logiciels libres. Ce qui achève de m’énerver, c’est le cynisme et l’hypocrisie qui voient ces mêmes dirigeants politiques affirmer leur soutien au logiciel libre quand ils ne font qu’entériner des contrats pharaoniques avec Microsoft.
Olivier Ertzscheid : Non. Pour l’instant nous n’en sommes heureusement pas là. Mais le risque de dérive est réel, constaté et documenté. L’école en général, mais c’est la même chose à l’université, est prise dans un dispositif de “double contrainte” : d’un côté, il est bien entendu nécessaire de former les élèves aux solutions logicielles propriétaires les plus courantes, et de l’autre il est tout aussi important de les former sur des logiciels open source. Ce que je dénonce, c’est le systématisme des choix politiques qui font à chaque fois pencher la balance du côté des acteurs privés et des logiciels propriétaires plutôt que du côté du monde du logiciel libre alors que sur le terrain, un très grand nombre d’enseignants font, à chaque fois qu’ils le peuvent, plutôt le choix de logiciels libres. Ce qui achève de m’énerver, c’est le cynisme et l’hypocrisie qui voient ces mêmes dirigeants politiques affirmer leur soutien au logiciel libre quand ils ne font qu’entériner des contrats pharaoniques avec Microsoft.
« Il faut que le politique mise tout sur la formation et l’éducation aux médias, et non pas sur le taux d’équipement. »
Le gouvernement s’est engagé il y a deux ans à fournir des tablettes numériques à chaque collégien à partir de la classe de cinquième. En prenant ce chemin, ne risque-t-il pas, une fois de plus, de se plier à un investissement coûteux et inutile, tout en faisant l’économie de la réflexion en matière d’éducation au numérique et aux médias ?
Bonne question et vieux débat. La France, en matière de politique éducative au numérique a historiquement toujours joué la carte de “l’équipement” au détriment de la formation à l’usage. Or, les équipements, en plus d’être souvent propriétaires et fermés (tablettes Apple, OS Microsoft, etc.), sont condamnés à l’obsolescence. Ils sont ainsi de véritables gouffres financiers pour les budgets de l’État et des collectivités, et de véritables rentes pour les entreprises qui les développent. La formation aux usages, elle, permet de s’affranchir de ces enjeux d’obsolescence. Un deuxième point vient confirmer l’erreur stratégique qui consiste à miser en priorité sur l’équipement : il y a quelques années de cela, les foyers les plus pauvres n’avaient, en effet, pas ou moins accès que les foyers les plus riches à un équipement informatique. L’école, en proposant des équipements informatiques, jouait alors son rôle. Mais aujourd’hui, toutes les études sociologiques montrent que les foyers disposant du plus grand nombre d’équipements et d’écrans sont, non pas les plus riches mais les plus pauvres. Pour résumer, les classes sociales les plus aisées et les plus favorisées ont conscience de l’importance d’une éducation aux écrans alors que dans nombre de familles en situation sociale difficile, l’écran est vu comme un facteur de réussite sociale. Si l’école veut donc continuer à jouer son rôle d’éducation aux médias auprès des publics les plus vulnérables, il faut qu’elle change complètement de perspective. Il faut que le politique mise tout sur la formation et l’éducation aux médias, et non pas sur le taux d’équipement, qui n’est qu’un facteur accessoire et le sera de plus en plus dans les années à venir.
Vous décrivez, en somme, une version actualisée du mythe de l’encyclopédie qui libère par le simple fait d’être présente dans la maison, posée sur une étagère ?
Oui, il y a probablement un peu de cela. Mais autant l’encyclopédie pouvait fonctionner comme une sorte d’“alibi culturel”, autant le taux d’équipement fonctionne comme un indicateur d’accession à la “normalité”. Il permet ainsi de pallier les carences imposées par des situations de travail ou des situations familiales fragiles et précaires : l’ordinateur, la tablette font à la fois office de nounou et de compagnon. Comme pouvait le faire la télé il y a de cela quelques années.
Le 17 octobre, vous partagiez une vidéo très intéressante de la chaîne YouTube Data Gueule à propos du monde de la recherche et des grandes multinationales de l’édition qui l’organisent. La vidéo décrivait le monopole des entreprises de publication scientifique et le confrontait à une autre philosophie, celle du libre, qui permet un accès plus démocratique aux savoirs. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment s’organise le modèle de diffusion du savoir scientifique en France ?
Ouh la ! Brièvement, cela va être assez difficile et mieux vaut prendre quelques minutes pour regarder l’excellente vidéo de Data Gueule. Mais pour faire (très) simple, disons que les connaissances scientifiques sont fabriquées, organisées, débattues et vérifiées par des chercheurs qui perçoivent déjà pour cela leur salaire de chercheurs. Vient ensuite la question du “marché” de l’édition scientifique et des monopoles constitués. Quelques grands groupes (Elsevier notamment) se partagent l’ensemble de ce marché de la diffusion des connaissances au travers de la publication de revues papier et, surtout aujourd’hui, numérique. Ces “éditeurs” font effectuer tout le travail d’écriture, de relecture et de mise en page par les chercheurs eux-mêmes, sans les payer, et vendent ensuite ces revues – aux bibliothèques universitaires notamment – à des coûts parfaitement prohibitifs, alors qu’ils n’ont même plus à supporter les coûts d’impression puisque l’offre est essentiellement numérique. On se retrouve donc dans une situation ubuesque où la communauté éducative se ruine pour pouvoir accéder à des revues contenant le savoir que cette même communauté a produit, corrigé et vérifié.
En tant qu’enseignant-chercheur, quelles sont les solutions que vous avez choisies pour mettre à disposition le savoir que vous produisez, en dehors de vos cours ?
Deux solutions. D’abord, j’ai un blog depuis que je suis devenu maître de conférences à l’université, c’est-à-dire depuis bientôt 12 ans, blog sur lequel je chronique en temps réel mon activité de recherche. Ensuite, toutes mes publications scientifiques sont déposées en archive ouverte, y compris lorsque je publie dans des revues qui, par contrat, m’interdisent de le faire.
Réduction drastique des budgets, abaissement des exigences à tous les niveaux – licence, master, doctorat –, difficulté des étudiants à trouver des débouchés une fois les diplômes validés… L’université française vit actuellement une crise importante. Quel est votre diagnostic de la situation ? L’université a-t-elle été dévoyée ?
Disons, pour faire court, que nous assistons à une dérive managériale qui vient aggraver un manque constant de budget et de postes. Si nombre d’universités sont aujourd’hui en déficit, c’est d’abord parce que l’État n’a pas versé l’argent qu’il leur devait. Ensuite, au même titre que l’école, l’université vit tous les deux ou trois ans, depuis maintenant plus de 20 ans, une réforme de grande ampleur, LMD, loi LRU, autonomie, etc. Enfin, on a créé de gros machins supposés mieux orienter les grandes orientations de la recherche et mieux distribuer les financements, et au final on se retrouve à installer une course à la publication, une concurrence malsaine entre les chercheurs ou les champs disciplinaires, et à ne plus fonctionner que par objectifs de rentabilité. La recherche doit être “rentable”, les formations elles-mêmes, doivent être “rentables”, auto-financées, ce qui nous place dans des situations, là encore, ubuesques. C’est un désastre. Un vrai désastre. Mais nous n’en mesurerons vraiment les conséquences que dans une génération. Et il sera trop tard pour faire machine arrière.
Vous faites partie du monde de la recherche. Selon vous, quel est le rôle d’un intellectuel dans la France d’aujourd’hui ?
Je crois que le rôle des universitaires est de participer au débat public. D’y faire entrer des thèmes qui, sans cela, resteraient confinés dans les laboratoires de recherche et dans des revues scientifiques que personne (à part les universitaires) ne lit. Nous avons aujourd’hui des outils de diffusion de la science qui nous permettent de le faire sans pour autant être prisonniers d’un système médiatique très contraint.
L’expérience que je tire de dix ans de blog, c’est que les gens sont demandeurs, que les problématiques parfois complexes sur lesquelles nous travaillons dans nos laboratoires, les intéressent. Et que, chacun à notre échelle, nous pouvons contribuer à faire évoluer les opinions sur des sujets qui sont des sujets universitaires, mais qui restent avant tout des sujets de société.
Dans son livre À quoi rêvent les algorithmes, le sociologue Dominique Cardon met en exergue le fait que les grandes entreprises d’Internet véhiculent un véritable projet politique. Vous-même parlez souvent de l’influence grandissante des big data sur nos vies dans vos écrits. Le “système technicien” qu’envisageait Jacques Ellul est-il en train de prendre forme ?
C’est plus que probable. Aucune technologie sociale n’est neutre. A fortiori lorsqu’elle touche chaque jour des communautés composées de millions ou de milliards d’individus. Ce qui me préoccupe beaucoup aujourd’hui – et je ne suis heureusement pas le seul – c’est le rôle que ces grandes plateformes, que ces grandes entreprises et leurs PDG sont amenés à jouer dans la vie politique. L’idéologie libertarienne qui est au fondement de la Silicon Valley est très prégnante. En gros, il s’agit d’acter le fait qu’il n’y a pas besoin d’État, que les grandes (ou les petites) firmes technologiques ont les solutions à tous les problèmes d’une société (Evgeny Morozov utilise le terme de “solutionnisme”). Concrètement, cela se traduit par le fait que ces firmes jouent un rôle de plus en plus déterminant dans des secteurs économiques majeurs comme la finance avec le Trading Haute Fréquence, ou le transport avec les voitures autonomes, mais également dans des secteurs régaliens : transport, médecine et accès aux soins, emploi, etc. Or, contrôler ou intervenir dans ces secteurs-là, c’est déjà faire de la politique, notamment au travers d’une activité “classique” de lobbying, mais aussi parce que l’on se trouve en situation d’administrer et de réguler un secteur ou un service fait pour rendre un service public. Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de ces dirigeants de grands groupes, au-delà des liens qu’ils entretiennent avec les pouvoirs en place, confessent aujourd’hui clairement leur souhait de s’engager en politique.
Il y a quelques jours, nous avons appris avec stupéfaction que le gouvernement français avait publié un décret autorisant le fichage de tous les internautes français. De quels moyens disposons-nous, à petite et grande échelle, pour organiser un contre-pouvoir numérique ?
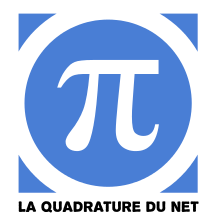 La frénésie du fichage, d’un fichage de plus en plus étendu et de plus en plus systématique, accompagnera, hélas, toutes les démocraties du XXIe siècle. Parce que les technologies sont mûres et faites pour être utilisées, parce que les alibis politiques sont légion – le dernier en date est celui de la lutte contre le terrorisme –, et parce que nous sommes en quelque sorte devenus presque indifférents à ces logiques, puisqu’elles constituent pour l’essentiel notre premier rapport aux environnements numériques que nous fréquentons le plus.
La frénésie du fichage, d’un fichage de plus en plus étendu et de plus en plus systématique, accompagnera, hélas, toutes les démocraties du XXIe siècle. Parce que les technologies sont mûres et faites pour être utilisées, parce que les alibis politiques sont légion – le dernier en date est celui de la lutte contre le terrorisme –, et parce que nous sommes en quelque sorte devenus presque indifférents à ces logiques, puisqu’elles constituent pour l’essentiel notre premier rapport aux environnements numériques que nous fréquentons le plus.
Lutter contre le fichage, ou plus exactement contre la systématisation d’un fichage inapproprié et injustifié peut se faire de plusieurs manières : sur le plan législatif, sur le plan militant (nombre d’associations comme la Quadrature du Net en France luttent pour défendre nos libertés numériques), mais également en donnant davantage de pouvoir décisionnel à des institutions comme la Cnil ou le Conseil National du Numérique (les deux n’ayant que la capacité de délivrer des avis “consultatifs”). Enfin, à l’échelle individuelle, en s’éduquant aux outils qui permettent de se protéger, de se soustraire au regard des États ou des multinationales du fichage. En formant bien sûr, les élèves et les étudiants à ces enjeux. Et surtout, en luttant pied à pied à tous les niveaux pour que, si ce fichage a lieu, il ne puisse jamais être utilisé en dehors du contrôle d’un juge.
Internet est un monde sans véritable règle, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Sur le réseau, on peut à la fois dialoguer avec n’importe qui, avoir un accès étendu à la culture via diverses plates-formes, s’informer – à condition de garder son esprit critique éveillé –, et devenir soi-même producteur d’information. Mais le réseau a aussi la capacité potentielle d’aliéner l’utilisateur, de lui faire perdre son autonomie, de garder ses traces en mémoire, voire pire. Finalement, Internet n’est-il pas, d’une certaine manière, un moyen numérique pour les libéraux de subvertir le monde réel ?
C’est une vision un peu pessimiste. Lorsque j’ai découvert Internet et le web, au milieu des années 90, j’étais sur IRC et il y avait déjà une “nétiquette”, c’est-à-dire des usages constatés, normés, et des processus de régulation de ces usages mis en place par et pour la communauté. Donc “le réseau”, pour autant qu’il soit possible de mettre une réalité univoque derrière cette expression, est un environnement complexe et hétérarchique. L’exemple qui me semble le plus juste si l’on veut comprendre les dynamiques du réseau, c’est Wikipédia. Une encyclopédie collaborative, ouverte, dans laquelle chacun est effectivement libre de publier ce qu’il veut, mais qui, lorsqu’on l’analyse, est en fait un processus collectif extrêmement complexe et contrôlé à différents niveaux. C’est cela, pour moi, “le réseau” : une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, capable de faire coexister dans un projet complètement ouvert et “sans filtre” des niveaux d’autorité, de régulation souvent très complexes et très stricts mais avec une gouvernance communautaire toujours en évolution, et toujours transparente.
Vous pointez là quelque chose d’important : on ne devrait en fait pas dire “Internet” mais “les internets”. Cependant, le réseau et ses protocoles ne sont-ils pas, au niveau mondial, dominés par des firmes américaines ?
Oui, j’aime beaucoup l’expression “les internets”. La domination américaine s’exerce à beaucoup de niveaux sur les internets. À la fois du côté des normes et protocoles techniques qui permettent au réseau de fonctionner, mais également, bien sûr, du côté des grandes multinationales de l’attention : Google, Facebook, Apple, Amazon, etc. Côté technique par exemple, cette domination américaine pose et va de plus en plus poser d’énormes problèmes géo-politiques ou géo-stratégiques. Mais Internet reste, heureusement, un réseau multiforme et encore profondément distribué, ouvert et interopérable. Pour l’instant, tout au moins.
Le vrai danger est celui que pointe Tim Berners Lee lorsqu’il parle des “jardins fermés”, c’est-à-dire de ces grandes plateformes qui ne sont pas “le web” et qui monopolisent aujourd’hui l’essentiel de nos navigations, de nos usages connectés. Même si je dresse souvent un constat assez alarmant sur la mainmise de ces plateformes, je reste, au fond, assez confiant et optimiste. On n’imagine pas aujourd’hui qu’il puisse exister une alternative à Facebook, un autre Facebook, moins centralisé, plus respectueux de nos libertés numériques, mais le web a à peine 25 ans. C’est comme si on demandait à quelqu’un vivant à l’époque de l’ORTF d’imaginer les 200 chaînes de télévision qui sont maintenant disponibles pour la plupart des foyers français. Tout le monde pense aujourd’hui qu’il est impossible de construire un moteur de recherche capable d’enterrer Google. Mais à l’époque où les moteurs de recherche n’existaient pas, lorsque Yahoo! était un annuaire de recherche, ou encore lorsque AltaVista était considéré, y compris par les spécialistes, comme “le moteur de recherche indépassable”, personne n’imaginait qu’en à peine quelques années un concurrent émergerait et enterrerait définitivement ses prédécesseurs.
Pensez-vous, à l’instar de Hervé Le Crosnier et McKenzie Wark, qu’Internet puisse être « l’un des nouveaux lieux de la lutte des classes » ?
Sans aucun doute possible. Il faut pour en être convaincu regarder de près ce qui se passe du côté de ce que l’on appelle le Digital Labor et l’automatisation. Prenez par exemple les voitures autonomes ou la question du “statut” des chauffeurs Uber : de nouvelles formes de contestation, de revendication prennent forme autour de nouveaux modèles économiques qui affectent et redessinent des industries entières. La question des données personnelles, de leur économie et, bien sûr, celle de la surveillance globale sont autant d’exemples de cette nouvelle “lutte des classes”. Antonio Casilli a notamment montré que la “vie privée” était désormais devenu l’enjeu d’une négociation collective. Ces négociations collectives sont aujourd’hui essentielles car elles sont le seul levier qui permet à des communautés d’utilisateurs de faire valoir leurs droits auprès de plateformes toujours plus présentes et omnipotentes mais qui restent – heureusement – des géants aux pieds d’argile car elles ne tiennent, au final, qu’au travers la confiance que leur accordent leurs utilisateurs.
Pour finir, intéressons-nous aux réseaux sociaux. À l’exemple de Twitter, certains médias sociaux ont clairement accentué le culte de la “petite phrase” et du bon mot dans une logique d’instantanéité et de buzz immédiat. Ces plates-formes n’accentuent-elles pas la vacuité de nos débats contemporains ?
Je serais plus nuancé. Il y a aussi, sur Twitter et ailleurs, une véritable poésie, un goût de la formule, de l’aphorisme, une contrainte de brièveté qui donne souvent lieu à des jeux poétiques, rhétoriques jubilatoires. Pour le dire autrement, le culte de la petite phrase n’a pas été inventé par les réseaux sociaux. Pas davantage que les réseaux sociaux n’ont inventé des formes “d’isolement” ou de repli sur soi. Il existe des invariants, des habitus que l’on retrouve dans toutes les sociétés, connectées ou non, et à toutes les époques. Les réseaux sociaux modifient un certain nombre de nos repères spatiaux et temporels, ils inventent des situations de communication inédites (Danah Boyd parle par exemple des “audiences invisibles”, c’est-à-dire le fait que lorsque nous publions un statut Facebook nous ne savons pas si les gens à qui nous nous adressons sont ou non présents), mais ils ne sont pas non plus responsables de tous les maux.
La “poétique” du réseau social devient le moyen d’expression de tout le monde, y compris celui des politiques, des industriels, des lobbyistes, qui peuvent utiliser Facebook ou Twitter pour se donner une image “sympa”, “connectée”, proche du peuple. À ce titre, n’y-a-t-il pas un risque de renforcement de la politique-spectacle, de ce que les Américains appellent l’infotainment ?
 Là encore, la question de l’infotainment n’a pas été inventée par le numérique. Et le numérique ne l’aggrave pas. Pour un homme ou une femme politique qui se livre sur Twitter ou ailleurs à de la politique-spectacle, ou à des petites phrases polémiques, il y a des milliers de gens, poètes, activistes, réfugiés, opprimés, dissidents qui, sur Twitter ou ailleurs, livrent des témoignages qui permettent de rendre le monde meilleur, ou en tout cas de continuer à avoir confiance en l’humanité. Ces outils, ces moteurs de recherche, ces réseaux sociaux, sont des outils “politiques” au sens noble du terme, c’est-à-dire qu’ils permettent à chacun de participer à la vie de la cité. Alors, bien sûr, l’infotainment est souvent le côté émergé de l’iceberg, mais il faut aussi se souvenir du rôle qu’ont joué ces plateformes, ces outils, dans les révolutions du Printemps arabe, le rôle qu’ils jouent également pour ces dissidents ou ces journalistes dans des pays en guerre ou sous l’emprise de dictateurs. Comme le dit la chercheuse Zeynep Tufekcy, Facebook permet d’organiser facilement des révolutions, mais Facebook ne permet pas, et ne permettra jamais de gagner ces révolutions.
Là encore, la question de l’infotainment n’a pas été inventée par le numérique. Et le numérique ne l’aggrave pas. Pour un homme ou une femme politique qui se livre sur Twitter ou ailleurs à de la politique-spectacle, ou à des petites phrases polémiques, il y a des milliers de gens, poètes, activistes, réfugiés, opprimés, dissidents qui, sur Twitter ou ailleurs, livrent des témoignages qui permettent de rendre le monde meilleur, ou en tout cas de continuer à avoir confiance en l’humanité. Ces outils, ces moteurs de recherche, ces réseaux sociaux, sont des outils “politiques” au sens noble du terme, c’est-à-dire qu’ils permettent à chacun de participer à la vie de la cité. Alors, bien sûr, l’infotainment est souvent le côté émergé de l’iceberg, mais il faut aussi se souvenir du rôle qu’ont joué ces plateformes, ces outils, dans les révolutions du Printemps arabe, le rôle qu’ils jouent également pour ces dissidents ou ces journalistes dans des pays en guerre ou sous l’emprise de dictateurs. Comme le dit la chercheuse Zeynep Tufekcy, Facebook permet d’organiser facilement des révolutions, mais Facebook ne permet pas, et ne permettra jamais de gagner ces révolutions.
Nos Desserts :
- Pour retrouver tous les billets d’Olivier Ertzscheid, rendez vous d’urgence sur son blog Affordance
- Le compte Twitter d’Olivier Ertzscheid, c’est par ici
- La revue Période s’interroge sur les rapports entre Internet et la lutte des classes
- « Fichier TES, un danger pour nos libertés ! », article de La Quadrature du Net à retrouver sur leur site
- Table ronde sur le thème « Qui domine l’Internet ? » sur le site de la Fondation Paris-Dauphine
- « Vous avez dit « philanthocapitalisme ?« , un article d’Evgeny Morozov à lire sur le site du Monde Diplomatique
- Une interview très critique de l’ingénieur et essayiste Philippe Bihouix à propos du numérique à l’école
Catégories :Société



Le secteur du numérique et de l’informatique est un domaine intrinsèque à l’évolution des sociétés modernes. Les particuliers comme les entreprises seront amenés à connaître les véritables enjeux de l’univers mystérieux de l’informatique.