Entretien initialement publié en octobre 2013, reproduit avec l’autorisation de Serge Latouche.
Le Comptoir : Alors que la croissance du PIB semblait enfin repartie en France, elle a connu un nouveau coup d’arrêt au 2e trimestre. Qu’en pensez-vous ?
 Serge Latouche : Je pense que c’est totalement bidon ! Savoir si la croissance est de +0,5% ou -0,5% n’a pas de sens ; n’importe quelle personne qui a fait des statistiques et de l’économie sait que pour que cela soit significatif, il faut des chiffres plus grands. Et puis, de quelle croissance parle-t-on ? Il s’agit de la croissance que nous connaissons depuis les années 1970, c’est-à-dire une croissance tirée par la haut grâce à la spéculation boursière et immobilière. Dans le même temps, le chômage ne cesse de croître et la qualité de la vie continue de se dégrader dangereusement. Il faut bien comprendre que la croissance est morte dans les années 1970 environ. Elle est comparable aux étoiles mortes qui sont à des années-lumière de nous et dont nous percevons encore la lumière. La croissance que notre société a connue durant les Trente Glorieuses a disparu et ne reviendra pas !
Serge Latouche : Je pense que c’est totalement bidon ! Savoir si la croissance est de +0,5% ou -0,5% n’a pas de sens ; n’importe quelle personne qui a fait des statistiques et de l’économie sait que pour que cela soit significatif, il faut des chiffres plus grands. Et puis, de quelle croissance parle-t-on ? Il s’agit de la croissance que nous connaissons depuis les années 1970, c’est-à-dire une croissance tirée par la haut grâce à la spéculation boursière et immobilière. Dans le même temps, le chômage ne cesse de croître et la qualité de la vie continue de se dégrader dangereusement. Il faut bien comprendre que la croissance est morte dans les années 1970 environ. Elle est comparable aux étoiles mortes qui sont à des années-lumière de nous et dont nous percevons encore la lumière. La croissance que notre société a connue durant les Trente Glorieuses a disparu et ne reviendra pas !
La récession de 2009 était-elle l’occasion idéale pour jeter les bases d’une transition économique ?
Oui et non. Le paradoxe de la récession est qu’elle offre la possibilité de remettre en question un système grippé, mais en même temps, le refus de l’oligarchie dominante de se remettre en cause – ou de se suicider – maintient la fiction d’une société de croissance sans croissance. Depuis le début de la crise en 2008, il y a un tel délire obsessionnel autour de la croissance que les projets alternatifs ne sont pas audibles auprès des politiques. La récession a donc rendu encore plus illisible le projet de la décroissance. Il existe, mais de manière souterraine.
La décroissance est souvent amalgamée à la récession. Pourtant, vous affirmez que l’amalgame ne tient que si on imagine une décroissance dans le cadre d’une société de croissance. Vous dites qu’une vraie décroissance n’est possible qu’au sein d’une société qui s’est départie de l’imaginaire de la croissance. Pouvez-vous détailler ?
Le projet alternatif de la décroissance ne devrait pas être confondu avec le phénomène concret de ce que les économistes appellent « croissance négative », formulation jargonnesque étrange qui désigne un recul de l’indice fétiche des sociétés de croissance, le PIB. En d’autres termes, la “croissance négative” est une récession ou une dépression, voire le déclin ou l’effondrement du modèle économique moderne. Le projet d’une société de décroissance est radicalement différent. La décroissance renvoie à une sortie de la société de consommation. L’opposé de la décroissance “choisie” est la décroissance “subie”. La première est comparable à une cure d’austérité entreprise volontairement pour améliorer son bien-être, lorsque l’hyperconsommation en vient à nous menacer d’obésité. La seconde est semblable à une diète forcée pouvant mener à la mort par famine.
Nous savons, en effet, que le simple ralentissement de la croissance ouvre déjà le champ d’une décroissance “subie”. Elle plonge nos sociétés dans le désarroi, en raison du chômage, de l’accroissement de l’écart qui sépare riches et pauvres, des atteintes au pouvoir d’achat des plus démunis et de l’abandon des programmes sociaux, sanitaires, éducatifs, culturels et environnementaux qui assurent un minimum de qualité de vie. Cette régression sociale et civilisationnelle est précisément ce que nous commençons déjà à connaître. Nous pouvons imaginer quelle catastrophe serait un taux de croissance négatif !
Depuis la récession de 2009, l’écart entre la croissance du PIB et celle de la production industrielle s’est accentué dans les pays développés : sommes-nous entrés dans une nouvelle phase de la société technicienne ?
Oui et non là encore. Oui, dans la mesure où, depuis de nombreuses années, on parle de « nouvelle économie », « économie immatérielle », « économie de nouvelles technologies » ou encore « économie numérique ». On nous a aussi parlé de « société de services ». Ce phénomène n’est pas nouveau ; il y avait déjà, dans les vieilles sociétés industrielles, un phénomène de désindustrialisation. Pourtant, ce n’était pas un changement dans le sens où l’industrialisation existait toujours. Mais elle s’est exportée en Inde, en Chine ou dans les “BRICS”. Il y a eu une délocalisation du secteur secondaire qui a pour conséquence une réimportation massive, un chômage très important et une croissance spéculative. Nos économies se sont spécialisées dans les services haut de gamme ; les services financiers, les marques, les brevets, etc. La production est délocalisée tout en conservant la marque, ce qui est plus rentable. D’un autre côté, la désindustrialisation développe par le bas des services dégradés ou à la personne et une nouvelle forme de domesticité.
Est-ce que vous confirmeriez les prévisions de Jacques Ellul qui observait la naissance d’une dichotomie entre les “nations-capitalistes” du Nord et les “nations-prolétaires” du Sud ?
Cela n’est pas nouveau, ni totalement exact ! Les nations occidentales se prolétarisent aussi. Avec la mondialisation, nous assistons surtout à une tiers-mondisation des pays du Nord et un embourgeoisement des pays du Sud. Il y a par exemple aujourd’hui 100 à 200 millions de Chinois qui appartiennent à la classe moyenne mondiale, voire riche.
Le 20 août 2013, nous avons épuisé les ressources de la Terre (NDLR : la date avançant chaque année, c’était le 13 août en 2015) et nous vivons donc “à crédit” vis-à-vis de celle-ci jusqu’à la fin de l’année. Il faudrait réduire d’environ un tiers notre consommation en ressources naturelles si nous voulons préserver notre planète. N’a-t-on pas déjà atteint le point de non-retour ? La décroissance se fera-t-elle aux dépens des pays en voie de développement ?
Déjà, soyons clairs, la décroissance s’oppose, avant tout, à la société d’abondance. Ensuite, il ne s’agit surtout pas de régler les problèmes des pays du Nord aux dépens de ceux du Tiers-Monde. Il faut résoudre simultanément les problèmes et du Nord et ceux du Sud. Évidemment, ce que vous évoquez, et que l’on appelle l’over shoot day, n’est qu’une moyenne globale. La réduction de l’empreinte écologique pour un pays comme la France n’est pas de l’ordre de 30 %, mais de 75 %. Une fois explicité comme cela, les gens se disent que ça va être dramatique. Justement, ce n’est pas nécessaire : nos modes de vie sont basés sur un gaspillage fantastique des ressources naturelles, tant en ce qui concerne la consommation que son indispensable corollaire, la production. La logique consumériste pousse à accélérer l’obsolescence des produits. Il ne s’agit donc pas forcément de consommer moins mais de produire moins en consommant mieux.
« L’idée n’est pas de décroître au détriment des pays pauvres qui, eux, doivent, au contraire, augmenter leur consommation et leur production, mais de changer cette logique de gaspillage forcené et de fausse abondance. »
Au lieu de consommer une seule machine à laver dans notre vie, nous en consommons 10 ou 15, pareil pour les réfrigérateurs, et je ne parle même pas des ordinateurs ! Il faut adopter un mode de production où les individus peuvent ne consommer qu’une seule voiture, une seule machine à laver, etc. Cela réduirait déjà énormément l’empreinte écologique. Nous savons aussi que la grande distribution est un modèle qui entraîne beaucoup de gaspillage alimentaire. Environ 40 % de la nourriture va à la poubelle, soit à cause des dates de péremption qui obligent les magasins à jeter lorsqu’elles sont dépassées, soit chez les particuliers qui ont emmagasiné de la nourriture qui finit par périmer. L’idée n’est pas de décroître au détriment des pays pauvres qui, eux, doivent, au contraire, augmenter leur consommation et leur production, mais de changer cette logique de gaspillage forcené et de fausse abondance.
Nicholas Georgescu-Roegen affirmait : « Chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d’une baisse du nombre de vies à venir. » La décroissance doit-elle être accompagnée d’un contrôle démographique pour être soutenable ?
Il est toujours délicat d’aborder cette question. Les prises de position sur le sujet sont toujours passionnelles car le contrôle démographique touche à la fois aux croyances religieuses, au problème du droit à la vie et à l’optimisme de la modernité avec son culte de la science et du progrès. Ces considérations peuvent déraper très vite vers l’eugénisme, ou le racisme au nom d’un darwinisme rationalisé. La menace démographique, vraie ou imaginaire, peut donc être facilement instrumentalisée pour mettre en place des formes d’écototalitarisme. Il importe de cerner les différentes dimensions du problème, et de peser les arguments en présence, avant de se prononcer sur la taille d’une humanité “soutenable”.
Si l’insuffisance des ressources naturelles et les limites de la capacité de régénération de la biosphère nous condamnent à remettre en question notre mode de vie, la solution paresseuse consisterait, en effet, à réduire le nombre des ayants droit afin de rétablir une situation soutenable. Cette solution convient assez bien aux grands de ce monde puisqu’elle ne porte pas atteinte aux rapports sociaux et aux logiques de fonctionnement du système. Pour résoudre le problème écologique, il suffirait d’ajuster la taille de l’humanité aux potentialités de la planète en faisant une règle de trois. Telle n’est évidemment pas la position des objecteurs de croissance, ce qui n’empêche pas qu’ils soient parfois taxés de malthusianisme par ceux-là mêmes qui condamnent les deux tiers de l’humanité à l’extermination.
 Il est cependant clair que si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, cela concerne aussi la croissance de la population. La planète, qui n’a que 55 milliards d’hectares, ne peut pas supporter un nombre d’habitants illimité. C’est la raison pour laquelle presque tous les auteurs de référence de la décroissance − ceux qui ont mis en évidence les limites de la croissance comme, entre autres, Jacques Ellul, Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich ou René Dumont − ont tiré le signal d’alarme quant au risque de surpopulation. Et pourtant, ce ne sont pas, pour la plupart, des défenseurs du système… Même pour Castoriadis, « la relation entre l’explosion démographique et les problèmes de l’environnement est manifeste ».
Il est cependant clair que si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, cela concerne aussi la croissance de la population. La planète, qui n’a que 55 milliards d’hectares, ne peut pas supporter un nombre d’habitants illimité. C’est la raison pour laquelle presque tous les auteurs de référence de la décroissance − ceux qui ont mis en évidence les limites de la croissance comme, entre autres, Jacques Ellul, Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich ou René Dumont − ont tiré le signal d’alarme quant au risque de surpopulation. Et pourtant, ce ne sont pas, pour la plupart, des défenseurs du système… Même pour Castoriadis, « la relation entre l’explosion démographique et les problèmes de l’environnement est manifeste ».
Cela étant, ce que la décroissance remet en cause, c’est avant tout la logique de la croissance pour l’accroissement de la production matérielle. Même si la population était considérablement réduite, la croissance infinie des besoins entraînerait une empreinte écologique excessive. L’Italie en est un bon exemple. La population diminue, mais l’empreinte écologique, la production, la consommation, la destruction de la nature, des paysages, le mitage du territoire par la construction, la cimentification continuent de croître. On a pu calculer que si tout le monde vivait comme les Burkinabè, la planète pourrait supporter 23 milliards d’individus, alors que si tout le monde vivait comme les Australiens, le globe serait d’ores et déjà surpeuplé et il faudrait éliminer les neuf dixièmes de la population. Il ne pourrait pas faire vivre plus de 500 millions de personnes. Qu’il y ait 10 millions d’habitants sur Terre ou 10 milliards, note Murray Bookchin, la dynamique “marche ou crève” de l’économie de marché capitaliste ne manquerait pas de dévorer toute la biosphère. Pour l’instant, ce ne sont pas tant les hommes qui sont trop nombreux, mais les automobiles… La réduction brutale du nombre des consommateurs ne changerait pas la nature du système, mais une société de décroissance ne peut pas évacuer la question d’un régime démographique soutenable. Une fois qu’on aura retrouvé le sens des limites et de la mesure, la démographie sera alors un problème qu’il conviendra d’affronter avec sérénité.
Que faire pour changer de régime ? Combattre l’individualisme ?
Les gens accusent souvent les partisans de la décroissance d’être des passéistes. Pourtant, nous ne souhaitons pas un retour en arrière. Mais, comme le préconisaient Illich, ou même Castoriadis, il s’agit d’inventer un futur où nous retenons certains aspects du passé qui ont été détruits par la modernité. Sur ce sujet, un grand sociologue français, Alain Touraine, a sorti un livre intitulé La Fin des sociétés. C’est vrai qu’avec la mondialisation, on assiste à la fin des sociétés.
« Dans le projet de la décroissance, il ne s’agit pas de retrouver une ancienne société disparue mais d’inventer une nouvelle société de solidarité. »
À cet égard, un ancien Premier ministre anglais, Margareth Thatcher, a dit : « Il n’existe pas de société, il n’existe que des individus. » C’est énorme de dire cela ! Dans le projet de la décroissance, il ne s’agit pas de retrouver une ancienne société disparue, mais d’inventer une nouvelle société de solidarité. C’est-à-dire qu’il faut réinventer du lien social, parfois par la force des choses comme avec la fin du pétrole, sur la base d’une économie de proximité, avec une relocalisation de la totalité de la vie. Ce n’est pas un repli sur soi, mais une nouvelle redécouverte de la culture, de la vie, de la politique et de l’économie.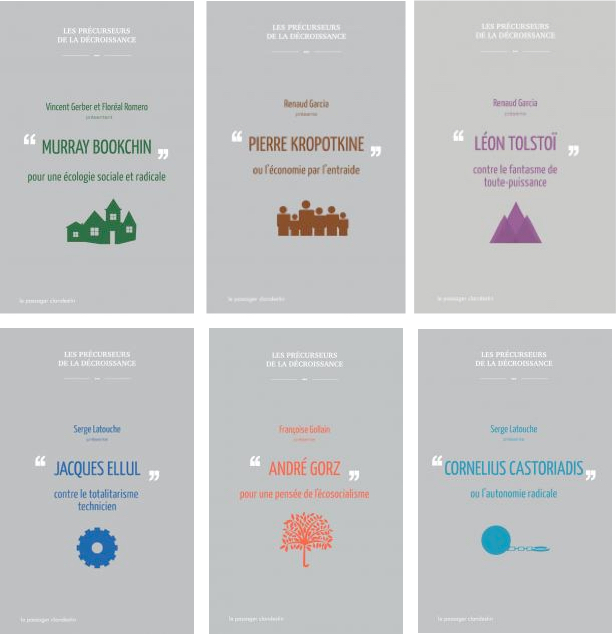
Justement, relocaliser les activités humaines serait une nécessité écologique. Mais la réindustrialisation potentielle qui en découlerait ne serait-elle pas une entrave à la décroissance ?
Non, parce qu’il ne s’agit pas de la réindustrialisation telle qu’elle est prônée par notre système. Madame Lagarde, quand elle était ministre de l’Économie, avait inventé le néologisme « rilance » : de la rigueur et de la relance. Pour nous, c’est exactement le contraire. Nous ne voulons ni rigueur, ni relance, ni austérité. Il faut sortir de la récession et recréer des emplois, évidemment, mais pour satisfaire les besoins de la population, pas pour retrouver une croissance illimitée. En fait, la réindustrialisation dans une optique de décroissance est plus artisanale qu’industrielle. Il faut se débarrasser des grosses entreprises au profit d’une économie composée de petites unités à dimension humaine. Ces dernières peuvent être très avancées techniquement mais ne doivent, en aucun cas, être les monstres transnationaux que nous connaissons actuellement. Elles doivent être plus industrieuses qu’industrielles, plus entreprenantes qu’entrepreneuses et plus coopératives que capitalistes. C’est tout un projet à inventer.
L’État moderne soutient toujours le productivisme, soit en favorisant l’offre pour les libéraux, soit en favorisant la demande pour les keynésiens. La décroissance prône-t-elle une disparition de l’État ?
Cela dépend de ce que nous mettons derrière le mot “État”. Même si l’objectif n’est pas de maintenir l’État-nation, bien sûr qu’une société de décroissance devra inventer ses propres institutions. Elles devront être plus proches du citoyen avec une coordination au niveau transnational. Celle-ci est vitale, car beaucoup de phénomènes environnementaux sont globaux ; il est donc impossible d’imaginer un repli total. Il faudra inventer de nouvelles formes qui diffèrent de l’appareil bureaucratique moderne.
La décroissance implique aussi un changement de mode de vie. Comment faire pour lutter contre la société marchande sans se marginaliser ?
Dans les objecteurs de croissance, il y a des gens très investis dans des coopératives alternatives comme les écovillages. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne : une société ne change pas du jour au lendemain. La transition doit être pensée sans attendre un changement global simultané. Les meilleurs exemples sont les villes en transition où l’on essaie de réorganiser l’endroit où l’on vit afin de faire face aux défis de demain comme la fin du pétrole. Ce qui m’intéresse surtout, dans les villes en transition, c’est leur mot d’ordre, « résilience », qui consiste à résister aux agressions de notre société. Mais cela n’implique pas de revenir à l’âge de pierre, comme les Amish. Au contraire, cela implique une qualité de vie maximale sans détruire la planète.
« Le projet ne se réalisera ni totalement ni globalement. La société de décroissance est un horizon de sens, mais pas une solution clé en main réalisable de façon technocratique. »
Changer de régime économique de manière isolée, est-ce possible pour un seul pays ?
Ça rappelle le vieux débat qui a opposé Staline à Trotsky pour savoir si le socialisme pouvait se faire dans un seul pays. En réalité, la réponse n’est ni oui, ni non. La question ne peut pas être posée de façon manichéenne, simplement parce que nous ne pouvons pas changer le monde du jour au lendemain ! L’amorce doit se faire petit à petit, au niveau local, en visant le global. La parole d’ordre des écologistes fut, pendant longtemps, « penser globalement, agir localement ». Ce n’est pas qu’il ne faille pas agir globalement, mais c’est plus complexe. Le point de départ est local, avec une visée plus large. Le projet ne se réalisera ni totalement ni globalement. La société de décroissance est un horizon de sens, mais pas une solution clé en main réalisable de façon technocratique.
La décroissance, selon vous, commencerait-elle par une « démondialisation » pour tendre vers une forme d’altermondialisme ?
Je n’aime pas le terme “altermondialisme”. Il s’agit évidemment d’une démondialisation, mais qui n’est pas synonyme d’une suppression des rapports entre les pays. Qu’est-ce que la mondialisation vécue aujourd’hui ? Ce n’est pas tant la mondialisation des marchés que la marchandisation du monde. Ce processus a commencé au moins en 1492 quand les Amérindiens ont découvert Christophe Colomb (rires) ! « Démondialiser » signifie qu’il faut retrouver l’inscription territoriale de la vie face au déménagement planétaire que nous connaissons.
« La solution est, non pas l’imposition de l’universalisme occidental, mais une relocalisation concertée par un dialogue interculturel. »
La mondialisation est surtout un jeu de massacres ! Nous détruisons ce qui, traditionnellement, fonctionnait bien dans les différents pays pour les asservir aux marchés. L’agriculture était, par exemple, fleurissante en Chine mais l’importation du modèle capitaliste occidental a déraciné la majorité des paysans qui sont alors devenus des mingong, c’est-à-dire des ouvriers qui s’entassent en périphérie des grandes villes, comme Pékin ou Shanghai. Dans le même temps, ces ouvriers chinois détruisent nos emplois et notre industrie. Nous nous détruisons mutuellement. Il faudrait, au contraire, que nous nous reconstruisions les uns les autres. La solution est, non pas l’imposition de l’universalisme occidental, mais une relocalisation concertée par un dialogue interculturel.
Les nouvelles technologies et, plus globalement, la technique et la science, peuvent-elles être employées contre l’oligarchie ou sont-elles intrinsèquement néfastes ?
 Ça c’est une grande question, très difficile. Jacques Ellul a énormément réfléchi dessus et n’a jamais dit qu’elles étaient intrinsèquement mauvaises. Il pensait même que, dans certaines situations, elles pouvaient être utiles à l’avenir de la société. Ce qui est, selon lui, intrinsèquement mauvais, c’est la structure sociale dans laquelle la technique et la science sont produites et utilisées. Bien évidemment, il est possible et nécessaire de les détourner. C’est ce que certains font d’ailleurs. Il y a une sorte de guérilla. Sur internet, par exemple. Dans ma jeunesse, nous parlions de retourner les armes contre l’ennemi.
Ça c’est une grande question, très difficile. Jacques Ellul a énormément réfléchi dessus et n’a jamais dit qu’elles étaient intrinsèquement mauvaises. Il pensait même que, dans certaines situations, elles pouvaient être utiles à l’avenir de la société. Ce qui est, selon lui, intrinsèquement mauvais, c’est la structure sociale dans laquelle la technique et la science sont produites et utilisées. Bien évidemment, il est possible et nécessaire de les détourner. C’est ce que certains font d’ailleurs. Il y a une sorte de guérilla. Sur internet, par exemple. Dans ma jeunesse, nous parlions de retourner les armes contre l’ennemi.
Dans une société de décroissance, qui n’est plus une société dominée par la marchandisation et le capital, ces techniques fonctionneraient autrement. Il y a aussi plein de choses intéressantes créées par le génie humain qui ne sont pas utilisées, car elles ne correspondent pas à logique du système. Nous aurons besoin de ces dernières dans une société différente. Nous devons, en réalité, surtout concevoir un nouvel esprit. Notre système est dominé – d’un point de vue technico-scientifique – par un idéal prométhéen de maîtrise de la nature, que nous ne maîtrisons pourtant pas. Il faut donc réinsérer l’Homme dans la nature, avoir une vision plus harmonieuse de nos rapports avec elle.
« Il faut réintroduire l’esprit du don – qui n’a pas totalement disparu – dans les rapports de clientèle et dans les marchandages. »
Jacques Ellul estimait que le travail était aliénant. Est-ce que la décroissance doit passer par l’abolition du salariat ?
Il n’y a pas d’urgence à l’abolir. Dans l’immédiat, il faut surtout créer les postes de salariés nécessaires. Il faut également réduire l’emprise de cette nécessité en développant notamment la gratuité. Je pense que l’idée d’un revenu universel, ou au moins d’un revenu minimal assurant la survie, n’est pas une mauvaise chose car il réduirait l’espace de la nécessité. Dans une société de décroissance, il faudra des échanges d’activités et d’œuvres pour remplacer le travail. Mais ce n’est évidemment plus l’échange marchand obsédé par le profit. Il faut réintroduire l’esprit du don – qui n’a pas encore totalement disparu – dans les rapports de clientèle et dans les marchandages. En Afrique, par exemple, il existe toujours une sorte de métissage entre la logique commerciale et celle du don. Ce qu’il faut surtout abolir, c’est le travail salarié en tant qu’abstraction inhumaine.
Pensez-vous que la monnaie s’oppose à la logique du don et qu’en conséquence, une société de décroissance doit abolir le système monétaire ?
Sûrement pas ! En revanche, certaines fonctions de la monnaie doivent être abolies. Il faut par exemple en finir avec la monnaie qui engendre de la monnaie, car l’accumulation monétaire est très perverse. Mais la monnaie comme instrument de mesure et d’échange est une nécessité dans une société complexe. Je dirais même que c’est un acquis de la civilisation.
Des personnalités de gauche comme de droite se revendiquent aujourd’hui de la décroissance. Qu’en pensez-vous ?
Le fait que la décroissance soit un projet politique de gauche constitue, pour la plupart des objecteurs de croissance, une évidence, même s’il en existe aussi une version de droite. Allons plus loin : il s’agit du seul projet politique capable de redonner sens à la gauche. Pourtant, ce message-là se heurte à une résistance très forte et récurrente. La décroissance constitue un projet politique de gauche parce qu’elle contredit fondamentalement le libéralisme économique. En ce sens, elle renoue avec l’inspiration originelle du socialisme en dénonçant l’industrialisation et remet en cause le capitalisme conformément à la plus stricte orthodoxie marxiste.
La décroissance est donc fondée sur une critique radicale du libéralisme, entendu comme l’ensemble des valeurs qui sous-tendent la société de consommation. On le voit dans le projet politique de l’utopie concrète de la décroissance en huit R (réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler). Deux d’entre eux, réévaluer et redistribuer, actualisent tout particulièrement cette critique. Réévaluer implique de revoir les valeurs auxquelles nous croyons, sur lesquelles nous organisons notre vie, et de changer celles qui conduisent au désastre. L’altruisme devrait prendre le pas sur l’égoïsme, la coopération sur la compétition effrénée, l’importance de la vie sociale sur la consommation illimitée, le local sur le global, l’autonomie sur l’hétéronomie, le raisonnable sur le rationnel, le relationnel sur le matériel, etc. Il s’agit surtout de remettre en cause le prométhéisme de la modernité tel qu’exprimé par René Descartes — l’homme « comme maître et possesseur de la nature » — ou Francis Bacon. C’est simplement un changement de paradigme. Redistribuer signifie répartir les richesses et réguler l’accès au patrimoine naturel entre le Nord et le Sud, ainsi qu’à l’intérieur de chaque société. Le partage des richesses est la solution normale au problème social. C’est parce que le partage est la valeur éthique cardinale de la gauche que doit être aboli le mode de production capitaliste, fondé sur l’inégalité d’accès aux moyens de production et engendrant toujours plus d’inégalités de richesses.
La décroissance renoue également avec l’inspiration première du socialisme, développée chez des penseurs indépendants comme Élisée Reclus ou Paul Lafargue. À travers ses inspirateurs, Jacques Ellul et Ivan Illich, la décroissance rejoint les fortes critiques des précurseurs du socialisme contre l’industrialisation. Une relecture de ces penseurs, comme William Morris, voire une réévaluation du luddisme, permettent de redonner sens à l’écologie politique telle qu’elle a été développée par André Gorz ou Bernard Charbonneau. L’éloge de la qualité des produits, le refus de la laideur, une vision poétique et esthétique de la vie sont probablement nécessaires pour redonner sens au projet communiste.
Pour finir, la décroissance constitue une remise en cause totale de la société de consommation et du développement, une critique ipso facto du capitalisme. Paradoxalement, on pourrait même présenter la décroissance comme un projet radicalement marxiste, que le marxisme, et peut-être Marx lui-même, aurait trahi. La croissance n’est, finalement, que le nom “vulgaire” de ce que Marx a analysé comme l’accumulation illimitée de capital, source de toutes les impasses et injustices du capitalisme. Pour sortir de la crise, qui est inextricablement écologique et sociale, il faut sortir de cette logique d’accumulation sans fin du capital et de la subordination de l’essentiel des décisions à la logique du profit. C’est la raison pour laquelle la gauche, sous peine de se renier, devrait se rallier sans réserve aux thèses de la décroissance.
On se souvient de l’échec de la commission Stiglitz-Sen, mise en place par l’ex-président Sarkozy dans le but de trouver un indicateur de “bien-être” autre que le simple PIB. Le problème ne viendrait-il pas de l’obsession des mesures quantitatives ?
Il est certain que nous devons nous débarrasser de cette obsession des mesures quantitatives. L’objectif ne devrait pas être de mesurer le bonheur puisqu’il n’est pas, par définition, mesurable. Cependant, je ne crois pas que nous puissions parler d’échec de la commission Stiglitz-Sen puisqu’elle a, quand même, proposé des indicateurs alternatifs pertinents. Par ailleurs, et malgré toutes les critiques qui peuvent lui être adressées, le PIB est tout à fait fonctionnel dans la logique de la société mondialisée de croissance. Il existe d’autres indicateurs comme l’Happy Planet Index (HPI) mis au point par la fondation anglaise New Economics Foundation, mais ce dernier n’est pas fonctionnel dans notre système. Il reste néanmoins intéressant comme indicateur critique du PIB. Pourquoi ? Les États-Unis, par exemple, sont au 1er rang mondial pour le PIB, à la 4e place de PIB par tête et au 150e rang de HPI ! La France se situe dans le même ordre de grandeur. Si nous mesurons le bonheur avec l’espérance de vie, l’empreinte écologique et le sentiment subjectif du bonheur − qui sont les trois critères du HPI −, les pays qui arrivent en tête sont le Vanuatu, le Honduras, le Venezuela [le trio de tête de 2012 est composé, dans l’ordre, du Costa Rica, du Vietnam et de la Colombie, NDLR]. Un autre indice de ce type, qui pourrait être retenu, c’est l’empreinte écologique qui est elle-même synthétique. Le problème n’est pas de trouver l’indicateur miracle mais bel et bien de changer la société. Ces indices ne sont que des thermomètres et ce n’est pas en cassant le thermomètre que la température du malade change.
La rupture avec la croissance n’est-elle pas aussi une rupture avec l’économie comme science au profit d’autres disciplines comme la philosophie ou la sociologie ?
Oui, il s’agit bien d’une rupture avec l’économie. Il faut ré-enchâsser l’économique dans le social, au niveau théorique mais surtout au niveau pratique. Au niveau théorique, d’abord parce que la “science économique” est une fausse science. La manière de vivre des hommes appartient à l’éthique, au sens aristotélicien du terme, et donc à la philosophie ou à la sociologie. Pour paraphraser Lévi-Strauss, il n’existe qu’une seule science humaine : l’anthropologie. Au niveau pratique ensuite, en réintroduisant l’économique dans la vie et en ne le laissant pas devenir une obsession avec la valorisation de l’argent, du profit ou du PIB.
Sur le Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales
Le MAUSS, ou Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, est une revue intellectuelle interdisciplinaire née en 1981 autour d’un noyau de savants francophones (Alain Caillé, Gérald Berthoud, Ahmet Insel, Serge Latouche, Paulette Taieb). L’histoire dit que c’est autour d’un déjeuner que Gérald Berthoud, anthropologue suisse, et Alain Caillé, sociologue français, eurent l’idée de commencer cette aventure. Discutant d’un colloque sur le don de plusieurs jours auquel ils avaient assisté (au centre Thomas-More de l’Arbresle), ils se rendirent compte du cynisme plus ou moins assumé de tous les universitaires présents. En effet, nul ne semblait admettre la possibilité que le don eût, originellement, une raison purement altruiste, désintéressée. Creusez un peu, “déconstruisez” les motivations humaines et vous tomberez toujours, in fine, sur un fondement égoïste : telle semblait être la doxa des savants, dans des disciplines aussi diverses que l’économie, la sociologie ou la psychanalyse.
Pensez-vous, en pleine effervescence du concept d’Homo œconomicus – entendre par là l’idée que l’homme serait par nature un individu asocial, rationnel, égoïste et calculateur – la critique se faisait bien silencieuse. La science économique, et ses velléités autarciques (« on s’occupe de l’économie et vous du reste »), tendait soudain à l’impérialisme disciplinaire. Sous l’impulsion d’universitaires, au premier rang desquels se trouvait l’économiste néo-classique Gary Becker, l’Homo œconomicus passait du marché aux autres domaines de l’humanité (famille, amour, amitié…). Des sociologues, comme Raymond Boudon (phare de l’individualisme méthodologique) ou Alain Touraine, se servaient ainsi de ce postulat pour avancer leurs thèses et expliquer ainsi les comportements humains. Par ailleurs, et ce de manière surprenante, il en allait de même pour le sociologue Pierre Bourdieu, lecteur attentif de Gary Becker, qui parlait de faire une « économie générale de la pratique ». D’après Caillé, la notion même de désintéressement n’était pour lui qu’un « masque, qu’une série d’apparences » et, d’ailleurs, il reprochait aux économistes non pas de généraliser leur modèle, mais de ne pas le faire suffisamment.
C’est donc en prenant contact avec d’autres universitaires partageant le même constat que fut créée le MAUSS sous la forme d’une association de loi 1901. Celle-ci publia pour la première fois en 1982, le Bulletin du MAUSS, ancêtre de la revue du même nom. L’appellation tenait à un double mouvement : une critique de l’économisme ainsi qu’un hommage à la sociologie du don de Marcel Mauss, dont ils se voulaient les héritiers. Néanmoins, d’après Caillé, leur notion de l’utilitarisme restait extrêmement vague, voire sommaire : il s’agissait surtout de s’opposer à la « mathématique des calculs et des peines » de Jeremy Bentham, et plus généralement à la représentation du monde qui ramène tout à la question : “À quoi ça sert ?” Au fil du temps, leur vision de l’utilitarisme s’est affinée, et le Bulletin a réalisé que, loin d’être seulement l’idéologie de la bourgeoisie (telle que l’analysait la vulgate marxiste), l’utilitarisme était une représentation du monde qui existait déjà durant l’Antiquité et qui s’est radicalisée sous la modernité. L’invasion de toutes les sphères humaines par l’économie, auparavant “encastrée” dans une culture, en serait ainsi l’apothéose.
Le Bulletin du MAUSS, au départ édité avec des moyens modestes, a grandi avec le temps. Servant surtout de bulletin de liaison extra-universitaire entre les chercheurs qui y participaient, peu reproduit, il devint, après plusieurs années, la grande revue interdisciplinaire que l’on connaît aujourd’hui. Il est alors repris par les éditions La Découverte, et renommé pour l’occasion Revue du MAUSS trimestrielle (1989-1992), puis Revue du MAUSS semestrielle (depuis 1993). On est loin du maigre bulletin quasi-potache d’une bande d’universitaires atypiques ; elle trône désormais aux côtés des plus grandes revues de sciences humaines, et touche à de nombreuses thématiques, du care à la prison, en passant par les socialismes oubliés. Jacques Généreux, Jean-Claude Michéa, Cornelius Castoriadis, Jean-Pierre Le Goff, Jacques Sapir, Jean-Louis Prat : autant de noms qui y sont passés à un moment ou à un autre. La troupe est devenue internationale, leur bébé adulte, et ce dernier demeure l’un des plus précieux outils de compréhension du monde à disposition des adversaires du capitalisme, ce « fait social total » comme aurait dit leur maître.
Nos Desserts :
- Au Comptoir, nous sommes également entretenus avec Alain Caillé, fondateur de la Revue du MAUSS
- Mais aussi avec Vincent Cheynet, Vincent Liegey et Pierre Thiesset sur la décroissance
- Aurélien Bernier nous disant qu’« Il est possible et nécessaire de démondialiser, décroître et coopérer »
- Retrouvez la Revue du MAUSS et la collection Les précurseurs de la décroissance dirigée par Serge Latouche aux éditions du Passager clandestin
- Institut d’études en sciences économiques pour la décroissance soutenable
- Institut de recherche anglophone sur la décroissance
- Association internationale Jacques Ellul
Catégories :Politique

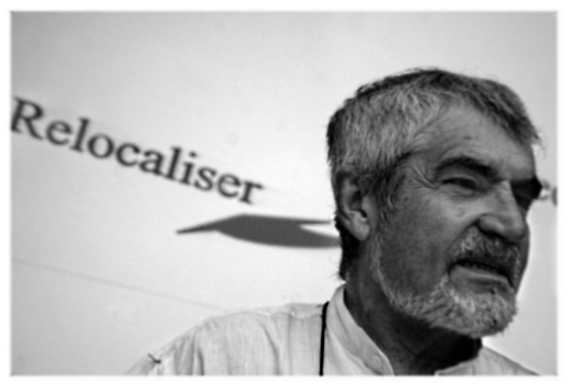
« la décroissance constitue une remise en cause totale de la société de consommation et du développement », ben non, il y est toujours question de valeurs morales à révolutionner avant toute action possible (ou alors peu à peu, à l’échelon du local…), mais jamais de la création des valeurs économiques – question pourtant incontournable , et qui concerne au plus haut point les travailleurs que nous sommes.
Ce qui fait clairement de la décroissance un mouvement bourgeois, droitier et condamné à la marginalité.
Le revenu de base? Madelin et Boutin sont pour, ça fait de nous des consommateurs pauvres. Mais Serge Latouche n’a jamais entendu parler de Bernard Friot et des possibilités ouvertes par le salaire à vie?
Les décroissants nous enfument avec des références à la pelle à des penseurs socialistes morts, parce que les penseurs socialistes vivants ne les intéressent pas. J’espère de tout cœur que Jean-Claude Michéa va se sortir de ce merdier et réussir à s’ouvrir à des propositions contemporaines, à des Lepage, des Friot, des Filoche.
Premier paragraphe incompréhensible. Je ne comprends pas du tout le reproche formulé à l’encontre de la décroissance dans ce commentaire.
Bernard Friot ne propose pas une remise en cause du capitalisme, mais simplement de rebaptiser le RSA en salaire à vie en le réévaluant un peu. Ça me semble un peu léger comme « remise en cause totale de la société de consommation et du développement ».
La décroissance est un mouvement philosophique d’abord. L’idée de la décroissance se résume dans son mot-concept : revenir à l’intuition première du socialisme, identifier le capitalisme/la croissance comme une religion, une obsession dangereuse et mortifère dont il faut se débarrasser. L’idée, c’est d’amener les travailleurs à « décoloniser leur imaginaire », à changer leurs représentations. La décroissance renvoient ceux qui appellent à un changement à résoudre d’abord leurs propres contradictions, à brûler leurs idoles et renoncer aux fausses solutions des gestionnaires de l’effondrement. C’est seulement à partir de là que peuvent se développer les fondations d’un monde post-capitaliste.
Qualifier la décroissance de mouvement bourgeois est une preuve d’ignorance totale sur la question. Que ce soit les sources de la décroissance ou ses défenseurs principaux actuels, il n’y a que des figures honnêtes, modestes et travailleuses à l’opposé du monde bourgeois.
C’est bien ce que je disais. La mouvance décroissante prétend opérer une révolution culturelle, mais se pince le nez devant le quotidien du travailleur: la production de valeur économique.
De plus, elle prétend suspendre l’action politique et syndicale tant que cette hypothétique et intuitive révolution culturelle n’aura pas été réalisée. On a là une belle définition du sectarisme, et c’est sans doute d’abord de ses propres contradictions que cette mouvance devrait se préoccuper. Pendant qu’elle fait la leçon au monde entier, le capital étend très concrètement son emprise sur nos vies.
J’ajoute que vous n’avez rien compris à la démarche intellectuelle de Bernard Friot si vous le confondez avec celle de Martin Hirsch (RSA) ou même avec celle de Michel Rocard (RMI). Sa pensée doit tout à l’anarchosyndicalisme, et rien à la charité humanitariste libérale. C’est ce qui distingue le salaire à vie des rêveries d’un Mylondo, c’est ce qui en fait une authentique alternative, irrécupérable par les libéraux.
Approcher le combat anti-capitaliste avec la simple approche syndicaliste (qui se résume à du micro-management apolitique) ou anti-patron (Front de Gauche) n’a pas rendu service au mouvement social ces 30 dernières années. On est toujours dans du court terme, dans de la gestion de l’effondrement tendance sociale. Et ce court-termisme a donné si peu de résultats à long-terme (évidemment) qu’il a ridiculisé le mouvement social pour les travailleurs eux-mêmes qui n’y croient plus. Les jeunes travailleurs, qui ont toujours vu les syndicats défendre uniquement les plus âgés, les insiders, et être complice de leur précarité, n’adhèrent naturellement plus. Même résultat niveau politique : ils ne votent plus. Et ils ont bien raison.
Les représentants institutionnels ne sont plus écoutés, simplement parce que les gens constatent tous les jours les effets de leurs compromissions.
Aujourd’hui, nous avons besoin plus que jamais de radicalité politique. La décroissance (dont le message finit d’ailleurs par se répandre, par le bas) est le seul mouvement à offrir aujourd’hui cette radicalité indispensable pour penser le combat avec des termes qui ne servent pas le pouvoir. La décroissance fait effectivement la morale, elle rétablit la culpabilité. Car sans morale, sans culpabilité, il n’y a pas de responsabilité, pas de liberté, pas de vertu. L’écologie est une morale. Le combat social est moral. La décroissance l’assume, tandisque syndicats et partis s’embourbent dans d’interminables négociations qui sont conçues pour nous faire perdre (Air France, Tsipras, …).
Nous avons besoin de discours nouveaux, de formes nouvelles de combat. Les Zadistes l’ont compris.
On peut donc, comme vous, se réjouir de constater que les jeunes travailleurs désertent syndicats et partis. Bien sûr, ils se retrouvent ainsi plus isolés que jamais face à la prédation toujours plus violente du marché du travail. Mais c’est sans doute secondaire?
Il est vrai que les penseurs décroissancistes seront toujours là pour donner à ces jeunes travailleurs quelques conseils pour une bonne résilience et pour prodiguer aux plus idéalsites d’entre eux l’illusion qu’ils participent à la vie de la cité, voire même à la lutte des classes, par la force de leur sens moral et de la somme des refus qui l’accompagnent. A l’opposée, ce que les Zadistes ont compris, c’est que c’est le combat social qui engendre de la morale et des structures. https://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/FREEMAN/51942
Ces « penseurs » et ces manitous du retour à la terre pourraient tout aussi bien pousser les jeunes (et les moins jeunes) à investir syndicats et partis en leur enseignant comment y retourner la table, leur donner du cœur à exister plutôt que les aider à s’effacer. Mais ce serait alors politique. Pouah!
Quand la structure est pourrie, il est illusoire de penser la sauver en bricolant un peu. Chaque adhésion est un vote de confiance qui donne du pouvoir aux cadres réformistes libéraux des syndicats et partis. Chaque vote est un consentement à être dirigé par l’élu. L’adhésion et le vote, c’est précisément la fin de la politique, l’abstention son point de départ. Je pensais que c’était une évidence.
« C’est le combat social qui engendre de la morale et des structures. » On ne dit pas autre chose. Simplement, vous remarquerez que les zadistes crachent sur les partis comme sur les syndicats. A NDDL que je connais bien, il ne fait pas bon faire du prosélytisme pro-EELV par exemple.
Réduire les décroissants à des idéalistes, des « manitous du retour à la terre » est une caricature grotesque. Ouvrez un livre, lisez la Décroissance, rencontrez ses auteurs et on en reparle. La décroissance est au contraire une entreprise terre à terre visant à penser les moyens concrets d’existence. Tous les penseurs valables de notre époque reconnaissent l’intérêt de la décroissance.
Personnellement, j’ai moins de 30 ans, tous mes amis sont pour la décroissance et agissent en ce sens. Individuellement et collectivement. C’est ça la politique. Pas adhérer à un organisme chargé de gérer ta colère au profit des puissants. Je connais personne de syndiqué dans ma génération, et un seul encarté PS que je ne vois plus depuis. Et c’est pour ça qu’on peut changer les choses : nous n’avons plus d’illusions.
La ZAD semble pour vous un drapeau, c’est très bien, mais ce n’est pas une raison pour vous exprimer en slogans (sur le vote, sur le syndicalisme…) D’ailleurs, je remarque une chose, c’est que l’initiative prise par les Zadistes vous préserve de me répondre sur le fond: que deviennent dans votre pensée les jeunes travailleurs que vous évoquiez plus haut, détournés par les Saint Jean Bouche d’Or décoissancistes de l’action politique, et sommés de s’organiser d’eux-mêmes? Des précaires revendiqués? Des intérimaires heureux? Des libres-entrepreneurs décomplexés? Tout cela existe bel et bien. Alors?
Vous me conseillez d’ouvrir des livres (vous êtes bien aimable…) et de lire le mensuel La Décroissance. Je lis, figurez-vous, j’ai lu ce canard avant de réaliser que les imprécations et les vœux pieux qui y sont rabâchés de mois en mois représentaient une impasse. Quant à y retrouver régulièrement en médaillon le portrait de Natacha Polony, sympathisante revendiquée du souverainisme, soutien de la Fondation pour l’Ecole, il me semble qu’on a là la porte ouverte à toutes les confusions politiques, de celles qui mènent tout droit au libertarianisme le plus débridé.
Je parlais d’investir les syndicats pour y renverser la table, vous me répondez qu’il est illusoire de « bricoler un peu »: c’est donc que vous ne voulez pas entendre les mots les plus simples.
Pour ma part, je suis à ce jour passé par différentes expériences politiques que vous appelleriez concrètes. Et suis en rogne contre tous les discours très complaisants (parfois tenus par des guignols qui s’accommodent par la suite très bien du système) qui coupent, par un extrémisme délirant, les structures potentiellement contestataires (j’y inclus les syndicats) de tout renouvellement. Elles ne peuvent alors que sombrer dans le conformisme, et pourrir du dedans. S’en réjouir au nom de la révolution qui ne va pas tarder à arriver (sûrement un peu comme ce brave Godot), c’est une démarche qui semble vous convenir intégralement. Vous avez au moins le sentiment de prendre le mal à la racine. Donc tout va bien. Vous n’avez plus d’illusions. Vous pouvez changer les choses. Eh bien, changez-le sans tarder, car nos ennemis, eux, n’attendent pas, et le changent quotidiennement, vers le pire.
Je ne m’inquiète pas pour l’état d’esprit des Zadistes, dont la vitalité et la fraîcheur sont exemplaires. Qu’ils essaiment me ferait très plaisir.
« que deviennent dans votre pensée les jeunes travailleurs » Qu’attendez-vous que je vous réponde ? Je vous dis que c’est précisément cette soif de réponse toute faite, de solutions « clés en main » qui livrent les citoyens aux mains des capitalistes dont c’est le métier de fabriquer ce genre de produit politique prêt à consommer. Dans les faits, il appartient à tous de construire la société. Mais pour cela, il conviens d’abord de quitter les illusions du vieux monde (croissance, progrès, carrière, accumulation, résolution des problèmes posés par la technique grâce à la technique, croyance dans le fait de sauver le monde…), de faire la critique de la gauche, du militantisme traditionnel et de ses trahisons, et de rentrer dans le mouvement social selon ses possibilités (manifestations, ZAD, débats, organisation individuelle & collective, mutualisation, etc.).
Ensuite, la décroissance ne détourne personne de l’action politique. Elle prend acte du désengagement qui existe déjà (qu’elle n’a pas créé) d’une part, de l’inefficacité des formes traditionnelles d’action d’autre part, et elle essaye d’investir ce vide politique en retournant aux racines du socialisme et en en mettant à jour le discours. Accuser la décroissance des crimes de la gauche post-moderne/libérale, c’est d’une colossale mauvaise foi. Ce que vous appelez les discours très complaisants et extrémistes (?) « qui coupent les structures potentiellement contestataires (j’y inclus les syndicats) de tout renouvellement » pour moi c’est du flan. Ce qui empêche le renouvellement des structures, ce sont les structures elles-mêmes. Jacques Ellul a écrit des trucs très pertinents là-dessus (dans L’illusion politique notamment). Quel que soit la structure (syndicat, parti,…) on arrive au pouvoir que si l’on ne dérange pas le pouvoir. Encore une fois, l’épisode Tsipras de cet été en est l’exemple parfait.
La décroissance formule des critiques qui ne sont pas une impasse, mais constituent au contraire les fondations d’une représentation politique qui a fait le deuil du productivisme. Ce journal propose une critique radicale réellement utile, inédite et qui ne rabâche pas justement. Qu’on pense à l’article central, aux textes d’Alain Gras, d’Accardo, de Jarrige, de Biagini, Michéa, Thiesset, Cheynet, etc. : ce ne sont que des textes solides, exigeants, qui s’intéressent souvent à des impensés ou des zones d’ombres de la critique : l’histoire de l’industrie, la critique de la technique, la linguistique capitaliste, la critique des mouvements alter (Colibri, etc.), … Un travail de vraie critique qui dérange parce qu’il touche à nos propres contradictions et attaque nos illusions (et il n’y a rien qu’on aime plus que nos illusions, on y croit dur comme fer à la reprise, même à gauche !).
Bref, vous êtes en mesure de changer le monde parce que vous n’avez plus d’illusions (dites-vous). Mais dans le même temps, vous appréciez d’avoir un mensuel qui attaque vos illusions (parce qu’il n’y a rien que vous n’aimiez plus, dites-vous, que vos illusions). Somme toute, quand on vous lit, on se dit qu »il n’y a pas besoin pour les Cheynet et autres de creuser très longtemps pour toucher aux contradictions de son lectorat – lectorat qu’ils préservent assez jalousement des effets de la dialectique un peu poussée qui permettrait de résoudre au moins une partie de ces contradictions. Mais ce n’est que mon opinion.
Plus « sérieusement »: à l’origine de notre échange, il y a une critique de ma part sur la pensée « décroissanciste ». De mon point de vue, une pensée politique qui ne cherche pas, à un moment ou à un autre de son avancement, à articuler le particulier avec l’universel, une telle pensée n’est pour moi qu’une forme trop subtile de résignation. C’est la réflexion que m’inspire le début de votre dernier message sur ces jeunes travailleurs. Jeunes travailleurs que vous convoquiez au début de notre échange, pour finalement mieux pointer ma présumée « soif de réponse toute faite », voire même de ma part une « colossale mauvaise foi ». Pourquoi pas, après tout? Je crois me souvenir que la morale est de votre côté, ce qui vous autorise, sinon à discréditer votre interlocuteur, du moins à le bousculer un peu. « Mauvaise foi », c’est pas bien méchant. De toute façon, je persiste: « elle prend acte du désengagement » signifie pour moi « si elle s’y résigne aussi volontiers, c’est aussi parce que ça fait bien ses affaires ». Mais j’aggrave mon cas, et me voilà en plus mauvais coucheur.
De la critique que j’exprimais au départ, vous écriviez qu’elle vous était en grande part « incompréhensible ». Or, rien dans notre échange pourtant assez abondant ne me permet d’affirmer que l’une ou l’autre des mes affirmations ne vous a depuis été d’un grand secours pour comprendre ce que je voulais dire. En même temps, j’imagine bien que par « incompréhension », vous entendiez « irréductible désaccord de fond « .
Tellement irréductible que nous ne parviendrons probablement jamais, en tout cas dans le cadre de cet échange électronique, à un quelconque compromis qui nous aiderait à envisager différemment nos positions respectives, sous l’angle d’une faiblesse inédite susceptible d’amender notre jugement par exemple. J’entends bien que je devrais faire plus d’effort pour, d’après vous, « quitter les illusions du vieux monde » et « faire la critique de la gauche » – c’est aussi ce à quoi nous enjoint M.Emmanuel Macron, mais n’allez pas en conclure une seconde que j’amalgame votre propos avec celui de « notre » ministre (tellement dévoué à sa propre cause que le mot « mouvement social » n’évoque probablement pour lui qu’une sorte de gène assez comparable à celle causée par le chant d’un moustique entré par effraction dans son bureau).
J’entends mieux la salutaire volonté de retourner aux racines du socialisme (portée presque exclusivement par M.Michéa, mais il faut reconnaître que le mensuel la Décroissance le publie). Cependant, en dehors des quelques rares contributions de cet auteur exceptionnel, la volonté de « mise à jour des discours » n’est pas évidente, pas plus que ne l’est pas l’intérêt pour la condition actuelle des travailleurs. Des intellectuels aussi pétris de morale pourraient pourtant consacrer plus d’énergie à investir de sens le concept de « décence ordinaire », afin de mieux le traduire en termes d’action politique, et de mieux comprendre le si fréquent désarroi des « jeunes travailleurs », surtout lorsque ces « jeunes travailleurs » sont taraudés par le besoin de changer les choses – et pas forcément par celui, tout de même moins impérieux, de se passer de téléphone.
Certes, les processus de transformation des individus en consommateurs sont grandement en cause dans notre désarroi. Mais l’impossibilité d’agir en est une autre, tout aussi dramatique. Et dauber ainsi des formes de lutte qu’il faudrait au contraire encourager à révolutionner (révolutionner!) de l’intérieur…non, désolé, ça ne passe pas. Et si vous pensez que c’est par manque de « réponse toute faite » que je poursuis cet échange froid et virtuel, alors je vous dis m….!
Le capitalisme, comme toute religion, ne tiens que parce que l’on continue à avoir foi en ses principes (fétichisme de la marchandise, valeur de l’échange marchand, etc.). Pour moi, dévoiler le monde de la croissance, en rendre apparent ses supercheries publicitaires, c’est une des meilleures manière d’envisager autre chose (l’autre manière étant, comme vous l’avez souligné, la participation au mouvement social). Lire La Décroissance ne remplace pas la lecture d’essais plus développés. C’est un mensuel, je n’attends pas de sa lecture une révélation cosmique, mais davantage une lecture de l’actualité à l’aune des références intellectuelles et politiques anti-capitalistes. La Décroissance n’est pas une secte comme vous l’insinuez, ce n’est pas un mouvement homogène ni très structuré. Il n’y a pas de tables de la loi décroissante, ni de programme politique décroissant (même s’il y a des pistes évoquées dans de nombreux ouvrages de Latouche ou Cheynet par exemple). C’est un mouvement spontanée en perpétuel changement. Le journal lui-même a énormément évolué depuis sa création, et continue de le faire.
Pour le reste, je crois commencer à cerner votre préoccupation : le rapport qu’entretiens la décroissance avec le peuple. Ou, pour formuler autrement la question : la décroissance est-elle partie de la culture populaire ? Une question légitime et épineuse, posée d’ailleurs régulièrement dans le journal. Cette question renvoie en fait d’autres débats : quel est l’état de la culture populaire ? du mouvement social ?
J’estime que la décroissance est féconde dans les courants militants. Elle a audience chez les déboulonneurs par exemple (et pour cause, le journal s’appelait jadis Casseurs de pub), chez les Zadistes et dans d’autres courants politiques qui attirent en nombre les jeunes travailleurs (dont moi, il y a 5 ans maintenant).
Dans le reste de la population, elle rencontre des difficultés, résumés dans un article paru dans le numéro de ce mois-ci : ((« [La difficulté à faire de l’écologie populaire] est double. La première est que la réussite se mesure ordinairement en acquisition de moyens polluants, tels que grosse voiture, voyages en avion, etc., qui semble-t-il ne dérangent personne, du moins tant qu’on ne parle pas d’écologie. La seconde est que la qualité se paie, ce qui est difficile quand les revenus sont limités.
Aller vers une écologie populaire suppose donc de s’appuyer sur ce que les cultures populaires peuvent encore d’avoir d’opposé, par rapport aux critères de l’élite. Le problème étant que ces cultures sont devenues très minoritaires : c’est ce que suggère le sentiment très large d’appartenance à la classe moyenne. Un combat se dessine cependant : l’enjeu de la qualité. Elle peut utilement compléter des revendications plus quantitatives telles que celles qui sont portées par les syndicats sur le niveau de salaire. »))
Vous semblez croire que c’est par hasard que Michéa a atterrit à La Décroissance. Ce n’est pas le cas. La Décroissance est un journal qui place le sort des plus défavorisés et la morale populaire au cœur de son écologie politique. Son soucis de réhabiliter l’austérité comme une valeur centrale de la gauche(voir notamment le n°121), est motivée par le fait un profond soucis de justice sociale.
L’exemple vaut mieux qu’un long discours, extrait de l’article « Eco-capitalisme contre austérité révolutionnaire », P. Thiesset :
((« L’austérité révolutionnaire, la gauche n’en a donc jamais voulu. Ce n’est pas payant électoralement, d’appeler à se restreindre. Pour séduire, mieux vaut vendre des bagnoles, de la vitesse, du fun, des semaines aux Seychelles, de l’expansion illimitée, du pouvoir d’achat en veux-tu en voilà. Comme l’observait Jacques Ellul, une propagande « qui présenterait l’avenir l’avenir de l’homme sous l’aspect d’une austérité et d’une contemplation n’aurait aucune audience. Une propagande qui mettrait en doute le progrès ou le travail scandaliserait et ne pourrait atteindre personne ». Pourtant, Ellul considérait que l’austérité communiste de Berlinger, la « frugalité commune, générale, volontaire et organisée, provenant d’un choix pour plus de liberté et moins de consommation de biens matériels », était ni plus ni moins que « l’option décisive de notre société ». Qui ne conduirait non pas à la rareté, mais à l’abondance : car c’est dans l’autolimitation, dans la capacité à se contenter de peu, à satisfaire facilement ses besoins, sans courir sans cesse après de nouvelles superfluités, que l’on atteint la plénitude ; certainement pas dans la consommation compulsive. »))
L’idée centrale, c’est que la misère est une création de la croissance économique, que le manque est produit par un développement industriel désordonné, et que l’abondance ne peut être retrouvé que dans la limite. Et pour défendre cette thèse, La Décroissance convoque le socialisme des origines et ses héritiers actuels (le GrecYannis Youlountas par exemple, que même nos médias « de gauche » ignorent soigneusement). Point de résignations, mais au contraire une radicalité qui renvoie dans les cordes les relayeurs du discours bourgeois auprès du peuple que sont les classes moyennes.
Pour rebondir très rapidement sur Michéa et la décroissance (dans votre débat qui est malgré tout très intéressant), deux petites précisions :
1/ Michéa et Latouche sont très amis. C’est d’ailleurs indirectement grâce au premier que j’ai pu interviewer le second.
2/ La Décroissance ne fait que que publier un texte par an de Michéa, ils en sont aussi proche. Vincent Cheynet dans son dernier bouquin multiplie d’ailleurs les citations de Michéa.
Donc en effet, l’adhésion de Michéa à la décroissance ne tombe pas du ciel. Il est d’ailleurs prévu comme intervenant au prochain contre-sommet organisé par La Décroissance près de Lyon le 14 novembre prochain.
Quoiqu’il en soit de l’éventuelle fécondité de la pensée décroissanciste (que je conteste, vous l’aurez compris), il faudrait quand même envisager, au moment où l’on ressort cette référence historique, que lorsque Enrico Berlinguer promeut une austérité révolutionnaire en Italie, le PCI fait plus de 30% aux élections, et le taux de syndicalisation tourne autour de 48%. Berlinguer dispose donc de relais et de puissants leviers d’action. Sa promotion d’une certaine austérité ne risque à aucun moment d’apparaître pour ce qu’elle n’est pas, une tentative de diversion gauchisante, un clin d’oeil à la droite ou que sais-je encore.
Ne pas le rappeler, c’est faire parler Berlinguer et Ellul à quarante ans de distance, c’est leur attribuer un message essentialisé (et non plus une position politique située), et utiliser leurs propos en dehors de toute contextualisation réelle. Et cela, en conscience, je vous le demande: est-ce bien raisonnable? Et est-ce bien honnête aussi, alors qu’on se réjouit par ailleurs de voir se vider de leurs forces vives les syndicats et partis (ces affreux promoteurs de croissance) qui avaient souhaité en d ‘autres temps, grâce à leur puissance politique d’alors, une déprise radicale du fétichisme de la marchandise (fétichisme qui n’est d’ailleurs pas un acte de foi, mais une réalité économique structurelle)?
Je dirai que notre désaccord viens du fait que vous pensez qu’il faut être compréhensif et patient envers les vieilles dames corrompues de la politique traditionnelle que sont les partis et syndicats, quand je pense (opinion pas forcément partagée dans toute la décroissance), qu’il conviens au contraire d’exiger la radicalité sans attendre, de réfléchir concrètement à des moyens d’existence, des modes de vies post-capitalistes, dès à présent, avec qui veux bien, sans rien attendre des traîtres en série de la représentation politique.
De mon point de vue, l’effondrement a déjà commencé et durera probablement des générations, un ou deux siècles. Le réformisme est plus ringard (dans le sens largué, naïf, irréaliste) que jamais. L’idée n’est pas de convertir un monde déjà mort, mais de se projeter déjà, concrètement, dans l’après-développement. DIY, recherche d’autosuffisance, se répandent chez les jeunes précisément parce qu’ils expérimentent concrètement les premiers effets de cet effondrement. Ils galèrent pour trouver un boulot, pour trouver un logement, ils ont des difficultés pour tout, quotidiennement. L’important, l’urgence, c’est le maintenant, c’est l’ici, c’est quoi manger, comment se loger, comment se déplacer, comment se chauffer, comment se soigner, etc. On ne parle que de ça par chez moi : comment, avec peu et dans des conditions toujours plus précaires, retrouver un équilibre au quotidien, une stabilité, une vie sociale et culturelle. Le socialisme originel prenaient ces questions à bras le corps. Seule la décroissance le fait aujourd’hui.
Les syndicats et partis sont adaptés à une clientèle embourgeoisée : les fonctionnaires, retraités ou les cdistes. Ils s’adressent à la classe moyenne qui ne réclame que croissance, pouvoir d’achat, bagnoles, pavillons et vacances tropicales. Ils sont incapables d’aller au-delà du discours anti-finance. Je vais à suffisamment de manifs pour savoir que leur discours va dans la mauvaise direction. Malheureusement, leur erreur ne peut que précipiter leur perte, car l’histoire est têtue : le productivisme, de gauche ou de droite, est destiné à crever la gueule ouverte. La question n’est donc pas : quand est-ce que la décroissance appellera à adhérer en masse aux partis et syndicats, mais quand est-ce que ces partis et syndicats appelleront à la décroissance ? Quand est-ce que ces saloperies de cadres politiques et autres intellectuels médiatiques arrêteront d’insulter de réactionnaires et de rétrogrades, voir d’extrême droite, ceux qui en appellent à l’autolimitation et à la simplicité volontaire ? Quand est-ce que pour chaque Michéa qui l’ouvre, on arrêtera de trouver une armée de Lordon pour crier au FN et à l’horrible populisme ? Depuis quand populisme n’est plus un mot de gauche ? C’est les questions que je te pose moi, et à tous ceux qui ne comprennent pas la haine (par ailleurs très populaire) des partis et de la gauche institutionnelle.
Vous remarquerez que je ne vous répond directement pas sur Berlinguer parce que je ne connais absolument pas cet homme ni son oeuvre. Cependant, je pense que l’appel à l’austérité (comme celui de Tolstoï, Gandhi, Illitch…) est beaucoup plus valable aujourd’hui, qu’à l’époque, où le développement industriel n’était encore qu’au stade infantile.
Par ailleurs, dans votre second paragraphe, vous semblez faire comme si les syndicats n’avaient pas changé depuis l’anarcho-syndicalisme. C’est tout le problème que je soulève dans cette discussion : la gauche, les acteurs traditionnels de la gauche, ont changé profondément, en mal, au court du XXè siècle, au point d’être devenu les ennemis du mouvement social. Cela m’étonne de devoir le rappeler face à un amateur de Michéa dont la critique de la gauche est tout le travail depuis quelques années.
« quand est-ce que ces partis et syndicats appelleront à la décroissance ? », demandes-tu.
Ma réponse: quand ils ne t’intimideront plus et que tu seras décidé à t’en emparer et à les investir afin de t’en servir pour faire connaître ta condition sociale. Pas avec la détestable déférence que tu me supposes pour « ces vieilles dames corrompues »…chez lesquelles, si vieilles dames il y avait, il ne s’agirait alors certes pas d’aller prendre le thé, mais bien plutôt d’aller leur poser un couteau sous la gorge pour qu’elle te donne enfin les clefs du coffre à bijoux.
C’est pour moi ce qu’il faudrait faire, ça ne se fait pas, je sais, et quelquefois j’enrage contre un intello qui bavasse trop complaisamment sur internet sans faire réagir le gars ou la fille qui tient le micro. D’un côté, cette apolitisme qu’on retrouve partout me fout en panique. Mais d’un certain côté, je me fous bien de ta haine de la gauche, puisque tu continues à ignorer ta propre force politique. Puisque tu ne fais (par idéalisme) que retourner cette haine contre toi-même, et jamais contre les classes qui te spolient, ni contre la société qui te condamne à réorganiser ta survie et celle des tiens au quotidien, dans des conditions toujours plus hostiles.
Mais est-ce que tu te rends compte au passage à quel point la stratégie de division des classes populaires entre elles par « ces saloperies de cadres politique et d’intellectuels médiatiques » (comme tu regroupes justement parfois!) fonctionne extrêmement bien?
Tu vas maintenant cultiver ton bout de jardin avec tes voisins et organiser des centrales d’achat pour ton bois de chauffage. Bravo! Qui t’en blâmerait? Mais au nom de quelle lutte passée, présente ou future blâmes-tu l’égoïsme des classes moyennes – c’est-à-dire sous ton clavier: la « classe » des fonctionnaires, des retraités, des cdistes? Leur égoïsme serait-il différent du tien par nature? C’est peut-être oublier ce que la radicalité de ton état d’esprit doit à tes difficultés individuelles, non? A moins que tu ne sois, toi aussi, un « self-made-man »?
Au reste, fonctionnaires, retraités et cdistes sont tous dans le collimateur du pouvoir libéral, et tu peux dès à présent les considérer comme des espèces menacées. Les plus intrépides d’entre eux viendront tôt ou tard biner avec toi et tes amis.
Je conchie la société de consommation quasiment depuis l’éveil de ma conscience politique. Je l’ai refusée jusqu’à me passer (un temps!) d’eau courante et d’électricité dans mon quotidien. J’ai biné, moi aussi. Mais, te lisant sur la décroissance, je retrouve ce qui m’avait choqué chez Latouche et en définitive, ce qui me sépare de votre tour de pensée. C’est encore et toujours le même ressentiment, celui qu’on retrouve un peu partout dans les marges politisées.
Par exemple, je me contrefous que Lordon critique Michéa – qui est assez grand pour lui répondre. Ce que je sais, c’est que j’ai besoin de Michéa ET de Friot pour avancer dans ma réflexion. Mais le journal La Décroissance? Je regrette que tu balaies d’un revers de main la question sur Berlinguer. Appuyer l’austérité avec le PCI quand le PCI est à 30%, ça fait sens et espoir. Mais appuyer l’austérité quarante ans plus tard, quand elle est le fer de lance des politiques les plus réactionnaires et les plus dures au faible…Vraiment, ça ne te pose pas question? J’aurais mauvaise grâce à insister. C’est vrai que tout n’est peut-être pas mauvais dans ce canard.
Ne pas oublier l’enjeu de la redéfinition des cadres institutionnels : http://www.congres-afsp.fr/st/st26.html