- La démocratie disciplinée par la dette, Benjamin Lemoine, La Découverte, 2022 [1]
- Le dernier Messie, Peter Wessel Zapffe, Allia, 2023 [2]
- Macario, B. Traven, Libertalia, 2018 [3]
- À l’école du soir, Carole Christen, Champ Vallon, 2023 [4]
- Mon nom est rouge, Orhan Pamuk, Gallimard, 2001 [5]
La rente contre l’humain et l’intérêt général [1]
 À écouter certains hommes politiques, on pourrait croire qu’il est toujours possible de mener des politiques keynesiennes de relance, dans l’objectif de réindustrialiser la France et de favoriser son autonomie, de la rendre résistante aux problématiques écologiques sévères qui nous attendent. Or, ça c’était avant. L’après-guerre où l’État maîtrisait le financement de sa politique, et donc des choix politiques eux-mêmes n’était qu’une parenthèse.
À écouter certains hommes politiques, on pourrait croire qu’il est toujours possible de mener des politiques keynesiennes de relance, dans l’objectif de réindustrialiser la France et de favoriser son autonomie, de la rendre résistante aux problématiques écologiques sévères qui nous attendent. Or, ça c’était avant. L’après-guerre où l’État maîtrisait le financement de sa politique, et donc des choix politiques eux-mêmes n’était qu’une parenthèse.
Au XIXe siècle, Marx parlait déjà des détenteurs des dettes d’État comme d’« actionnaires de l’État ». Or, depuis la fin des années 1960-70, cette métaphore est redevenue une réalité. Par exemple, le storytelling du ratio « Dette/PIB » qui n’a en réalité pas grand sens – on compare un stock à un flux – mis sur pause pendant le Covid, se poursuit, et en corrélation, le tarissement des financements des assurances sociales et des services publics comme la santé pour lesquels on entretient la dette pour les mettre en risque.
Le financement actuel de l’État est indirect et passe désormais par l’intermédiaire des banques privées puis l’émissions de titres de dettes que l’on appelle obligations, revendus ensuite à des « investisseurs ». Les pudiquement appelés « investisseurs » raffolent de ces titres car ils sont considérés comme des « actifs » sûrs et « liquides » (facilement vendables) et facilitent la spéculation sur les marchés financiers, car elles servent de garantie en cas d’opérations risquées. Il s’agit, à proprement parler, d’une rente à vie sur le dos des finances publiques et de la population générale.
Les problèmes arrivent quand il s’agit de garantir cette sureté. Pour prendre un exemple, faire des déficits pour financer des investissements publics (et non des aides aux entreprises / exemptions de cotisations, qui sont des subventions qui creusent les dettes sans contrôle de la destination des fonds) pourraient diminuer cette confiance nécessaire.
Il ne faut donc pas que cela arrive : les gouvernements qui maintiennent le dogme néolibéral sont adoubés, ceux qui voudraient faire autrement sont neutralisés par tous les moyens avant les élections, et s’ils parviennent quand même à être élus, sanctionnés par la finance, comme la Grèce lors de l’élection de Syriza.
Dans ces conditions, la démocratie est soumise aux désidératas des « investisseurs » et des marchés financiers. Afin d’appuyer l’éducation des politiques et des populations, de nouveau acteurs sont apparus publiquement comme les agences de notation, qui sortira la règle pour taper sur les récalcitrants, et provoquera une augmentation des taux d’intérêt pour rendre d’autres politiques bien plus coûteuses.
Cette « discipline » de la démocratie, on a pu s’en rendre compte à plusieurs reprises. Lors de la loi « El Khomri » sous Hollande, lors des Gilets Jaunes ou des manifestations et contre l’opinion publique lors de la réforme des retraites sous Macron, les gouvernants n’ont rien lâché. Au début du Covid, il paraissait même indispensable à un certain Édouard Philippe de passer la réforme malgré l’urgence sanitaire. Le Covid a précisément marqué une pause. Le « quoi qu’il en coûte », indispensable pour éviter l’effondrement de l’économie, a rendu le déficit effrayant, et le storytelling sur le ratio dette/PIB non présentable. Il a donc été décidé de mettre cette dette de côté pour pouvoir la repeindre.
Mais les financiers n’ont pas renoncé à avancer leurs pions. Des fonds d’investissement comme BlackRock voudraient que les banques centrales lèvent l’impôt, les assurances sociales – dont certains acteurs financiers reconnaissent qu’ils apportent une meilleure qualité de vie – doivent être achevées pour faire de chaque individu, même à faible revenu et donc sans pouvoir sur le cours des choses, un petit épargnant.
Si les gouvernements néolibéraux donnent satisfaction dans le cantonnement des revendications sociales, la pérennisation de la rente et des marchés financiers spéculatifs restent une obsession. Cela nous renvoie à l’actualité : quoi de mieux qu’un gouvernement autoritaire – fusse-t-il à tendance raciste – pour pouvoir s’en assurer pour de bon ?
Un faux-pas tragique de l’évolution [2]
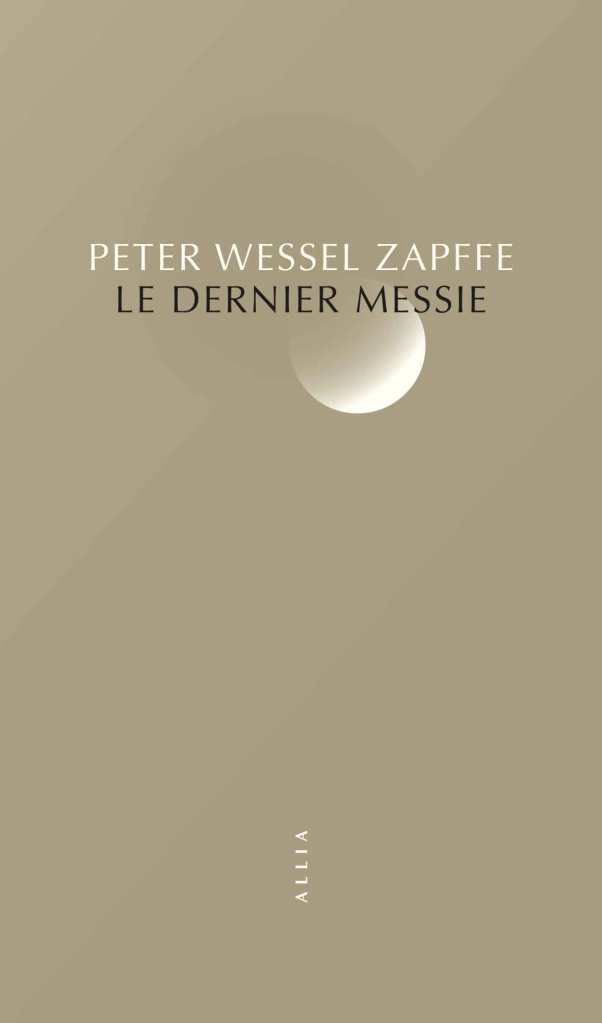 Peter Wessel Zapffe (1899-1990) était un écrivain, philosophe, alpiniste et artiste norvégien. Auteur de peu d’ouvrages, il reste célèbre pour sa thèse portant sur la notion de tragique (Sur le tragique, 1941) et surtout pour Le dernier Messie (1933). Pessimiste et anti-nataliste, ce dernier voyait dans Homo Sapiens Sapiens une erreur de la Nature vouée à canaliser son angoisse par le biais d’illusions et de divertissements jusqu’à l’instant fatidique. Dans Le dernier Messie (Allia, 2023), le philosophe analyse ce qu’il nomme la « panique cosmique » à laquelle l’Homme est condamné et annonce l’avènement d’un sauveur venu délivrer à jamais l’humanité de ses tourments.
Peter Wessel Zapffe (1899-1990) était un écrivain, philosophe, alpiniste et artiste norvégien. Auteur de peu d’ouvrages, il reste célèbre pour sa thèse portant sur la notion de tragique (Sur le tragique, 1941) et surtout pour Le dernier Messie (1933). Pessimiste et anti-nataliste, ce dernier voyait dans Homo Sapiens Sapiens une erreur de la Nature vouée à canaliser son angoisse par le biais d’illusions et de divertissements jusqu’à l’instant fatidique. Dans Le dernier Messie (Allia, 2023), le philosophe analyse ce qu’il nomme la « panique cosmique » à laquelle l’Homme est condamné et annonce l’avènement d’un sauveur venu délivrer à jamais l’humanité de ses tourments.
D’emblée, l’auteur procède à une généalogie rapide du rapport qu’entretient l’Homme avec le Monde : d’abord anthropocentrique, notre rapport au Tout était jadis enfantin, nous pensions la Nature comme faite à notre mesure. Cependant, les développements prodigieux de la science moderne nous ont fait perdre l’idée que nous étions le centre de l’Univers et cela a abîmé notre rapport au religieux. Condamné à l’insignifiance cosmique, l’Homme tombe dans le matérialisme et le nihilisme.
De plus, le malheur de notre condition réside pour Zapffe dans ce qu’il nomme « l’excédent de conscience » : devenus trop éveillés, nous sommes condamnés à conjurer ce que l’auteur nomme la « panique cosmique ». Effrayés par les espaces infinis dont parlait Pascal, nous nous efforçons de donner du sens à une aventure qui fondamentalement n’en a aucun. Par le biais de la distraction, de la sublimation, du refoulement, de l’isolement, de l’appartenance à une communauté, nous créons des ancrages familiers dans un Univers glacial, infini, et indifférent à notre existence.
Enfin, l’écrivain alpiniste termine son essai par l’annonce d’une mauvaise nouvelle, ce que Nietzsche nommait « dysangile » : contrairement au Christ venu pour sauver les hommes de la mort, le dernier Messie proclame l’absurdité totale de la vie humaine et encourage la nulliparité, c’est-à-dire l’absence de reproduction de l’espèce humaine.
Sombre et original, Le dernier Messie est un des ouvrages majeurs du courant philosophique pessimiste et anti-nataliste. En 2014, il est remis au goût du jour par le co-réalisateur de True Detective Nic Pizzolatto qui le cite comme une influence majeure. Au moment où la crise écologique questionne la condition humaine en tant que telle, il est intéressant de s’interroger pour savoir si la conscience humaine est ou n’est pas, comme l’affirme le détective Rust Cohle, « un faux-pas tragique de l’évolution » (« a tragic misstep in evolution »).
L’injuste destinée d’un bûcheron mexicain [3]
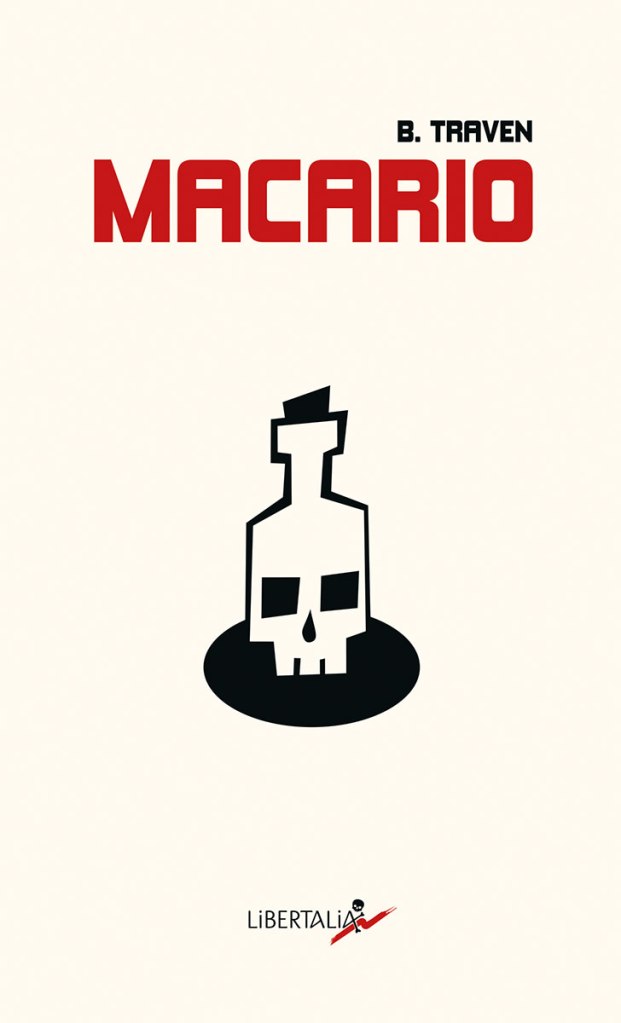 L’expérience quotidienne de la faim, un travail éreintant et une culpabilité permanente de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille : telle est la vie de Macario, petit bûcheron des hauteurs mexicaines. Ironiquement, mais de manière pas si absurde, Macario n’a qu’un seul rêve pour ensoleiller cette vie : manger un jour une dinde rôtie, pour lui seul. Il sait pourtant que ce rêve est totalement inaccessible à un homme de sa condition. C’est alors que, de manière assez similaire au roman de Tolstoï Ce qu’il faut de terre à l’Homme, Macario va successivement rencontrer en forêt Dieu, le Diable et la Faucheuse, qui vont chacun mettre à l’épreuve sa charité et son caractère. Il en ressort avec l’amitié de la Faucheuse, qui lui confère un pouvoir magique de guérisseur presque absolu : de quoi assurer durablement sa fortune. Il reste néanmoins entendu que Macario ne pourra « voler » à la Faucheuse aucun malade : il devra nécessairement lui remettre les patients qu’elle exigera.
L’expérience quotidienne de la faim, un travail éreintant et une culpabilité permanente de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille : telle est la vie de Macario, petit bûcheron des hauteurs mexicaines. Ironiquement, mais de manière pas si absurde, Macario n’a qu’un seul rêve pour ensoleiller cette vie : manger un jour une dinde rôtie, pour lui seul. Il sait pourtant que ce rêve est totalement inaccessible à un homme de sa condition. C’est alors que, de manière assez similaire au roman de Tolstoï Ce qu’il faut de terre à l’Homme, Macario va successivement rencontrer en forêt Dieu, le Diable et la Faucheuse, qui vont chacun mettre à l’épreuve sa charité et son caractère. Il en ressort avec l’amitié de la Faucheuse, qui lui confère un pouvoir magique de guérisseur presque absolu : de quoi assurer durablement sa fortune. Il reste néanmoins entendu que Macario ne pourra « voler » à la Faucheuse aucun malade : il devra nécessairement lui remettre les patients qu’elle exigera.
Les exploits du guérisseur Macario deviennent rapidement célèbres dans la région, puis à travers le pays. Devenu riche, une tension se fait jour en lui : même si lui et sa famille mènent désormais grand train et côtoient le grand monde, Macario n’a pas totalement oublié ses origines, et ne soigne pas les pauvres au même prix que les riches. Mais un jour, le fils du vice-roi tombe gravement malade : Macario est naturellement convoqué à son chevet, et reçoit l’ordre de guérir l’enfant, sous peine de mort s’il échoue. Or, la Faucheuse s’oppose à sa guérison… L’ancien bûcheron pourra-t-il trouver une issue à ce piège qui semble se refermer sur lui ? La Faucheuse savait-elle tout depuis le début ?
Macario, originellement publié en 1950, est l’un des romans phares de l’auteur libertaire allemand B. Traven (1882-1969). Exilé au Mexique durant une partie de sa vie, Traven jongla avec moult pseudonymes et identités, au cours d’une vie aussi mystérieuse qu’engagée. Traven dessine, dans ce roman tout comme dans d’autres nouvelles plus légères (par exemple Le gros capitaliste), un portrait humainement coloré mais socialement révoltant de la vie des classes laborieuses mexicaines. Une partie de son œuvre est actuellement republiée chez Libertalia, en bénéficiant d’un nouveau travail de traduction. Notons aussi que Macario a connu une adaptation cinématographique, certes assez librement inspirée du roman, mais encore considérée de nos jours comme l’un des plus grands films mexicains.
Entre émancipation et contrôle politique [4]
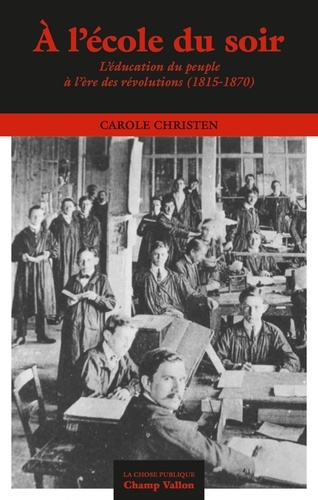 Peu d’ouvrages d’histoire sociale et de l’éducation s’étaient jusqu’à présent attardés sur les écoles du soir françaises. L’historienne Carole Christen nous gratifie ici d’un ouvrage pionnier, déjà de référence, sur cette thématique, en adoptant une définition extensive des « cours du soir ». En effet, l’autrice choisit de définir « l’école du soir » comme l’ensemble des cours, quels que soient leurs contenus (savoirs élémentaires, techniques, scientifiques ou de culture générale), dispensés en dehors des horaires de travail, le plus souvent le soir. Entre les années 1830 et 1870, cette nébuleuse éducative aurait concerné entre 30 000 et 829 000 élèves par an.
Peu d’ouvrages d’histoire sociale et de l’éducation s’étaient jusqu’à présent attardés sur les écoles du soir françaises. L’historienne Carole Christen nous gratifie ici d’un ouvrage pionnier, déjà de référence, sur cette thématique, en adoptant une définition extensive des « cours du soir ». En effet, l’autrice choisit de définir « l’école du soir » comme l’ensemble des cours, quels que soient leurs contenus (savoirs élémentaires, techniques, scientifiques ou de culture générale), dispensés en dehors des horaires de travail, le plus souvent le soir. Entre les années 1830 et 1870, cette nébuleuse éducative aurait concerné entre 30 000 et 829 000 élèves par an.
En prenant pour bornes chronologiques 1815-1870, période débutant avec les premières expériences de cours du soir impulsées par des philanthropes libéraux, et s’achevant dans les années 1870, au point culminant de l’organisation de ces cours, Carole Christen retrace une chronologie du développement de ces expériences parascolaires. Elle met en évidence un développement non linéaire, fragmenté en plusieurs phases. D’abord est présentée la période 1815-1848, marquée par les premières expériences, imprégnées d’idées libérales dans la continuité des Lumières, et portées par des hommes tels que Charles Dupin. Ces réformateurs voyaient dans l’accès au savoir des catégories populaires un moyen de les sortir de l’obscurantisme et, plus concrètement, de faire accéder les masses populaires à une plus grande autonomie économique – des motivations non sans empreintes de paternalisme. Ensuite, une attention particulière est portée au début de la Seconde République, entre février et juin 1848, période éphémère mais marquée par une tentative gouvernementale d’encourager les écoles du soir pour former une classe ouvrière mieux armée intellectuellement. C’est aussi une période d’instrumentalisation de ces cours du soir, à des fins de diffusion de valeurs républicaines et socialistes, valorisant la dignité et le savoir-faire ouvriers. Après une période de repli des écoles du soir à la suite de la loi Falloux de 1850, dans un contexte de réaction politique post-révolutionnaire, les écoles du soir reprennent leur développement surtout à partir des années 1860, en contrepoint de la libéralisation du Second Empire. Durant cette phase, le pouvoir cherche à diffuser et généraliser les cours du soir pour répondre aux nouveaux besoins industriels du pays, nécessitant une main-d’œuvre plus nombreuse et mieux formée, notamment dans le domaine de la mécanique.
Pour comprendre les formes et motivations de ces enseignements, l’autrice articule parfaitement l’analyse politique de ces expériences, insistant sur les arrière-plans idéologiques, et l’analyse sociale de terrain, pour comprendre les pratiques et le cadre de ces cours du soir. L’autrice mobilise également les outils de l’histoire du genre pour comprendre les disparités entre hommes et femmes dans ces cours du soir, ces dernières ne représentant à peine plus de 15 % des élèves en 1872 (malgré une croissance de cette proportion). Elle aborde les préjugés sexistes véhiculés par les cours du soir – à l’ère des discours sur « l’homme gagne-pain » et « la femme au foyer » – ainsi que l’offre de cours faiblement diverse proposée aux femmes. L’éducation devant ici reproduire la division sexuée du travail. En contrepoint du discours sur l’émancipation ouvrière, les cours du soir peuvent dès lors refléter des conceptions et préjugés genrés, qui enferment les femmes dans des carcans domestiques ou à des tâches professionnelles restreintes au secteur du textile notamment.
En somme, À l’école du soir propose un éclairage inédit sur une thématique longtemps négligée et pourtant d’actualité. De nos jours, s’observe de plus en plus un attrait du public pour ces cours du soir, animés par des acteurs divers issus notamment du monde associatif et artistique. Ce phénomène répond ici à une envie profonde de la société de cultiver de nouveaux savoirs, en complément d’expériences professionnelles quotidiennes souvent désenchantées et vides de sens. Plus largement, ce détour par l’histoire est ici fondamental pour comprendre le potentiel éducatif et normatif de l’éducation, et la capacité des institutions éducatives, formelles ou informelles, à imposer avec force des normes culturelles et politiques, même à des publics adultes. Par voie de conséquence, cela permet de prendre conscience de l’effet d’inertie de nombreux préjugés qui trouvent leurs origines dans l’histoire des institutions éducatives, et ainsi déconstruire certains réflexes parfois profondément enracinés.
Les intrigues d’Istanbul [5]
 Paru en 2001, Mon nom est Rouge (Benim Adım Kırmızı) est l’une des grandes œuvres du romancier turc Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature en 2006. Roman polyphonique, intégrant l’histoire dans la grande Histoire et jouant avec les règles de la fiction, l’écrivain turc interroge le tiraillement de celles et ceux qui se trouvent entre deux continents, deux rives.
Paru en 2001, Mon nom est Rouge (Benim Adım Kırmızı) est l’une des grandes œuvres du romancier turc Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature en 2006. Roman polyphonique, intégrant l’histoire dans la grande Histoire et jouant avec les règles de la fiction, l’écrivain turc interroge le tiraillement de celles et ceux qui se trouvent entre deux continents, deux rives.
Plongé dans l’Istanbul de la fin du XVIe siècle, avec en arrière-fond l’Empire Ottoman aux prises avec les Européens et les Safavides, ce roman raconte l’assassinat de l’un des miniaturistes du Sultan. Au fil des pages, lentement mais sûrement, on découvre une intrigue amoureuse derrière le grand récit de la complexe relation entre Orient et Occident.
Orhan Pamuk offre un roman intelligent et drôle tout en projetant le lecteur dans une période captivante de la civilisation ottomane, avec une réflexion érudite sur la place de l’art et de la liberté de création dans le monde musulman. La bigoterie, l’extrémisme et le rejet de l’autre, que ce soit entre les deux rives ou même parmi les Orientaux, évoquent inévitablement notre époque contemporaine.
Nos Desserts :
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Notre sélection littéraire des années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014
- Et notre revue papier (quatre numéros parus) à commander en ligne
Catégories :Shots et pop-corns
