Le Comptoir : Vous critiquez la « prolifération des luttes » causée par la reprise à gauche et à l’extrême gauche de la pensée déconstructiviste, notamment de Derrida et Foucault. La seule lutte de classes peut-elle résoudre les problèmes de racisme, de xénophobie ou de sexisme ? Ces dernières luttes sont-elles nécessairement illégitimes ?
 Renaud Garcia : Mon propos ne consiste surtout pas à minorer l’importance et la nécessité des luttes contre le racisme, la xénophobie, le sexisme ou les discriminations envers les homosexuels, les trans ou les intersexes. Mon ancrage philosophique et politique n’est pas marxiste, ou du moins pas marxiste “orthodoxe”, c’est-à-dire centré quasi exclusivement sur la question de l’exploitation économique et le conflit entre le Capital et le Travail. Il est clairement anarchiste. Or, l’un des grands mérites de la pensée anarchiste dans les vingt dernières années est d’avoir intégré ces luttes-là au combat toujours pertinent contre l’exploitation économique. Pour ce faire, elle a largement puisé dans le répertoire conceptuel d’auteurs comme Foucault, Deleuze ou Derrida, ainsi que dans le modèle de l’hégémonie socialiste proposé par des “post-marxistes” comme Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Tous ces penseurs ont bien montré qu’une société sans classes n’abolissait pas nécessairement du même pas les dominations de genre, de sexe ou de race.
Renaud Garcia : Mon propos ne consiste surtout pas à minorer l’importance et la nécessité des luttes contre le racisme, la xénophobie, le sexisme ou les discriminations envers les homosexuels, les trans ou les intersexes. Mon ancrage philosophique et politique n’est pas marxiste, ou du moins pas marxiste “orthodoxe”, c’est-à-dire centré quasi exclusivement sur la question de l’exploitation économique et le conflit entre le Capital et le Travail. Il est clairement anarchiste. Or, l’un des grands mérites de la pensée anarchiste dans les vingt dernières années est d’avoir intégré ces luttes-là au combat toujours pertinent contre l’exploitation économique. Pour ce faire, elle a largement puisé dans le répertoire conceptuel d’auteurs comme Foucault, Deleuze ou Derrida, ainsi que dans le modèle de l’hégémonie socialiste proposé par des “post-marxistes” comme Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Tous ces penseurs ont bien montré qu’une société sans classes n’abolissait pas nécessairement du même pas les dominations de genre, de sexe ou de race.
« Le problème du livre consiste à établir le seuil à partir duquel la critique de la domination se change en suspicion généralisée à l’égard d’un pouvoir conçu comme essentiellement normalisateur. »
On ne saurait donc leur donner tort sur ce point, et c’est même leur grandeur que d’avoir élargi le champ des luttes sociale et politique. Le problème du livre consiste plutôt à établir le seuil à partir duquel la critique de la domination – terme qui désigne désormais les diverses manières qu’a le pouvoir de nous traverser, en de multiples points – se change en suspicion généralisée à l’égard d’un pouvoir conçu comme essentiellement normalisateur – et non plus vraiment, ou principalement, répressif. Déterminer ce seuil ne correspond à rien d’autre qu’à la vieille tâche critique (de krinein, qui signifie “distinguer” ou encore “discriminer”) assignée par Kant à la philosophie.
C’est cela, le propos central du livre. Et c’est ainsi que j’en arrive au constat qu’une bonne partie de cette critique de la domination, passé un certain seuil dans la représentation de l’action du pouvoir et de la manière de s’en défaire, ne peut que tourner à vide autour de questions identitaires extrêmement particulières. C’est ici que le rapport au collectif commence à poser problème, et que l’analyse en termes de classes tombe définitivement en désuétude.
À première vue, l’intersectionnalité [ii] semble être le concept adéquat pour intégrer les luttes “minoritaires” à la lutte de classes. Mais selon vous, il est simplement utilisé pour « assurer une extension du champ des luttes possibles, dans un mouvement toujours davantage inclusif ». Qu’entendez-vous par-là ?
Je serais tout à fait d’accord avec vous pour retenir l’intérêt de concept, tel qu’il a été promu par Kimberlé Crenshaw, une juriste afro-américaine qui s’est intéressée aux violences subies par les femmes noires dans les quartiers pauvres. Il s’agit bien de considérer que les dominations ne nous sont pas extérieures mais nous traversent, ce qui implique une vigilance critique à l’égard de la domination que nous pourrions reproduire sans pour autant en être tout à fait conscients. On imagine bien à ce propos l’exemple d’hommes militants prêchant pour l’égalité économique, l’antiracisme ou la parité hommes/femmes, mais laissant dans la sphère domestique leurs compagnes prendre en charge les tâches de soin à l’égard de leurs enfants. Si la notion d’intersectionnalité, en se situant au plus près de ce qui passe en nous en fait de domination, peut servir à révéler ces impensés, elle est évidemment utile.
 Si rien d’autre ne compte dans la représentation que je me fais de mes limitations hormis les multiples coupes verticales qui me traversent, et si je me refuse à les rassembler sous une bannière commune, alors quid du combat social ? Supposons par exemple une femme, bretonne, âgée et handicapée. Selon le cadre de pensée de l’intersectionnalité, elle se situe à la croisée d’au moins trois dominations : celle qui nie sa singularité régionale ; celle qui nie sa capacité à bien vivre malgré sa vieillesse (on appellera cela, dans les milieux militants, de l’âgisme) ; celle qui lui refuse une vie bonne en fonction de son handicap (une nouvelle domination : le validisme). Au plus près d’elle-même, cette femme-là est dominée selon des lignes différentes. Or, au-delà de ceci, il s’agit d’une femme. Mais si jamais elle s’avisait de lutter sous la bannière des “femmes”, les “féministes” queer (on saisit pourquoi j’utilise des guillemets) pourraient rétorquer qu’elle se reterritorialiserait (pour paraphraser Deleuze et Guattari) sur une essence, adoptant donc le discours du pouvoir dominant. Il s’agit là d’un héritage de la pensée de Judith Butler diluée dans des milieux comme le “féminisme” queer. Si on l’entend dans le cadre de cette relation symétrique, le concept d’intersectionnalité me semble peu porteur.
Si rien d’autre ne compte dans la représentation que je me fais de mes limitations hormis les multiples coupes verticales qui me traversent, et si je me refuse à les rassembler sous une bannière commune, alors quid du combat social ? Supposons par exemple une femme, bretonne, âgée et handicapée. Selon le cadre de pensée de l’intersectionnalité, elle se situe à la croisée d’au moins trois dominations : celle qui nie sa singularité régionale ; celle qui nie sa capacité à bien vivre malgré sa vieillesse (on appellera cela, dans les milieux militants, de l’âgisme) ; celle qui lui refuse une vie bonne en fonction de son handicap (une nouvelle domination : le validisme). Au plus près d’elle-même, cette femme-là est dominée selon des lignes différentes. Or, au-delà de ceci, il s’agit d’une femme. Mais si jamais elle s’avisait de lutter sous la bannière des “femmes”, les “féministes” queer (on saisit pourquoi j’utilise des guillemets) pourraient rétorquer qu’elle se reterritorialiserait (pour paraphraser Deleuze et Guattari) sur une essence, adoptant donc le discours du pouvoir dominant. Il s’agit là d’un héritage de la pensée de Judith Butler diluée dans des milieux comme le “féminisme” queer. Si on l’entend dans le cadre de cette relation symétrique, le concept d’intersectionnalité me semble peu porteur.
En ce sens, le concept d’intersectionnalité tel qu’il fonctionne aujourd’hui me paraît symptomatique d’une politique de la singularité qui finit par s’effectuer dans un vide social. C’est d’ailleurs une des principales critiques que Christine Delphy, éminente représentante du féminisme de la deuxième vague (période MLF), adresse au féminisme “post-moderne”.
Dans son recueil posthume dédié à la question féministe, Les femmes et la vie ordinaire (Climats, 1997), Christopher Lasch estimait que bien que les hommes et les femmes ne soient toujours pas égaux, le patriarcat en Occident avait « presque disparu » et ajoutait qu’un « féminisme digne de ce nom aurait dû remettre en question l’idéologie de la croissance économique et de la productivité, ainsi que le carriérisme qu’elle engendre ». De son côté, Geneviève Fraisse dans Les Excès du genre (Lignes, 2014) explique que l’égalité politique et civique est acquise et que, pour tenter de combattre les inégalités économiques qui persistent, les féministes s’attaquent sans succès aux images et aux stéréotypes. Le féminisme échoue-t-il par manque de radicalité anticapitaliste ?
La question portant sur “le” féminisme, il n’est guère aisé d’y répondre sans risquer de commettre des erreurs. Il y a évidemment trop de nuances et de tendances. Dans le livre, je m’en tiens essentiellement au clivage conceptuel et politique entre féminisme “matérialiste”des années 1960-1970 et féminisme de la subversion des identités de genre hérité du Trouble dans le genre de Judith Butler (La Découverte, 2006 pour la traduction française), ainsi que des travaux de Teresa De Lauretis. Ma préférence va au premier, précisément parce qu’il a le potentiel de produire en termes de critiques et pratiques anticapitalistes.
 L’argument de Lasch est un peu différent. Il considère que la prétendue division des tâches entre la femme à la maison et le mari au travail est une construction récente, datant du XIXe siècle, au moment où l’on conçoit la famille comme un “refuge dans un monde cruel” – celui des affaires –, dont la femme-mère serait la gardienne. Cette construction sociale ne réduit en rien, selon lui, ce que les femmes faisaient réellement en dehors de la sphère domestique à cette époque-là. Elles étaient insérées dans tout un réseau d’économie et de pratiques vernaculaires et informelles, qui prenait corps et place dans la vie publique. Elles ont ainsi largement œuvré à démocratiser l’accès à la culture, à rendre la ville habitable, à créer une culture civique. Mais, bien évidemment, ce travail n’entrait pas dans les calculs de l’économie standard.
L’argument de Lasch est un peu différent. Il considère que la prétendue division des tâches entre la femme à la maison et le mari au travail est une construction récente, datant du XIXe siècle, au moment où l’on conçoit la famille comme un “refuge dans un monde cruel” – celui des affaires –, dont la femme-mère serait la gardienne. Cette construction sociale ne réduit en rien, selon lui, ce que les femmes faisaient réellement en dehors de la sphère domestique à cette époque-là. Elles étaient insérées dans tout un réseau d’économie et de pratiques vernaculaires et informelles, qui prenait corps et place dans la vie publique. Elles ont ainsi largement œuvré à démocratiser l’accès à la culture, à rendre la ville habitable, à créer une culture civique. Mais, bien évidemment, ce travail n’entrait pas dans les calculs de l’économie standard.
Or, à partir du moment où l’extension des échanges marchands à des sphères jusque-là extérieures à sa rationalité, comme les activités vernaculaires, se généralise (notamment sous l’effet de l’urbanisme détruisant les quartiers populaires), la place des femmes dans les réseaux informels d’entraide n’a plus de sens. Selon Lasch, c’est le développement des banlieues dans les années 1940-1950 qui fait entrer l’histoire des femmes dans une nouvelle ère. Organisée autour du centre commercial, la vie dans les suburbs implique la promesse de ne rendre de comptes à personne. D’où un phénomène de privatisation et de repli dans la sphère domestique. La femme est une ménagère qui s’occupe des enfants, le mari travaille en ville et se déplace. Cette situation entraînera de nouvelles campagnes pour libérer les femmes, et les faire rejoindre le monde du travail.
Ici, Lasch s’appuie sur l’anarchiste américain Paul Goodman et son best-seller sur le désœuvrement de la jeunesse américaine, Growing Up Absurd (1960), dans lequel il se livrait à une critique féroce de la transformation des métiers en emplois et de l’aliénation qu’ils engendrent nécessairement (un thème décroissant avant la lettre). Pour Lasch, l’analyse de Goodman de la corruption du monde du travail indique que la femme ne gagne pas grand-chose à embrasser une carrière professionnelle afin de parvenir à l’égalité économique avec les hommes, car, que l’on soit homme ou femme, un bon travail est un travail utile, dont la valeur ne se mesure pas par le salaire perçu ou le fait de gravir des échelons.
« Les féministes ont effectivement manqué de radicalité en voulant dépasser une division sexuelle du travail assimilée à tort à un modèle prétendument éternel de la famille traditionnelle (…) [mais] “le” féminisme, dans sa très grande généralité, est assez souvent loin de pécher par manque de radicalité anticapitaliste. »
Autrement dit, les féministes ont effectivement manqué de radicalité en voulant dépasser une division sexuelle du travail assimilée à tort à un modèle prétendument éternel de la famille traditionnelle. Elles n’ont pas vu que cette division avait été causée par le déclin de la culture civique. Elles ont incité les femmes à entrer dans des carrières, se soumettant de fait à l’éthos de l’économie capitaliste.
Bien que Lasch utilise Paul Goodman – pour qui on peut dire sans crainte de se tromper que l’analyse de la place des femmes constitue un vrai angle mort – sa critique me paraît comme toujours à la fois très éclairante et éminemment dialectique. Ceci étant dit, je n’ai rien utilisé de tel dans mon livre. Le féminisme dont je parle – principalement le “féminisme” queer – ne me semble vraiment pas avoir pour axe principal de redonner aux femmes une place reconnue et égale à celle des hommes dans le monde du travail. Peut-être une telle revendication est-elle plus adaptée à une Clémentine Autain.
 Le féminisme que j’évoque travaille par contre au déplacement des normes et à un effort de dés-identification permanent. Cela passe par une stratégie de prolifération des identités de genre et une exploration subversive de la sexualité. En clair, ce que Marie-Hélène Bourcier, dans son langage toujours très rock’n’ roll, appelle le “gender fucking”. Si c’est l’équivalent de ce que Geneviève Fraisse nomme “excès du genre”, je suis assez d’accord, bien qu’il s’agisse plutôt pour moi, en l’espèce, d’un manque de la part de la critique des identités de genre. La subversion se recentre sur soi-même, sur l’agency et l’empowerment des sujets, termes devenus désormais monnaie courante dans les cercles militants et qui risquent toujours de dégénérer en tentatives frénétiques pour regagner de l’“estime de soi”.
Le féminisme que j’évoque travaille par contre au déplacement des normes et à un effort de dés-identification permanent. Cela passe par une stratégie de prolifération des identités de genre et une exploration subversive de la sexualité. En clair, ce que Marie-Hélène Bourcier, dans son langage toujours très rock’n’ roll, appelle le “gender fucking”. Si c’est l’équivalent de ce que Geneviève Fraisse nomme “excès du genre”, je suis assez d’accord, bien qu’il s’agisse plutôt pour moi, en l’espèce, d’un manque de la part de la critique des identités de genre. La subversion se recentre sur soi-même, sur l’agency et l’empowerment des sujets, termes devenus désormais monnaie courante dans les cercles militants et qui risquent toujours de dégénérer en tentatives frénétiques pour regagner de l’“estime de soi”.
C’est pour cela que des féministes comme Colette Guillaumin, Nicole Claude-Mathieu ou encore Monique Rouillé-Boireau se désolent des effets de cette apologie de la déconstruction des identités de genre comme dernier mot la subversion. Elles, à mes yeux, ne manquent pas du tout de radicalité anticapitaliste.
Et puis, il faudrait aussi mentionner le courant de l’écoféminisme, qui a justement la particularité de mêler les revendications féministes à la question sociale, économique et urbaine de la disparition des savoirs et pratiques vernaculaires sous l’effet du développement capitaliste (ce qui ressemblerait en la convergence que Lasch appelait de ses vœux). On ne peut manquer ici de citer Vandana Shiva, malgré les réserves que j’aurais personnellement à l’égard de toute tentative d’établir un lien spirituel entre les femmes et la Terre-mère, comme s’il existait une sorte de mystique féminine multi-séculaire qui les introniserait gardiennes de la Terre.
Par conséquent, “le” féminisme, dans sa très grande généralité, est assez souvent loin de pécher par manque de radicalité anticapitaliste.
Vous affirmez que l’héritage des Lumières est la première victime des déconstructivistes, qui ont abandonné l’universalisme au nom du relativisme. Le relativisme n’est-il pas plutôt né avec la modernité ?
 On pourrait avancer que le relativisme est une position aussi vieille que la philosophie (voir les sophistes, les sceptiques pyrrhoniens). Si on peut s’accorder pour dire que Montaigne est un précurseur des Lumières, il n’en reste pas moins que ses thèses relativistes datent du XVIe siècle ! La position du relativisme comme corrélat à la “modernité” pourrait donc être largement nuancée.
On pourrait avancer que le relativisme est une position aussi vieille que la philosophie (voir les sophistes, les sceptiques pyrrhoniens). Si on peut s’accorder pour dire que Montaigne est un précurseur des Lumières, il n’en reste pas moins que ses thèses relativistes datent du XVIe siècle ! La position du relativisme comme corrélat à la “modernité” pourrait donc être largement nuancée.
Cependant, il n’est pas gênant de poser que le relativisme est né avec la modernité dans la mesure où cette attitude philosophique est susceptible de revêtir plusieurs formes. S’il s’agit, en effet, de dire que le discours sur la réalité est toujours situé dans un espace spatio-temporel, qu’il évolue au fil des recherches, ou encore, comme le montre l’anthropologie culturelle, qu’il existe une multiplicité de visions du monde, alors il me semble que ceci est encore un effet des Lumières : on lutte à chaque fois contre l’absolutisation, autrement dit le principe d’autorité.
Exemple intéressant. Auguste Comte, fondateur du positivisme, dont la visée consiste d’abord à lutter contre les spéculations métaphysiques inhérentes à la question “pourquoi ?”, et que l’on a bien trop souvent accusé de tous les maux de la pensée – à tort, me semble-t-il – défend une forme de relativisme : « La loi générale du mouvement fondamental de l’humanité consiste […] en ce que nos théories tendent de plus en plus à représenter exactement les sujets extérieurs de nos constantes investigations, sans que néanmoins la vraie constitution de chacun d’eux puisse, en aucun cas, être pleinement appréciée, la perfection scientifique devant se borner à approcher cette limite idéale autant que l’exigent nos divers besoins réels. » Discours sur l’esprit positif, 1842.
« L’exigence de vérité n’a donc rien à voir avec une quelconque domination par l’appel à un absolu. Elle rend plutôt possible la liberté. »
Ainsi, le relativisme, sainement conduit, peut prendre la forme d’une disposition sceptique qui signale la volonté de douter, tout en visant la vérité comme un horizon. C’est la raison pour laquelle je me réfère souvent dans le livre à Bertrand Russell, qui a toujours été prêt à reconnaître la contingence dans la recherche de la vérité, la nécessité de réviser potentiellement nos croyances sur la réalité, sans jamais jeter pour autant le bébé avec l’eau du bain.
Selon moi, ce n’est pas ce qui se passe avec certains relativistes comme Richard Rorty ou Paul Feyerabend, des philosophes qui se sont taillé une belle réputation dans les milieux de gauche critique en défendant un constructivisme de la connaissance. Selon eux, en effet, il n’existe aucun critère surplombant ou absolu permettant de trancher entre deux visions du monde concurrentes. Si, néanmoins, on s’y essaie en invoquant la vérité comme critère objectif, on tente en réalité de masquer assez misérablement un rapport de force orienté en notre faveur. Ainsi, pour Feyerabend, la science occidentale a dominé par une sorte d’impérialisme les autres modes de savoir (mythe, magie, etc.) en posant a priori l’universalité de ses méthodes et de ses résultats. Dans les milieux militants, ce genre d’argumentaire nous vaut des déclarations anarchistes comme celle-ci : « Toute action de la science est, objectivement, de la violence symbolique dans la mesure où elle est l’imposition d’une culture arbitraire par un pouvoir arbitraire », issue de Sal Restivo dans « Science, sociology of science and the anarchist tradition » (The Raven, été 1994). Ou encore comme celle-là : « La forme déductive de la science exprime la hiérarchie et la coercition » de John Zerzan dans Aux sources de l’aliénation (Insomniaque, 1999). Ici, on confond la prétention à l’universel, le postulat que chaque être humain puisse s’accorder sur une certaine vision de la réalité, avec l’absolutisation et son inévitable cortège de violences.
 Or, si la vérité n’est plus une exigence à tenir, mais l’alibi de purs rapports de forces, il deviendra alors difficile de rendre compte de la formation des idées scientifiques. Si 2+2 = 4 (pour reprendre le robuste exemple du socialiste George Orwell dans 1984) n’a rien à voir avec une quelconque objectivité, ou si dire qu’il pleut n’a rien à voir avec le fait qu’il pleut, mais résulte simplement d’une croyance personnelle utile à celui qui y croit – et donc de ce fait seulement tenue pour vraie, alors le champ est libre pour tous les apprentis O’Brien, experts en manipulation mentale et autres oppressions.
Or, si la vérité n’est plus une exigence à tenir, mais l’alibi de purs rapports de forces, il deviendra alors difficile de rendre compte de la formation des idées scientifiques. Si 2+2 = 4 (pour reprendre le robuste exemple du socialiste George Orwell dans 1984) n’a rien à voir avec une quelconque objectivité, ou si dire qu’il pleut n’a rien à voir avec le fait qu’il pleut, mais résulte simplement d’une croyance personnelle utile à celui qui y croit – et donc de ce fait seulement tenue pour vraie, alors le champ est libre pour tous les apprentis O’Brien, experts en manipulation mentale et autres oppressions.
Il me semble que les Lumières ont justement légué le souci de l’enquête rationnelle, une tournure d’esprit sceptique, la recherche d’éléments de preuves qui favorisent la communication des idées et le partage des résultats. C’est cela, présupposer la dimension universelle des discours : considérer que si on suit des règles méthodiques et prudentes, on parviendra à des résultats partageables. L’exigence de vérité n’a donc rien à voir ici avec une quelconque domination par l’appel à un absolu. Elle rend plutôt possible la liberté.
De ce point de vue, le mouvement anarchiste a largement emprunté au répertoire conceptuel des Lumières, en y puisant une bonne part de son tempérament politique anti-autoritaire. Je souscrirais intégralement à ce que Chomsky dit de la science en tant qu’activité intellectuelle, et je le rapprocherais du type de comportement qu’implique l’anarchisme : « La science est hésitation, exploration, questionnement […]. La plupart des recherches de pointe sont des entreprises dans lesquelles les chercheurs et les étudiants sont sommés d’apporter de nouvelles idées, de remettre en question, voire de saper ce qu’on leur a enseigné ou qu’ils ont lu. » (Chomsky, « Le vrai visage de la critique post-moderne », Agone n° 18-19, 1998).
Vous expliquez que l’anarchisme se présente comme « une radicalisation de la dimension politique du projet des Lumières ». Les Lumières et leur rationalisme ne sont-elles pas pourtant à l’origine de l’utilitarisme et de l’individualisme ? Ne croyez-vous pas, comme Jean-Claude Michéa, que le projet des Lumières mène au « triomphe absolu du capitalisme » ?
Le problème qui s’est posé à l’anarchisme – selon la généalogie qu’en dresse cet incontournable intellectuel et militant que fut Rudolf Rocker – fut de concilier l’héritage politique des Lumières avec leur versant économique appliqué, autrement dit avec la figure de l’Homo economicus, rejeton de la science de la richesse des nations. C’était impossible. Ce qui implique que le socialisme anarchiste s’est constitué d’une manière “transversale” à la pensée des Lumières.
On retrouve ici, vous y faites référence, un des grands apports des essais de J.-C. Michéa. Je souscris à l’idée selon laquelle les Lumières sont aussi le berceau de l’utilitarisme et de l’“axiomatique de l’intérêt”, bien que les moralistes du XVIIe siècle aient une part non négligeable dans la formation de ce modèle explicatif des conduites humaines. Je comprends, par ailleurs, sa thèse de la “logique philosophique”, selon laquelle un train en cache toujours un autre dans l’histoire, de sorte qu’une idée initialement développée selon certaines intentions finit par se réaliser en bout de course sous des formes qui auraient paru monstrueuses à ses promoteurs, mais j’ai toujours eu du mal à en voir la portée effective. Elle me paraît un peu trop hégélienne, péchant peut-être par idéalisme au sens philosophique du mot. Pour Hegel, l’idée rejoint son concept au bout de l’histoire. En ce sens, la “pensée-Macron” serait donc, en quelque sorte, la vérité d’Adam Smith rendue à elle-même. Mais c’est un point marginal.
Ce qui ne l’est pas, par contre, c’est que vous omettez de signaler dans votre question l’autre aspect des analyses de Michéa : le fait qu’il se réfère systématiquement aux idéaux d’émancipation, de liberté, d’égalité et de rationalité critique précisément issus des Lumières. Ce qui est par ailleurs utile pour le soustraire d’un côté aux récupérations par une extrême droite (ou une “nouvelle droite”) engagée sous la bannière de l’antilibéralisme, mais pas forcément hostile à la hiérarchie quand vient l’heure des solutions sociales et politiques et, d’un autre côté, aux critiques tendancieuses adressées depuis la gauche à ses penchants prétendument “réactionnaires”.
Mon ouvrage s’inscrit également dans cette lecture dialectique des Lumières. En ce sens, comme pour Michéa, il ne s’agit au fond que de réactiver le geste inaugural d’Horkheimer et Adorno [iii].
« Imagine-t-on aujourd’hui un employé modeste sortir de son travail et venir participer à une conférence populaire sur la politique d’Aristote ? »
Selon vous, les intellectuels de gauche sont les premiers responsables de la fracture entre leur camp politique et le peuple. N’est-ce pas leur accorder trop d’importance et minorer le rôle de l’effondrement du bloc soviétique, la conversion à l’économie de marché du Parti socialiste et la disparition du Parti communiste comme parti de masse ?
De quoi parle-t-on lorsqu’on mentionne une fracture entre le “peuple” et “son camp politique” ? Et d’abord, “où trouvez-vous le peuple”, interrogent les biens nés de la pensée dès qu’on utilise ce terme.
Pour en avoir une idée, on pourrait se demander combien d’ouvriers, de paysans, de femmes de ménage ou personnes de basse extraction se sont rendus depuis 2002 à l’université “populaire” de Caen pour écouter Michel Onfray. Loin de moi l’idée de remettre en cause l’initiative d’Onfray, mais malgré ce dont il pourrait se targuer, je ne suis pas certain qu’il y en ait eu autant qu’au début du XXe siècle dans les cercles d’éducation populaire chers à Fernand Pelloutier, où les ouvriers se voyaient dispenser des leçons sur toutes sortes de sujets pointus à la suite de leurs huit ou dix heures de travail, lisaient quantité de livres et cherchaient, malgré leurs limites à l’écrit, à rédiger textes et journaux. Imagine-t-on aujourd’hui un employé modeste sortir de son travail et venir participer à une conférence populaire sur la politique d’Aristote ?
Alors, vous avez certainement raison : l’apathie, le conformisme, la puissance des dérivatifs médiatiques, l’abrutissement télévisuel, l’addiction chronophage à la technologie peuvent tout aussi bien rendre compte de la démobilisation du peuple. Bref, il serait sans doute vain de tenter de trouver en ces matières un “déterminant en dernière instance”, et il serait encore plus unilatéral de l’imputer aux seuls intellectuels de gauche. Le modèle d’une convergence de facteurs serait plus approprié.
Néanmoins, sans aller jusqu’à reformuler une théorie gramscienne de l’hégémonie culturelle, il me semble qu’on ne peut nier l’influence de la classe intellectuelle (philosophes et écrivains, presse, membres des think tanks) dans la justification idéologique du système qui lui assure ses prébendes.
 S’il est vrai que les gens peuvent tomber dans l’apathie pour de multiples raisons, il faut bien dire que ce qu’on leur propose ordinairement comme digne d’intérêt pour la gauche est bien peu mobilisateur. Je pense aux éditoriaux de Laurent Joffrin, aux pages culture de Libération remplies des délires libertariens et transhumanistes de Marcela Iacub ou Paul Preciado, ou encore aux tribunes d’Édouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie invitant à occuper le plus possible les médias sérieux tout en se réservant le droit de ne pas débattre avec ceux qu’on considère comme des “réactionnaires”.
S’il est vrai que les gens peuvent tomber dans l’apathie pour de multiples raisons, il faut bien dire que ce qu’on leur propose ordinairement comme digne d’intérêt pour la gauche est bien peu mobilisateur. Je pense aux éditoriaux de Laurent Joffrin, aux pages culture de Libération remplies des délires libertariens et transhumanistes de Marcela Iacub ou Paul Preciado, ou encore aux tribunes d’Édouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie invitant à occuper le plus possible les médias sérieux tout en se réservant le droit de ne pas débattre avec ceux qu’on considère comme des “réactionnaires”.
Et il ne s’agit pas non plus d’ignorer le rôle de passeurs joué par de nombreux intellectuels formés à l’école de la déconstruction auprès des instances du PS. Dernier exemple en date, le travail de Fabienne Brugère, spécialiste de Judith Butler. Dans La politique de l’individu, elle souligne l’apport des études de genre pour la reconnaissance des femmes en tant qu’« individus-sujets » méritant des soutiens spécifiques contre toute « neutralisation de l’espace public » qui perpétue les rapports de pouvoir existants. Les soutiens spécifiques que les études de genre appellent de leurs vœux prennent corps dans le care par exemple, cette nouvelle politique de la vulnérabilité. Ce recentrage sur la figure de l’individu à soutenir par les institutions du care signe le passage du sujet aliéné au sujet vulnérable. L’inflexion est de taille, car le sujet aliéné, c’est le sujet des classes sociales. Le sujet vulnérable, c’est plutôt l’individu dans une société libérale. Pas étonnant, dans ces conditions, de constater que Mme Brugère est membre du Labo, le think tank de Martine Aubry. Mais on pourrait en dire autant d’un Guillaume le Blanc ou d’un Éric Fassin, entre autres.

La CNT anarcho-syndicaliste mise en scène par Ken Loach dans Land and Freedom
Historiquement, le socialisme s’est reposé sur les partis ou sur les syndicats pour renverser l’ordre établi. Aujourd’hui les deux types de structures semblent avoir fait faillite, pour diverses raisons. Dans ces conditions, comment peut naître une alliance des classes populaires contre le capitalisme et quelle forme pourrait prendre ce combat ?
C’est évidemment la grande question, qui mobilise une bonne part du livre, au moment de chercher des leviers critiques pour fédérer des luttes communes. Comment articuler des luttes autour de critères communs, dans un contexte militant de singularisation toujours plus poussée ?
Pour ma part, j’essaie de reprendre pied sur une théorie de l’aliénation autour du thème de la vie humiliée ou empêchée. D’où la nécessité de relire et repenser des auteurs comme Marcuse, Debord, Henri Lefebvre ou Günther Anders, et de se tourner vers le fonds commun de l’anarchisme. On sait à quel point le capitalisme parvient à se couler dans la pulsation vitale qui soutient l’existence de chacun, pour nous rendre en quelque sorte “toxico-dépendants”, comme le dit Serge Latouche. C’est pourquoi le schéma de la réappropriation d’une nature humaine qui aurait été expropriée ou spoliée risque d’être insuffisant. Il n’y a pas que de la lourdeur ou de l’encombrement dans notre rapport aux objets du capitalisme (passer simplement devant un magasin Apple le démontre). Par contre, que le capitalisme sache concilier les puissances de la vie ne signifie pas qu’il en épouse les conditions optimales d’expression. Ici, toute la littérature sur la souffrance au travail, le développement des pathologies sociales, la prise en charge médicale, l’effondrement des capacités de logique et de concentration, l’isolement urbain, témoigne que toute attaque à l’encontre de notre corps vécu et de son milieu associé est d’emblée une attaque contre notre nature. Cette dernière resurgit ici en creux, par la négative (c’est ce que Paul Goodman notait déjà en 1960 au début de Growing Up Absurd).
« Je pense que les gens sont conscients qu’en vivant de plus en plus vite, dans un contexte qui s’apparente souvent à une lutte métaphorique pour la survie, ils paient leur adrénaline d’un épuisement chronique et d’un rapport seulement velléitaire à l’existence. »
Voilà qui nous permettrait de sortir des seules questions identitaires rattachées à la subversion des normes pour prendre en charge des questions comme l’urbanisme, l’alimentation, la virtualisation du réel ou l’éducation, qui mettent en jeu le corps dans son monde et ce qu’il peut ou non en faire. Je pense que les gens sont conscients qu’en vivant de plus en plus vite, dans un contexte qui s’apparente souvent à une lutte métaphorique pour la survie (ce qu’on pourrait appeler le syndrome Koh-Lanta, et que Christopher Lasch avait très bien vu dans Le moi assiégé), ils paient leur adrénaline d’un épuisement chronique et d’un rapport seulement velléitaire à l’existence.
Dans son dernier film, Je lutte donc je suis, le réalisateur et activiste franco-grec Yannis Youlountas met en avant la convergence entre l’économie informelle (“urbanoculteurs”, expérimentateurs de monnaies sociales, résistants à la destruction de quartiers) et les résistances paysannes qui essaiment en divers endroits, en Grèce et en Espagne notamment. Dans les deux cas, on remet au centre les pratiques vernaculaires, la maîtrise de la production, la recherche de l’équilibre entre la satisfaction des besoins et le travail requis, et la nécessité d’un milieu de vie harmonieux et pérenne soutenu par l’amitié, incitant par ailleurs aux pratiques artistiques. On voit ce qu’une telle alliance a déjà pu donner en Amérique latine en termes de résistances au capitalisme. Elle est appelée à se développer davantage, en résorbant le clivage entre ville et campagne, que le marxisme n’a pas su dépasser.
Pour le reste, je serais assez d’accord avec certains arguments de Frédéric Lordon dans son livre Imperium. Il s’agit bel et bien de fédérer au moyen d’“affects communs”, qui puissent être aussi déterminants que la pomme d’Apple ou le génie visionnaire de Steve Jobs, fêté désormais comme le dernier héros de l’humanité. Nous avons effectivement un grand travail à effectuer là-dessus. L’événement “Charlie” a montré, certes d’une manière troublante, que ce n’était pas impossible.
La question écologique est devenue centrale dans la lutte contre le capitalisme. Or, comme le relève le journal La Décroissance dans son numéro du mois d’octobre [iv], l’écologie n’est pas une priorité pour les classes populaires. Comment allier lutte de classes et combat écologique ?
Si l’on parle du “populaire” au sens de Christopher Lasch dans son article Culture de masse ou culture populaire, où “populaire” signifie pratiquement “vernaculaire”, non marchand, fondé sur des réseaux informels d’entraide à l’échelon local, alors les classes populaires de tous les pays (et notamment ceux du sud) font naturellement de l’écologie. On peut consulter à ce propos l’ouvrage classique de Martinez Alier sur L’écologie des pauvres.
« Une classe dépendante matériellement des gaz à effet de serre ne peut donc voir d’un très bon œil le combat écologiste. »
Dans l’article de Fabrice Flipo que vous mentionnez, l’auteur aborde la question des classes populaires en fonction des tranches de revenus. Il en résulte que lorsque les plus riches ont effectivement les moyens de se payer des produits de qualité (pour faire schématique, issus de l’agriculture bio), les plus pauvres (les classes populaires, qui ont pourtant l’impression toute subjective d’appartenir à la classe moyenne) doivent se contenter d’un ersatz. Or, comme l’ersatz est industriel, il est inévitablement plus polluant. Une classe dépendante matériellement des gaz à effet de serre ne peut donc voir d’un très bon œil le combat écologiste.
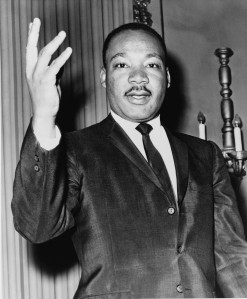 Il faut ici se rappeler d’une grande leçon de politique, qu’évoque James C. Scott dans son Petit éloge de l’anarchisme : la nécessité de s’adresser aux masses en trouvant la “note juste”. Il prend l’exemple de Martin Luther King qui savait trouver des résonances dans son auditoire, le capter, et le cultiver ensuite pour susciter ses aspirations. Le charisme, dit Scott, est une harmonie à deux voix. C’est aussi ce que fait Marcos avec les zapatistes : cultiver une écoute attentive, et commander en obéissant. Cela nécessite donc de ne pas se couper des classes populaires, et de ne pas se retrancher dans la tour d’ivoire des systèmes intellectuels.
Il faut ici se rappeler d’une grande leçon de politique, qu’évoque James C. Scott dans son Petit éloge de l’anarchisme : la nécessité de s’adresser aux masses en trouvant la “note juste”. Il prend l’exemple de Martin Luther King qui savait trouver des résonances dans son auditoire, le capter, et le cultiver ensuite pour susciter ses aspirations. Le charisme, dit Scott, est une harmonie à deux voix. C’est aussi ce que fait Marcos avec les zapatistes : cultiver une écoute attentive, et commander en obéissant. Cela nécessite donc de ne pas se couper des classes populaires, et de ne pas se retrancher dans la tour d’ivoire des systèmes intellectuels.
Si le terme de “décroissance”, par exemple, est considéré par ses promoteurs comme un mot-obus servant à briser un consensus confinant à la religion officielle, il n’est pas impossible, du point de vue d’une recherche de la “note juste”, qu’il peine à éveiller des résonances dans l’auditoire visé. C’est la même chose pour l’“objection de croissance”. Sans parler, dans un tout autre style, des appels grotesques à tout faire pour “sauver la planète”, enjeu bien évidemment tellement surdimensionné qu’il n’a aucune chance d’éveiller le moindre affect.
« Malgré toutes les ressources de la raison, on ne peut réellement contrer une affection que par une autre affection. »
Dans l’article mentionné, F. Flipo évoque l’“enjeu de la qualité”. À mon sens, c’est bien vu. On doit pouvoir faire appel à la dilection de l’être humain pour le savoureux, au refus du mensonge, à son sens esthétique (thèmes chers à William Morris, ce grand critique de l’“âge de l’ersatz”), à sa recherche d’une “vie bonne”. On peut le faire en partant de questions tout à fait pratiques comme l’alimentation ou la cuisine. Par exemple, l’art culinaire est devenu un sujet omniprésent à la télévision mais il est lié pratiquement tout le temps à des affects adéquats au capitalisme : valorisation de la performance, goût du risque, compétition, enjeu carriériste. Or, la cuisine devrait être plutôt un creuset d’affects socialistes, comme la convivialité, l’éducation au goût, la simplicité, le soin apporté au corps. On peut donc en parler et la promouvoir en mettant en évidence des affects joyeux, seuls capables de contrebalancer réellement d’autres affects, et de là remonter vers les problématiques de l’écologie radicale. C’est la grande leçon de Hume : malgré toutes les ressources de la raison, on ne peut réellement contrer une affection que par une autre affection.
En fin d’ouvrage, vous évoquez la nécessité de retrouver le sens des limites. On se souvient que pour Platon, la cité ne devait pas compter plus de 5 040 membres. Nos sociétés auraient-elles dépassé la taille critique ? Croyez-vous, comme Murray Bookchin, à un retour aux petites communautés autogérées ?
 Je serais pour ma part très précautionneux à l’égard de l’expression “retour à”, sans plus de précision. Elle ouvre en effet le champ à tous les policiers de la pensée ou grands frères un peu condescendants (à l’instar de Frédéric Lordon à l’égard des anarchistes) qui s’empressent de confondre “retour en arrière” et “impitoyable régression”. Du reste, Bookchin ne prône pas un “retour” aux petites communautés autogérées, mais plutôt une refonte, une reprise dans le cadre de son municipalisme libertaire. Gardons en tête ces distinctions, pour insister toujours sur le rapport dialectique au passé, que Bookchin entretient d’ailleurs.
Je serais pour ma part très précautionneux à l’égard de l’expression “retour à”, sans plus de précision. Elle ouvre en effet le champ à tous les policiers de la pensée ou grands frères un peu condescendants (à l’instar de Frédéric Lordon à l’égard des anarchistes) qui s’empressent de confondre “retour en arrière” et “impitoyable régression”. Du reste, Bookchin ne prône pas un “retour” aux petites communautés autogérées, mais plutôt une refonte, une reprise dans le cadre de son municipalisme libertaire. Gardons en tête ces distinctions, pour insister toujours sur le rapport dialectique au passé, que Bookchin entretient d’ailleurs.
Vous citez Platon, mais je me réfèrerais plutôt à Aristote, qui considérait que la polis ne devait pas atteindre une taille telle que, de ses remparts, on ne puisse entendre un appel à l’aide. Bookchin part de là dans son ouvrage Une société à refaire.
» Le modèle fédéraliste constitué d’une imbrication de conseils sur plusieurs niveaux me paraît la solution la plus porteuse aujourd’hui. »
À vrai dire, les modèles politiques viables ne sont pas légion. On peut considérer que la démocratie représentative est une faillite totale. La démocratie référendaire serait peut-être possible aujourd’hui avec les moyens de communication, mais elle exigerait une activité à plein temps pour s’informer, relier les informations, etc. Par ailleurs, le référendum n’expose pas suffisamment à la discussion et au perfectionnement réciproque des points de vue. En dehors d’une solution autoritaire du type prise du palais d’Hiver, et d’une solution foucaldo-nietzschéenne consistant pour chacun à sculpter sa propre statue en ménageant des affinités électives, il ne reste guère que deux options, appelées aujourd’hui à refaire surface en même temps que l’anarchisme : le modèle fédéraliste et les communautés autonomes à la façon des milieux libres du début du XXe siècle. Le modèle des communautés autonomes pose assez vite des problèmes liés à la taille, justement. Par exemple, comment une communauté autonome fait-elle pour déterminer son niveau de pollution ? Ou encore, comment déterminer une dimension qui garantira à la fois la participation de tous et l’accomplissement de réels objectifs sociaux ?
C’est pour cette raison, d’autre part, que le modèle fédéraliste constitué d’une imbrication de conseils sur plusieurs niveaux me paraît la solution la plus porteuse aujourd’hui. Ici, la pensée anarchiste des dernières décennies, parfois décevante en termes de propositions politiques, ne nous laisse pas sans perspective. Un modèle politique et économique est en effet débattu depuis une vingtaine d’années maintenant, et il a été expérimenté notamment en Argentine lors de la crise des années 2000 : le modèle participaliste développé par Michael Albert et Robin Hahnel, et discuté autour du site Zcommunications. Ce modèle économique fondé sur une planification délibérative entre conseils de producteurs et conseils de consommateurs, et dont l’organisation du travail présente des principes tout à fait intéressants comme la rotation des activités au sein d’ensembles équilibrés de tâches, a été complété par un modèle politique, présenté par Stephen Shalom, intitulé « parpolity ».
Shalom reprend en réalité le principe des Soviets, qui a été expérimenté également par la République des conseils de Bavière, entre novembre 1918 et avril 1919. Il suppose 25 à 50 personnes, les adultes d’une communauté donnée, qui délibèrent au niveau le plus local pour déléguer ensuite à l’échelon supérieur un représentant justiciable d’être démis de sa responsabilité si l’on estime qu’il n’a pas assez bien reflété les décisions du premier niveau. Si l’on calcule, on constate qu’avec un conseil de 25 membres, et en supposant que la moitié de la population est adulte, il faut cinq niveaux pour couvrir une société de 19 millions de personnes.
« Il incombe aux intellectuels de répandre parmi le peuple les armes de l’auto-défense intellectuelle, au lieu de se repaître de concepts sophistiqués ou de petites phrases tapageuses. »
Bien évidemment, ce système ne peut s’avérer efficace qu’à l’aide de nombreux garde-fous, d’un ensemble clair de règles endogènes qui permettent de prendre les décisions appropriées à l’échelon qui convient, tout en maintenant le contrôle ultime par la base. Tout cela sans compter la place à laisser aux pouvoirs judiciaire et exécutif. Cette proposition a néanmoins l’immense mérite d’ouvrir le questionnement et d’inciter à l’action, au lieu de fermer des horizons. Je renvoie sur ce point à la lecture de l’excellent ouvrage de Pascal Lebrun, seule présentation critique d’envergure disponible en français à propos de ce modèle. Il s’agit de L’économie participaliste. Une alternative contemporaine au capitalisme, aux éditions Lux.
Nul doute enfin qu’une taille limitée des unités politiques et un enchâssement fédératif recommandent un sens civique, une qualité d’argumentation, d’écoute et de débat tels qu’il faudrait refondre en grande partie les systèmes d’éducation, afin de produire les citoyens adéquats pour de telles institutions. C’est ici que les intellectuels ont une responsabilité importante. Il leur incombe de répandre parmi le peuple les armes de l’auto-défense intellectuelle, au lieu de se repaître de concepts sophistiqués ou de petites phrases tapageuses. Pour le reste, il convient de conserver l’espérance d’Aristote qui estimait dans Les politiques (livre III, chapitre 11) qu’une fois placés ensemble, des citoyens pas spécialement vertueux pourraient compenser leurs défauts réciproques, de sorte qu’un jugement politiquement plus pertinent pourrait sortir de leur délibération, là où le jugement de quelques-uns considérés comme les meilleurs présenterait une moins grande acuité.
Il s’agit peut-être d’un acte de foi, mais pour revenir à l’anarchisme, son histoire nous a souvent montré comment ce que l’être humain avait de meilleur pouvait se révéler une fois les contextes institutionnels appropriés mis en place. En l’espèce, l’échec de ces expérimentations politiques a surtout coïncidé avec un écrasement violent par les pouvoirs établis. Du point de vue de ces derniers, une des pires choses reste bien que les gens sortent de leur fatigue et s’efforcent de prendre leurs affaires en main.
Nos Desserts :
- Pour chopper Le désert de la critique près de chez vous
- Interview de Renaud Garcia sur Hors-Série
- « Peut-on critiquer Foucault ? » sur le site de la revue Ballast
- Pour fédérer autour du commun, Alain Caillé sur le convivialisme pour Le Comptoir
- Sur le féminisme contemporain, l’avis très éclairant de Marie-Jo Bonnet
Notes :
[i] Renaud Garcia a consacré son mémoire de master à Christopher Lasch et a également rédigé le chapitre qui lui est dédié (« Christopher Lasch – Le culte du narcissisme ») dans Radicalité – 20 penseurs vraiment critiques (L’Échappée, 2014).
Sa thèse fut consacrée à Pierre Kropotkine. Il a aussi publié l’an dernier Pierre Kropotkine ou l’économie par l’entraide (Le passager clandestin, collection Les Précurseurs de la décroissance dirigée par Serge Latouche, 2014) et cette année La Nature de l’entraide (ENS éditions, 2015), d’après le titre d’un ouvrage du Russe.
Enfin, concernant Léon Tolstoï, Renaud Garcia est l’auteur de Léon Tolstoï contre la volonté de toute puissance, aux éditions du Passager clandestin, collection Les Précurseurs de la décroissance, 2013.
[ii] L’intersectionnalité est un concept utilisé en sociologie et en science politique — principalement dans les pays anglo-saxons sous le terme intersectionality. Elle désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société comme les femmes noires ou encore les ouvriers homosexuels.
[iii] Référence à l’ouvrage des deux piliers de l’école de Francfort, Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, intitulé Dialektik der Aufklärung (Dialectique de la raison en français) et publié en 1944. Dans ce livre, les deux marxistes procèdent à une analyse dialectique des Lumières (“Aufklärung”, traduit par les éditeurs français par “raison”, car le terme “Lumières” ne doit pas être entendu comme uniquement la pensée issue du XVIIIe siècle, mais comme un processus civilisationnel plus large), afin d’en comprendre les effets positifs et négatifs.
[iv] « Écologie et climat : l’enjeu des classes populaires », Fabrice Flipo, La Décroissance n°123, octobre 2015.
Catégories :Politique

Pour poursuivre la réflexion, un article de Renaud Garcia sur le dernier livre de Frédéric Lordon dans http://cqfd-journal.org/Lordon-s-Calling
Je n’ai rien compris à cette curieuse énumération de références. Une contribution entre initiés ? À chaque fois qu’on risquait une référence au concret, on repartait pour un tour via une référence nouvelle a un penseur émérite et inconnu.
Le pb de l’anarchisme contemporain est simplement une soumission au marxisme. Il en découle que les réflexions se fondent donc sur de faux concepts et leurs conséquences régressives (dont le néo-pétainisme de Michéa qui fait illusion auprès des gogos pour cette raison – voir pour ça: http://www.exergue.com/h/2014-04/tt/michea-mysteres-gauche.html)
Tout cela rappelle les tentatives de Luc Ferry de réarmement idéologique du néo libéralisme. C’est un peu daté, ça plaît même au figaro, normal aucun outil conceptuel de compréhension ou de lutte.
C’est vrai qu’avec Castoriadis, Illich, Ellul, Lasch, Kropotkine, Tolstoï, Debord on n’a ni outil conceptuel de compréhension ou de lutte. Lisez-le au lieu de l’amalgamer bêtement à Ferry !