- Le nihilisme, textes choisis par Vladimir Biaggi, GF Flammarion, 2013 [1]
- J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond, Alexis Jenni, Paulsen, 2022 [2]
- Le Chant des Asturies, Alfonso Zapico, Futuropolis, 2023 [3]
- Une belle grève de femmes, Anne Crignon, Libertalia, 2023 [4]
- Tuer n’est pas assassiner, Edward Sexby, Allia, 2024 [5]
- Brasero n°3, revue de contre-histoire, L’Échappée, 2023 [6]
Je te tiens là, nihiliste ! [1]
 Les Éditions Flammarion sont à l’origine d’une série de corpus en Philosophie. Art, Politique, Éthique, il est toujours sain de revenir sur certains lieux communs afin de comprendre leur évolution au travers du temps. Dans Le Nihilisme, l’écrivain Vladimir Biaggi dissèque un concept employé à tort et à travers qui fit couler beaucoup d’encre à travers les siècles.
Les Éditions Flammarion sont à l’origine d’une série de corpus en Philosophie. Art, Politique, Éthique, il est toujours sain de revenir sur certains lieux communs afin de comprendre leur évolution au travers du temps. Dans Le Nihilisme, l’écrivain Vladimir Biaggi dissèque un concept employé à tort et à travers qui fit couler beaucoup d’encre à travers les siècles.
En 1761, le professeur de rhétorique Crevier s’attaque à ceux qui prétendent que Jésus-Christ, « en tant qu’homme, n’est pas quelque chose », c’est-à-dire « rien ». Si cet homme de lettres n’a pas traversé les âges, on ne peut en dire autant de son néologisme « nihiliste ».
Très en vogue au XIXe, ce terme sert à qualifier un mouvement politique russe scientiste qui s’oppose à toute forme d’autorité, tout en méprisant les arts. Tourgueniev, auteur remarqué de Pères et Fils (1862), dépeint les débats enflammés entre un homme de l’ancien temps attaché à la religion orthodoxe et Bazarov, jeune nihiliste arrogant, pour qui la Nature n’est pas un temple mais « un atelier ».
Si le XIXe est connu pour son matérialisme borné, pour qui « un cordonnier est plus utile à la société qu’un poète » (Pissarev), c’est aussi la vacuité bouddhiste qui conquiert les esprits occidentaux. Ainsi, Maupassant se fait le disciple du nihilisme schopenhauerien : le monde est souffrance, et il aurait mieux fallu que nous ne naissions pas. Disciple du philosophe allemand, Friedrich Nietzsche établit quant à lui une distinction entre un nihilisme passif lénifiant et un nihilisme actif aristocratique : s’il est bon de détruire les valeurs de l’ancien monde, le philosophe-artiste doit en créer de nouvelles.
Enfin, le XXe et ses atrocités voit advenir une perte de sens généralisée : Albert Camus qualifie l’existence humaine d’ « absurde » en raison de l’inadéquation absolue entre les aspirations profondes de l’Homme et ce qu’est réellement l’Univers. Dans une veine plus frivole, les dandys Cioran et Roland Jaccard préconisent d’habiter le monde en exaltant les bagatelles inutiles d’une vie qui s’apparente à un minuscule tunnel entre deux néants.
Dense et fouillé, le corpus sur le nihilisme a la force d’esquisser une généalogie passionnante d’un signifiant de plus en plus galvaudé. Dégoût de la vie, rejet de l’autorité, ou encore absence de sens, ce dernier recouvre un ensemble de significations éparses. Au moment où la grisaille s’abat sur les pays européens, comprendre ce que recèle le nihilisme revient paradoxalement à jeter une lumière sur notre temps.
Écologie admirative [2]
 Alors qu’il est de bon ton aujourd’hui chez l’homo reactus de droite ou de gauche de conspuer l”écologie punitive” qui serait, à l’en croire, l’idéologie dominante du moment (si seulement !), la vie et l’œuvre de John Muir (1838-1914) offrent un magnifique exemple de ce que peut être une écologie admirative.
Alors qu’il est de bon ton aujourd’hui chez l’homo reactus de droite ou de gauche de conspuer l”écologie punitive” qui serait, à l’en croire, l’idéologie dominante du moment (si seulement !), la vie et l’œuvre de John Muir (1838-1914) offrent un magnifique exemple de ce que peut être une écologie admirative.
Et c’est d’ailleurs un bel exercice d’admiration que nous donne ici Alexis Jenni, dans cette biographie subjective où il met les pieds dans les pas de son héros, ou plutôt de celui qui fut le premier héraut de la nature sauvage, la fameuse (et controversée) wilderness américaine. Car John Muir est un des pères fondateurs, et même des Pilgrim Fathers, des “pères pèlerins” de l’écologie moderne, aussi bien scientifique que politique, discutable certainement, mais incontournable, infatigable pèlerin et incomparable frère prêcheur de la nature, c’est-à-dire dans la nature mais aussi pour la nature, monstre sacré qui se révèle ici humain, très humain, et que l‘on suit ici, pas à pas, au plus près de cette intimité ouverte à tout ce qui est sensible, de plein air et qui réjouit et restaure l’âme : « Chacun d’entre nous a besoin de beauté comme de pain, de places pour jouer et de lieux de prière, d’endroits où la nature puisse le guérir et se réjouir, et le fortifier dans son corps et son âme. »
John Muir, à l’origine des premiers parcs naturels des États-Unis et du monde, et plus largement du mouvement de préservation de la nature, est ainsi aussi bien un des précurseurs des droits de la nature que du droit à la nature, qui ont pris, ces dernières années et décennies, une tournure politique radicale, comme le résume le fameux slogan : « Nous sommes la nature qui se défend. » Rappelant ainsi que si les écologistes de tout poil se battent contre ce monde destructeur, capitaliste, industriel, inégalitaire, c’est parce qu’il se battent pour un monde à la fois écologique et démocratique, un monde beau et juste à la fois, autant que faire se peut. La wilderness bien entendue n’est que la traduction sauvage de la decency.
Voilà qui montre encore que si l’écologie “négative” est généralement d’extrace anthropocentrique, centrée sur l’humanité, ses peurs et ses angoisses, l’écologie “positive”, celle des origines, naît avant tout d’un sentiment d’émerveillement devant la beauté et la bonté de la nature, du cosmos, du monde, et de l’homme réconcilié avec le monde.
Falk Van Gaver
Pré-histoire de la guerre d’Espagne [3]
 La guerre d’Espagne fait l’objet de multiples publications historiques et elle a été largement appropriée, tant par la littérature, que par le cinéma ou la bande dessinée. En regard, le traitement de la révolution asturienne (octobre 1934) paraît bien pauvre. L’événement est pourtant capital, aussi bien pour l’histoire du mouvement ouvrier et syndical en Europe que pour comprendre la guerre civile qui va suivre.
La guerre d’Espagne fait l’objet de multiples publications historiques et elle a été largement appropriée, tant par la littérature, que par le cinéma ou la bande dessinée. En regard, le traitement de la révolution asturienne (octobre 1934) paraît bien pauvre. L’événement est pourtant capital, aussi bien pour l’histoire du mouvement ouvrier et syndical en Europe que pour comprendre la guerre civile qui va suivre.
Alfonso Zapico s’attelle à réparer ce manque, avec une fresque dessinée en quatre tomes.
Graphiquement, l’œuvre est particulièrement réussie. L’auteur livre un noir et blanc âpre, mais lisible et qui est modulé selon les scènes : le trait se fait presque à la truelle lors de certaines séquences, pour mieux en faire ressortir la violence. La qualité se maintient au fil des pages, ce qui est notable compte tenu de l’ampleur de cette production.
Deux grandes qualités sont à relever en ce qui concerne la confection du récit.
D’abord, l’auteur multiplie les points de vue et les échelles. D’une page à l’autre, on passe du quotidien des mineurs à des enjeux économiques mondiaux (cours de la bourse) et géopolitiques européens (montée des fascismes), le tout sans didactisme.
Ensuite, on découvre au fil des pages une immense galerie de personnages, chacun évoluant et interagissant avec les autres. C’est bien une histoire humaine, d’hommes et de femmes, qui est mise en scène. De nombreux thèmes sont abordés au cours du récit, qui restent particulièrement actuels : ressorts de la politisation, difficulté de constituer un front uni, place des femmes dans l’insurrection, auto-organisation au jour le jour…
On pourra regretter une intrigue aux enchaînements convenus. Mais nous n’en sommes qu’à la moitié de la saga et l’auteur doit s’en tenir aux cadres de l’histoire. On soupirera aussi parfois à certaines scènes aux bons sentiments appuyés. Mais ne faut-il pas les accepter dans une œuvre qui aspire à rendre compte d’une utopie ?
[Le Tome 3 vient de sortir]
Le chant victorieux des « Penn Sardin » [4]
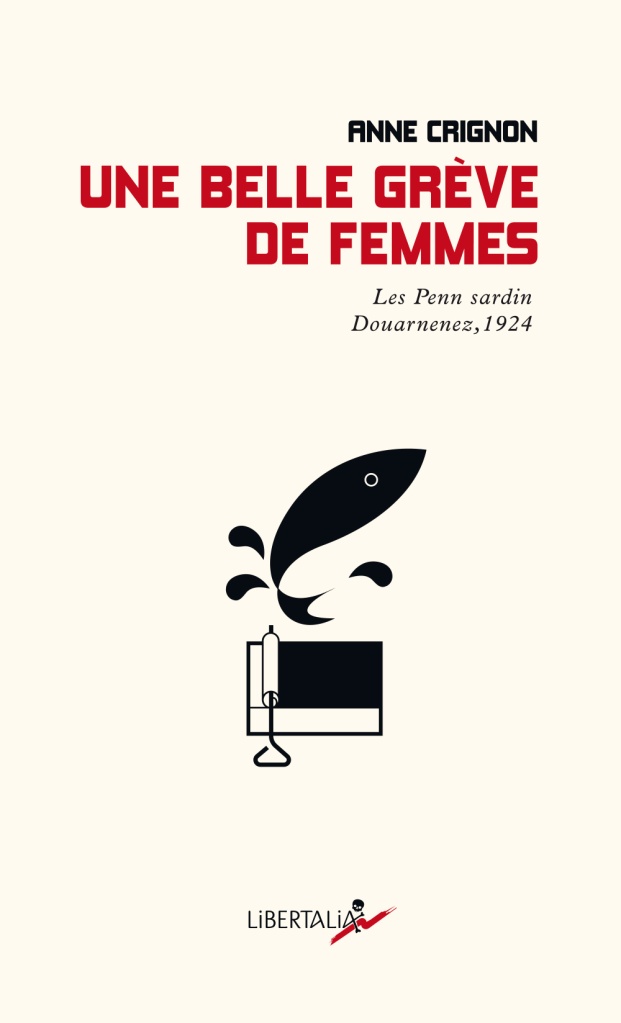 Dans nos années où l’état social, ou ce qu’il en reste, est attaqué au bulldozer, avec l’assentiment frauduleux des masses obtenu par une propagande néolibérale intensive, il est toujours bon de se rappeler des luttes passées et en particulier, des luttes victorieuses. Car dans les années 2020, c’est bien, à force d’affaissement des droits des salariés, un retour aux années 1920 qui se profile.
Dans nos années où l’état social, ou ce qu’il en reste, est attaqué au bulldozer, avec l’assentiment frauduleux des masses obtenu par une propagande néolibérale intensive, il est toujours bon de se rappeler des luttes passées et en particulier, des luttes victorieuses. Car dans les années 2020, c’est bien, à force d’affaissement des droits des salariés, un retour aux années 1920 qui se profile.
Et le travail des sardinières de l’époque tel que raconté par Anne Crignon dans son livre Une belle grève de femmes n’est pas sans rappeler ce travail destructeur qui est toujours celui des abattoirs aujourd’hui, illustré avec le même esprit dans le beau documentaire Entrée du personnel de Manuela Frésil. Ces mêmes abattoirs qui ont inspiré Taylor pour le travail à la chaîne.
Ce sont des journées de travail qui pouvaient durer jusqu’à trois jours d’affilée, quand la loi ne prévoyait déjà que huit heures. C’était souvent du travail de nuit, car les pêcheurs pouvaient rentrer en fin de journée et le poisson, lui ne pouvait pas être conservé avant d’être mis en boîte. C’était des enfants qui travaillaient dès l’âge de huit ans pour rapporter un peu d’argent au foyer. Seuls les patrons arrogants, qui menaient publiquement grand train, sont devenus des individus anonymes.
Mais un jour, cela a suffi. En novembre 1924, c’est comme toujours un fait anodin, la petite injustice de trop qui a provoqué la grève de plusieurs milliers de ces femmes – qui vivaient chichement mais dignement, malgré leur double journée – pendant deux mois.
Si les « usiniers » ne voulaient rien lâcher, ce sont des briseurs de grève payés par le comité des forges, ancêtre de l’actuel UIMM, qui les obligèrent à concéder augmentations, limitation de la journée à 8h, et heures supplémentaires, après l’agression par balles du maire communiste de Douarnenez, Daniel Le Flanchec. Car s’il n’a pas déclenché la grève, c’est bien lui, qui a permis par l’organisation de réseaux de solidarité que la grève puisse durer et avec l’appel à des camarades de la CGT (CGTU à l’époque) naissante Charles Tillon et Lucie Colliard, que ces femmes apprennent à se défendre elles-mêmes, jusqu’à la victoire.
Pour un droit du peuple à la légitime défense [5]
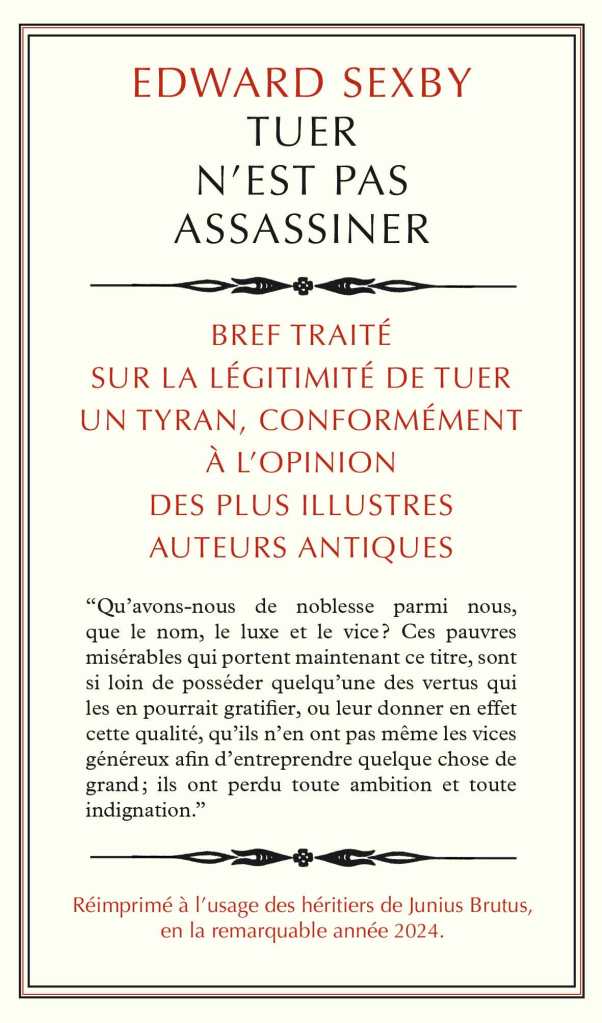 Oliver Cromwell, sous le nom cynique de Lord-protecteur du Commonwealth, a imposé à l’Angleterre une tyrannie sévère pendant une courte période au milieu du XVIIe siècle. Après avoir écrasé le parlement et s’être accaparé la totalité des pouvoirs, Cromwell fait l’objet de tentatives d’assassinat, en retour desquelles une répression violente s’abat sur le pays — le roman Cleveland de l’abbé Prévost, narrant l’histoire fictive d’un bâtard de Cromwell, illustre la traque impitoyable que le despote menait à l’égard de ses détracteurs.
Oliver Cromwell, sous le nom cynique de Lord-protecteur du Commonwealth, a imposé à l’Angleterre une tyrannie sévère pendant une courte période au milieu du XVIIe siècle. Après avoir écrasé le parlement et s’être accaparé la totalité des pouvoirs, Cromwell fait l’objet de tentatives d’assassinat, en retour desquelles une répression violente s’abat sur le pays — le roman Cleveland de l’abbé Prévost, narrant l’histoire fictive d’un bâtard de Cromwell, illustre la traque impitoyable que le despote menait à l’égard de ses détracteurs.
C’est dans ce contexte que paraît en 1657 un pamphlet attribué à Edward Sexby (publié sous le pseudonyme de William Allen, sa paternité reste incertaine), et appelant à éliminer Cromwell. Loin d’être un simple libelle, un appel au meurtre gratuit, ou d’être uniquement dirigé contre le tyran anglais, l’opuscule vise à démontrer l’existence d’un droit général et universel à la légitime défense pour les peuples opprimés.
Pour cela, Sexby développe une argumentation en trois temps : prouver que Cromwell est effectivement un tyran, prouver qu’il n’est pas immoral de tuer un tyran, et montrer enfin que cela est même nécessaire. Il mobilise pour cela une érudition impressionnante — ses références étant principalement empruntées aux écrits saints du christianisme, et aux « plus illustres auteurs antiques », comme le souligne le sous-titre de l’ouvrage —, servie par une ironie et un humour grinçants, et un sens certain de la formule.
Comme son cousin français sur la Servitude volontaire de La Boétie, le texte de Sexby reste (malheureusement) d’actualité sur bien des points, et décrit bon nombre de mécanismes intemporels qui résonnent de manière familière : les républiques « où l’on pend les petits voleurs mais où les grands sont en sûreté », les orateurs accédant au pouvoir « en prenant pour prétexte la liberté du peuple, […] qu’ils oppriment [ensuite] eux-mêmes », ou encore la stratégie d’avilissement du peuple consistant à « aveugler nos entendements et abaisser nos esprits jusqu’à ce que nous fassions la cour à notre propre servitude ».
Le dernier point est au centre de l’argumentation de Sexby : pour rester au pouvoir, un tyran doit nécessairement exterminer la vertu, « ou il ne sera jamais en sûreté, tellement qu’il en est réduit à cette malheureuse nécessité : vivre parmi les infâmes, ou ne plus vivre du tout ». Si la population sous la tyrannie est nécessairement une population destinée à devenir « infâme » et avilie, la légitimité de tuer son oppresseur n’est alors pas qu’une question de liberté, mais aussi une question de dignité.
Raviver les flammes de la contestation [6]
 Pour son troisième numéro, la revue annuelle de contre-histoire, Brasero, éditée par la maison d’édition L’Échappée, nous gratifie une nouvelle fois de passionnants éclairages historiques sur des thèmes souvent délaissés par la vulgarisation historique. Fidèle à sa philosophie contestataire et libertaire, la revue propose ainsi « d’éclairer l’histoire de manière oblique, en privilégiant […] les marges, les personnages et personnages obscurs, oubliés ou méconnus ».
Pour son troisième numéro, la revue annuelle de contre-histoire, Brasero, éditée par la maison d’édition L’Échappée, nous gratifie une nouvelle fois de passionnants éclairages historiques sur des thèmes souvent délaissés par la vulgarisation historique. Fidèle à sa philosophie contestataire et libertaire, la revue propose ainsi « d’éclairer l’histoire de manière oblique, en privilégiant […] les marges, les personnages et personnages obscurs, oubliés ou méconnus ».
C’est d’abord dans l’histoire incarnée et décentrée des rébellions et révolutions, menées par des acteurs subalternes que nous entraîne la revue, à travers notamment la présentation de Tupac Amaru II, Inca du XVIIIe siècle, opposé à la domination de l’empire espagnol et précurseur de l’indépendantisme péruvien. Nous retrouvons cette fibre anticolonialiste de la revue dans la mise en exergue de Lucie Cousturier (1876-1925), femme peintre néo-impressionniste et écrivaine décolonialiste, luttant courageusement pour les droits des Africains. Pensons aussi à la réhabilitation d’Henry Salt (1851-1939), socialiste, pacifiste et précurseur de l’animalisme, injustement jeté aux oubliettes de l’Histoire, alors même qu’il aurait sa place aux côtés des précurseurs de l’écologie tels que Elisée Reclus ou Henry David Thoreau. Une attention doit être portée à Angelica Balabanova première secrétaire de la Troisième Internationale en 1919, dont la trajectoire biographique, résolument transfrontalière, à l’engagement sans faille, interpelle les passionnés de l’histoire du mouvement ouvrier. Plus connue, la figure de Louise Michel est aussi abordée, mais cette fois-ci dans une dimension beaucoup plus intime, mais non moins intéressante : sa tumultueuse vie sentimentale.
Les phénomènes obscurs sont également traités, à l’instar des camps de concentration, lors de la Première Guerre mondiale, organisés pour y enfermer les opposants pacifistes et libertaires, et dont les terribles conditions d’internement sont désormais mieux connues grâce à l’exhumation récente d’un témoignage d’un ancien détenu. Toujours dans le registre de l’anti-monde, est aussi abordé le vécu des courtisanes japonaises sous l’ère Edo (1603-1868) ; une entrée dans le monde de la prostitution, magnifiquement illustrée par des estampes japonaises de l’époque, qui permet de nous sensibiliser aux expériences de ces femmes, à la fois source de fascination et de rejet moral.
Enfin, la fibre techno-critique de la revue se révèle également à travers la brillante et pédagogique présentation de la pensée anti-machiniste de l’auteur socialiste britannique de la fin du XIXe siècle, John Ruskin. Une incise plus contemporaine est proposée avec une étude critique de la modernisation, et de l’intégration forcée à la mondialisation de la Birmanie, depuis les années 2010.
Servie par une iconographie haute en couleur et particulièrement immersive – très rare dans le champ éditorial actuel – Brasero réveille le feu du sentiment révolutionnaire par la dignification des acteurs et actrices en lutte, parfois bien isolée, contre l’injustice de leur temps. Plus largement, elle (re)donne une voix aux oubliés de l’Histoire, inscrivant ainsi de la recherche historique, lorsqu’elle est réalisée avec déontologie et rigueur, dans une démarche éthique salutaire, à l’ère de l’indifférence généralisée.
Nos Desserts :
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Notre sélection littéraire des années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014
- Et notre revue papier (quatre numéros parus) à commander en ligne
Catégories :Shots et pop-corns


Falk van Gaver est toujours vivant !
Que devient-il ?