- Régime général, Laura Petersell, Kévin Certenais, Riot Éditions, 2022 [1]
- Le Crépuscule des saints, Stéphane Lacroix, CNRS Éditions, 2024 [2]
- La domination et les arts de la résistance, James Scott, Éditions Amsterdam, 2019 [3]
- Penser le rap, Kevin Boucaud-Victoire, Éditions de l’Aube, 2024 [4]
- Le voyage de Shuna, Hayao Miyazaki, Éditions Sarbacane, 2023 [5]
- Alors nous irons trouver la beauté la beauté ailleurs, Corine Morel-Darleux, Libertalia, 2023 [6]
Reprendre le contrôle de l’alimentation [1]
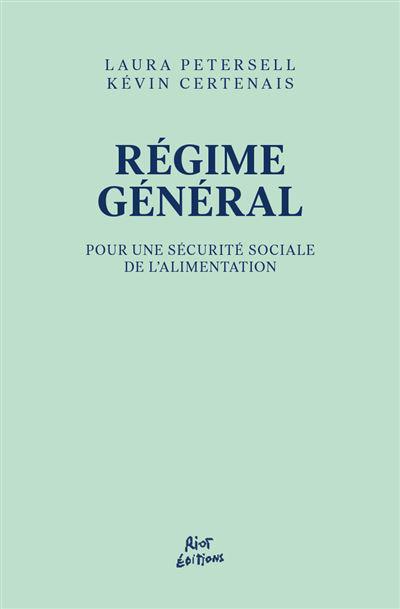 L’idée d’une sécurité sociale de l’alimentation fait son chemin. À travers cet ouvrage incisif d’une centaine de pages (disponible en ligne gratuitement sur le site de Riot éditions), les deux auteurs, membres du Réseau Salariat, reprennent les réflexions de Bernard Friot sur la sécurité sociale pour les étendre à l’alimentation.
L’idée d’une sécurité sociale de l’alimentation fait son chemin. À travers cet ouvrage incisif d’une centaine de pages (disponible en ligne gratuitement sur le site de Riot éditions), les deux auteurs, membres du Réseau Salariat, reprennent les réflexions de Bernard Friot sur la sécurité sociale pour les étendre à l’alimentation.
D’entrée de jeu, Régime général pose un constat : les industriels de l’agro-alimentaire contrôlent aussi bien l’amont (semences) que l’aval (transformation, distribution) de la filière alimentaire, et tout projet un tant soit peu conséquent se doit en priorité de mettre à bas ce complexe agro-industriel imposant une agriculture intensive qui tend à faire de l’alimentation une marchandise comme les autres. Les auteurs affirment à juste titre que la manière dont on se nourrit est politique car celle-ci recouvre aussi bien des enjeux de santé publique (l’usage de pesticides, d’herbicides…), environnementaux (la déforestation pour la production de soja et l’élevage de bétail…) ou sociaux (la rémunération, les conditions de travail…). Si le système alimentaire mondial est capable de produire suffisamment de nourriture pour l’ensemble du globe (bien que 800 millions de personnes souffrent de malnutrition), la question n’est dès lors pas comment produire davantage, mais qui produit, pourquoi et dans quelles conditions ?
Divisé en cinq chapitres, l’ouvrage aborde la question du travail sous régime capitaliste au prisme des inégalités de classe, de race et de genre, et propose de lutter pour une nouvelle définition du travail en étendant le statut de fonctionnaire (et donc du salaire à vie) et en reconnaissant aux travailleurs la qualité de producteurs légitimes à définir ce qui est produit et dans quelles conditions. Le chapitre suivant s’attarde sur la propriété, enjeu ô combien essentiel tant la naissance et l’extension du capitalisme se sont accompagnées d’une privatisation du commun – l’ « accumulation primitive » de Marx –, et pour lequel les auteurs proposent d’opposer à la propriété lucrative (générer des profits du seul fait d’être propriétaire) la copropriété d’usage, à savoir la propriété légitimée par l’usage d’un bien. Sont ensuite explorés la gouvernance (à travers la socialisation de la valeur ajoutée et la prise de décision collective), l’investissement (en recourant à la cotisation sociale plutôt qu’à l’emprunt ou l’impôt), et pour finir le « but » d’une sécurité sociale de l’alimentation.
La proposition ébauchée par Régime général repose sur un système où des entreprises composées de salariés copropriétaires d’usage de leur outil de travail (sur le modèle des SCOP) et percevant un salaire à vie, seraient conventionnées par les caisses de la Sécurité sociale, qu’il s’agisse de fermes, d’ateliers de transformation, d’épiceries ou de lieux de restauration collective. Chaque personne résidant en France percevrait une allocation mensuelle (qui ne pourrait être dépensée qu’auprès des entreprises conventionnées), et, puisque la nourriture n’est pas une marchandise comme les autres, la Sécurité sociale financerait également la création d’un service de restauration collective autogéré où les repas seraient servis gratuitement.
S’inscrivant dans la filiation de Friot, les auteurs répertorient les alternatives existantes au capitalisme – le « communisme déjà là » – en cherchant à les étendre (le régime général de la sécurité sociale, Terre de liens, Via Campesina, Scop-TI, l’Après M…) afin de proposer un système alimentaire postcapitaliste. Un ouvrage très facile d’accès qui offre une réflexion stimulante sur un enjeu porté dans le débat public notamment par Riposte Alimentaire.
Le salafisme à l’épreuve de la politique [2]
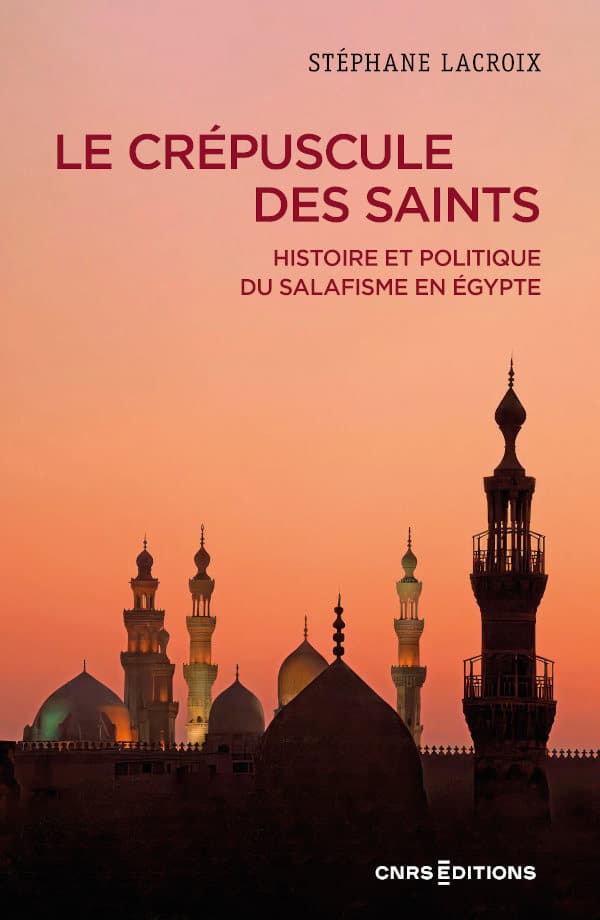 Le militantisme d’inspiration panislamiste n’a cessé de nourrir une riche littérature scientifique ces dernières années, tout en étant l’objet de tribunes tous azimuts de commentateurs opportunistes et bigots. Le dernier essai du chercheur Stéphane Lacroix, professeur associé à Sciences Po au Centre de Recherches Internationales et co-directeur de la Chaire d’Études sur le Fait Religieux, intitulé Le Crépuscule des Saints : Histoire et politique du salafisme en Égypte, vient enrichir la première catégorie en contribuant à mieux comprendre les transformations contemporaines de l’islam sunnite, notamment celles concernant l’influent mouvement salafiste.
Le militantisme d’inspiration panislamiste n’a cessé de nourrir une riche littérature scientifique ces dernières années, tout en étant l’objet de tribunes tous azimuts de commentateurs opportunistes et bigots. Le dernier essai du chercheur Stéphane Lacroix, professeur associé à Sciences Po au Centre de Recherches Internationales et co-directeur de la Chaire d’Études sur le Fait Religieux, intitulé Le Crépuscule des Saints : Histoire et politique du salafisme en Égypte, vient enrichir la première catégorie en contribuant à mieux comprendre les transformations contemporaines de l’islam sunnite, notamment celles concernant l’influent mouvement salafiste.
L’ouvrage propose une socio-histoire du salafisme en Égypte, fruit d’une enquête débutée une décennie auparavant, montrant comment ce mouvement rigoriste de l’islam sunnite a pris l’ascendant sur son rival historique, le mouvement des Frères musulmans. Mû par une « grammaire d’action » pessimiste de nature, habile dans l’entrepreneuriat, rejetant en façade la politique et privilégiant le travail par le « bas », les salafistes sont devenus, au fil des années, une force sociale « quasi-hégémonique » sur la scène religieuse islamique sunnite. Au cours des cinquante dernières années, ils ont réussi à redéfinir les contours du sunnisme, le courant majoritaire dans le monde musulman. Cette mainmise du salafisme sur l’islam sunnite a eu pour conséquence de transformer les normes, les pratiques et les conceptions de ce dernier, au travers d’une longue évolution marquée par ce phénomène religieux fascinant et complexe. L’un des intérêts de cette étude est justement de permettre au lecteur de mieux distinguer ce courant des Frères musulmans et du djihadisme, souvent amalgamés dans le débat public en Europe.
À l’opposé des Frères musulmans, orientés vers une solution politique pour les maux des musulmans, les salafistes considèrent que la société islamique doit se réformer, voire se purifier, par le bas, « grâce au retour à une croyance (orthodoxie) et à une juste pratique (orthopraxie) ». Le salafisme se définit alors comme une « grammaire d’action », avec « des mots qui forment un langage, lui-même animé par une grammaire ». La force de ce mouvement réside dans son habileté à investir les moyens de communication et de diffusion de leur époque. Dotés d’un « éthos entrepreneurial », les salafistes se sont saisis, au siècle dernier, de l’édition, en promouvant leurs auteurs phares comme Ibn Taymiyya, pour ensuite se lancer dans les shows religieux télévisés. Ils parviennent ainsi, petit à petit, à gagner la bataille culturelle sur la scène panislamiste, en imposant « leur lecture du corpus islamique comme la référence ». Leur quiétisme politique, qui leur a permis d’éviter la confrontation avec les pouvoirs politiques, en particulier le pouvoir militaire en Égypte, leur a donné l’occasion de surpasser leur concurrent, le mouvement des Frères musulmans, épuisé par la répression qu’il subit.
La révolution égyptienne de 2011 constitue une bascule déterminante, puisque les salafistes sortent de leur quiétisme politique et recueillent 25 % des voix aux premières élections démocratiques de l’Égypte post-Moubarak. En participant à la vie politique, le salafisme tombe dans l’escarcelle des concessions politiques, qui entachent son aura : en 2013, il participe comme spectateur à la répression des islamistes égyptiens en soutenant le coup d’État du général Sissi. Pour l’auteur, bien qu’il fasse l’objet d’un reflux relatif, les salafistes ont bâti une génération d’acteurs et d’organisations qui ont marqué l’orthodoxie sunnite pour un certain temps, ouvrant la voie à une phrase “post-salafiste” dont les contours restent à étudier.
Ce que le chef ignore [3]
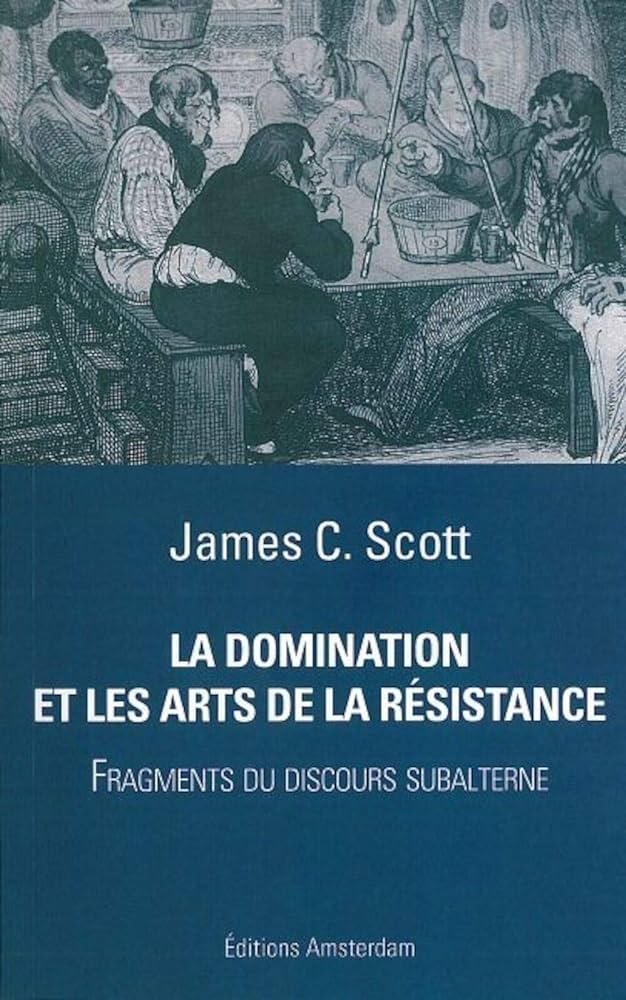 C’est une question récurrente, obsédante même, qu’on se pose aussitôt qu’on parle dictature, esclavage, féodalité, castes ou colonisation : « Comment, mais comment faisaient (font, parfois) les victimes pour ne pas se rebeller ? » Leur passivité, parfois séculaire, l’humble déférence qui leur semble une seconde peau, nous paraît inhumaine, inconcevable. Mais la rébellion, sitôt qu’elle advient, ne fait que redoubler notre stupeur : car tout son déchargement de violence rend compte du torrent de frustration accumulé dans l’ombre. Faut-il en conclure que les dominés, derrière leurs yeux baissés, cachaient leur jeu, dans une scénographie impeccable, une simulation de consentement jouée sans accrocs durant des siècles ? Et, bouche bée devant ce basculement si brusque, on imagine qu’il dût y avoir des prodromes, et, retournant la question, l’on reste sans saisir comment les bourreaux d’hier n’avaient-ils rien pu voir venir.
C’est une question récurrente, obsédante même, qu’on se pose aussitôt qu’on parle dictature, esclavage, féodalité, castes ou colonisation : « Comment, mais comment faisaient (font, parfois) les victimes pour ne pas se rebeller ? » Leur passivité, parfois séculaire, l’humble déférence qui leur semble une seconde peau, nous paraît inhumaine, inconcevable. Mais la rébellion, sitôt qu’elle advient, ne fait que redoubler notre stupeur : car tout son déchargement de violence rend compte du torrent de frustration accumulé dans l’ombre. Faut-il en conclure que les dominés, derrière leurs yeux baissés, cachaient leur jeu, dans une scénographie impeccable, une simulation de consentement jouée sans accrocs durant des siècles ? Et, bouche bée devant ce basculement si brusque, on imagine qu’il dût y avoir des prodromes, et, retournant la question, l’on reste sans saisir comment les bourreaux d’hier n’avaient-ils rien pu voir venir.
L’étonnement de l’observateur répète celui du dominant, pour la bonne raison que c’est du vainqueur que l’on retient l’histoire. Comme lui, nous tendons à ne voir le dominé que sous deux jours : celui, silencieux, qu’impose la soumission, et celui, hurlant, qu’autorise la révolte. De quoi naît le soupçon : et si… Et si ce visage obséquieux n’était qu’un leurre ? Et si, derrière ce masque uni, cette résignation faite chair, se dissimulait un autre visage, celui qui accumule à loisir coquinerie, rancœur, haine peut-être, envers ce dominant qu’il respecte à la lettre ? Comment savoir ? Après tout, il arrive au dominant lui-même d’avoir deux visages : celui qui tient son rôle en public, et celui qui se lâche en privé, brocardant au passage le dominé, sa bête soumission, et sa naïve confiance en l’ordre dont il est la dupe. C’est que le dominant, par un libre acte de foi, croit en son ordre, et tient son rang, en conséquence ; mais il sait aussi prendre de la distance, quand il le faut. Serait-il possible qu’ils agissent mêmement, de l’autre côté de la barrière ? Que, derrière la croyance sans faille du serviteur en l’ordre immuable dont il est le dindon, se glisse de la raillerie, une incrédulité fondamentale et ravageuse quant à son bien-fondé, un « je n’en crois rien » qui soudain dénude le roi ?
James Scott, anthropologue de son état, a voulu en avoir le cœur net. Pour cela, il a passé plusieurs années auprès de paysans malais, derniers maillons d’un ordre féodal. Il a lu aussi, beaucoup et partout : Balzac sur les serfs et les châtelains, Foucault sur les taulards et les matons, Senghor sur le Noir et le Blanc. Dans un livre lumineux, à la langue simple et claire, il expose le résultat de ses recherches. Oui, par-delà le masque de soumission, le « texte public », il existe toujours un arrière-monde, un « texte caché », une sous-culture où les dominés se parlent, se rient, se jouent de leurs supérieurs. Dans ces coulisses « infrapolitiques », on ne planifie pas de résistance ouverte aux dominants ; plus souvent, on s’organise pour louvoyer, esquiver, resquiller, passer outre les contraintes auxquels l’on est astreint. Cette culture souterraine, souvent codée, ritualisée, d’une complexité que n’imagine pas une seconde le dominant, renvoie pourtant, comme en écho, au « texte caché » des dominants eux-mêmes, qui, eux aussi, lorsqu’ils sont entre eux, s’écartent et mettent de la distance vis-à-vis du rôle qu’ils se taillent lors des interactions publiques.
Scott nous détaille ainsi, par-delà ces modes du silence et du cri sur lesquels la science politique s’est appesantie, ce tiers mode, celui du murmure, du bruissement, aussitôt le dos tourné. Parce qu’il est masqué, que les archives publiques ne le captent pas, l’Histoire a oublié ce mode d’interaction, ces sous-cultures de la rumeur et du chuchotis ; elles constituent pourtant, assure Scott, le principal mode d’expression politique des dominés, le langage politique le plus usité de l’humanité.
Morcellement du rap et dépolitisation [4]
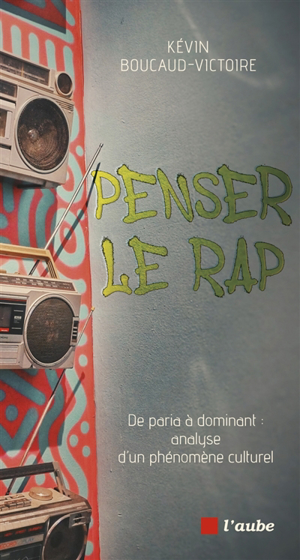 Notre rédacteur en chef vient de publier son nouvel ouvrage : Penser le rap. Un livre court mais dense sur le sujet. Les références sont très nombreuses (plus de vingt pages d’annexe pour les références) pourtant cet essai reste compréhensible des plus néophytes en la matière, ce qui tient de la magie tant les styles musicaux deviennent de plus en plus spécialisés et opaques.
Notre rédacteur en chef vient de publier son nouvel ouvrage : Penser le rap. Un livre court mais dense sur le sujet. Les références sont très nombreuses (plus de vingt pages d’annexe pour les références) pourtant cet essai reste compréhensible des plus néophytes en la matière, ce qui tient de la magie tant les styles musicaux deviennent de plus en plus spécialisés et opaques.
L’ouvrage est animé par deux fils conducteurs. Premièrement, le fait que le rap se trouve dans la situation qu’avait pu vivre le rock. À l’origine des styles musicaux provocateurs, rebelles, et politisés qui se sont petit à petit policés pour être plus commercialisables. Deuxièmement, le rap, comme d’autres produits culturels, se retrouve victime des bulles algorithmiques des plateformes de streaming et de diffusion. Si bien que les rappeurs les plus vendeurs peuvent être totalement inconnus du plus grand nombre. Ces fils conducteurs se rejoignent dans une analyse fine et juste, démontrant que le rap est un produit de son temps.
Né en France fin des années 80 début des années 90 avec des propos forts et contestataires, le rap français a rapidement subi une mise à jour commercial. Il est ensuite petit à petit devenu un phénomène culturel de plus en plus divisé ce qui lui a permis de s’étendre sur des niches de consommateurs inatteignables auparavant (les cadres de centre-ville).
Bref, l’essai de Kevin Boucaud-Victoire démontre que le rap est devenu un pur produit de la post-modernité, dépolitisé, calibré pour plaire à un secteur de consommateur, ainsi qu’un produit commercial permettant de se donner une identité.
Un autre Miyazaki [5]
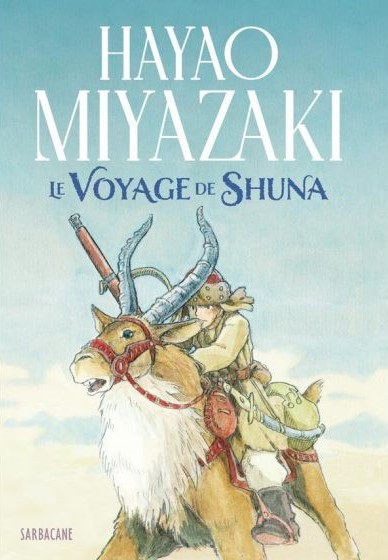 Malgré sa popularité, l’intégralité de l’œuvre d’Hayao Miyazaki reste encore mal connue en France. Il aura fallu attendre quarante ans pour y voir projeté Le Château de Cagliostro (1979). Quarante ans, également, séparent la sortie du Voyage de Shuna au Japon de son édition par Sarbacane en langue française.
Malgré sa popularité, l’intégralité de l’œuvre d’Hayao Miyazaki reste encore mal connue en France. Il aura fallu attendre quarante ans pour y voir projeté Le Château de Cagliostro (1979). Quarante ans, également, séparent la sortie du Voyage de Shuna au Japon de son édition par Sarbacane en langue française.
L’ouvrage, qui est l’adaptation toute personnelle d’un conte traditionnel tibétain, peut dérouter au premier regard. Il s’agit en effet d’un emonogatari. Beaucoup de pages ne comportent ni phylactère ni case ni gouttière ni marge ni pagination, mais de grandes illustrations commentées par un narrateur dont on ne saura rien. À bien des égards, on est plus proche d’un journal de voyage tenu par un aquarelliste que d’une bande dessinée classique.
On retrouve cependant dans Le Voyage de Shuna tout ce qui fait la richesse et la poésie de l’œuvre de Miyazaki : écologie incarnée, humanisme lucide, trouble de la civilisation, voyage initiatique, situations complexes et ambiguës, posées dès la phrase introductive : « Ces événements ont pu se dérouler il y a fort longtemps. Ou bien allaient-ils se produire dans un lointain futur ? Plus personne ne le sait vraiment. » D’ailleurs, Shuna, qui sort en 1983, est le pendant de Nausicaä, sur laquelle Miyazaki travaille en parallèle. Tous deux sont de rangs princiers et leurs visages présentent des traits d’une étonnante similitude. On retrouve aussi dans Shuna quelques inventions qui resurgiront dans Princesse Mononoké (animaux) ou dans Le Château dans le Ciel (géants).
Pour autant, Le Voyage de Shuna n’est pas la simple transposition mécanique des thèmes chers à Miyazaki. On y découvre ainsi un héros au caractère ombrageux, une société fondée sur le trafic d’êtres humains ou, encore, un clergé oppresseur. Surtout, le souffle du vent (autre élément de l’identité de Miyazaki, évoqué explicitement dès la deuxième double-page) sort du livre, nous enivre et nous entraîne dans un voyage hypnotique. Et on voudrait, nous aussi, chevaucher un yakkuru au milieu de ruines cyclopéennes.
Rêver à l’action [6]
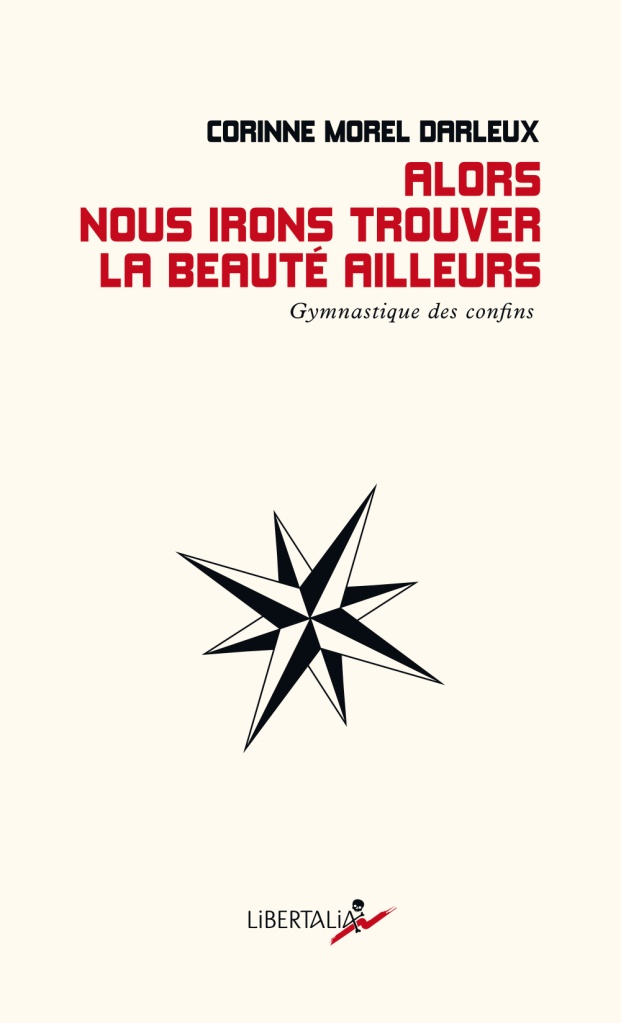 Si avec Plutôt couler en beauté plutôt que flotter sans grâce, Corinne Morel-Darleux nous avait invité à une méditation au long cours sur le désir de ne pas parvenir, et in fine sur la décroissance, avec Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, elle nous invite à un voyage. Mais il ne s’agit pas d’un voyage pour fuir le réel, ou se distraire d’un réel trop rébarbatif, pesant, ou déprimant comme le titre pourrait le faire penser. Il s’agit de s’évader pour prendre du recul, humer l’air, faire une pause, pour retrouver le réel, le rêve et la lucidité.
Si avec Plutôt couler en beauté plutôt que flotter sans grâce, Corinne Morel-Darleux nous avait invité à une méditation au long cours sur le désir de ne pas parvenir, et in fine sur la décroissance, avec Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, elle nous invite à un voyage. Mais il ne s’agit pas d’un voyage pour fuir le réel, ou se distraire d’un réel trop rébarbatif, pesant, ou déprimant comme le titre pourrait le faire penser. Il s’agit de s’évader pour prendre du recul, humer l’air, faire une pause, pour retrouver le réel, le rêve et la lucidité.
Au travers du récit d’un voyage en Inde, ponctuée de nombreuses interventions littéraires, elle nous raconte sa vie sur place, ses observations, ses sensations, qui tout naturellement, avec langueur et indolence, amènent à des réflexions philosophico-politiques. Cet autre réel, qui a comme le nôtre ses qualités et ses défauts, donne des idées de modes de vie, de façon d’habiter et de cohabiter avec son territoire et naturellement des perspectives différentes.
Ce sont de ses perspectives que nait la lucidité. La lucidité de se dire que la revendication dans la rue ne fonctionne plus, et de devenir performatifs. La lucidité de se dire que faire des propositions politiques ne suffisent pas et de construire une vision d’ensemble, de proposer un rêve alternatif.
Nos Desserts :
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Notre sélection littéraire des années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014
- Et notre revue papier (quatre numéros parus) à commander en ligne
Catégories :Shots et pop-corns
