- Le Marxisme est un humanisme, Stéphanie Roza, PUF, 2024 [1]
- LQI, notre langue quotidienne informatisée, Yann Diener, Les Belles Lettres, 2022 [2]
- Les habits neufs de la politique mondiale, Wendy Brown, Amsterdam, 2007 [3]
- L’espèce fabulatrice, Nancy Huston, Actes Sud, 2008 [4]
- Le banquier anarchiste, Fernando Pessoa, Christian Bourgeois, 2021 [5]
- Ma mère en toutes choses, Ludivine Ribiero, Arlea, 2023 [6]
Les multiples voies de l’émancipation [1]
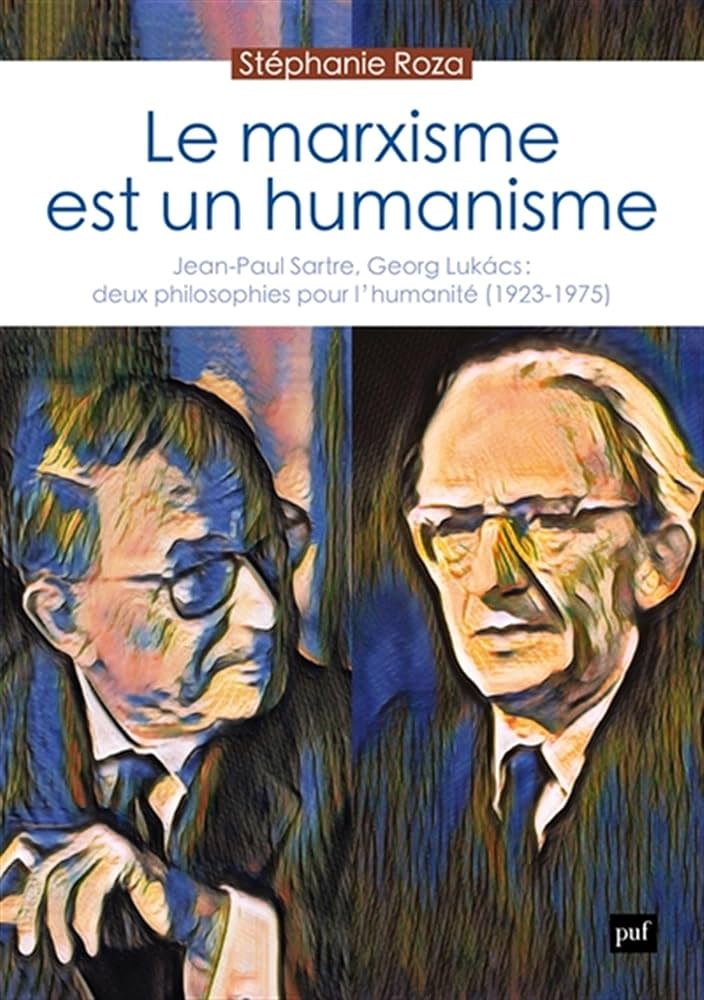 Dès les années 1890, Engels met en garde la social-démocratie allemande contre la diffusion d’un marxisme fossilisé, réduisant la conscience humaine à un simple reflet des réalités socio-économiques. La vulgate stalinienne renforce cette vision à partir des années 1930. Elle est consacrée en France par Althusser, qui oppose un Marx de la jeunesse, humaniste, à un Marx de la maturité, qui déploierait un « antihumanisme théorique ».
Dès les années 1890, Engels met en garde la social-démocratie allemande contre la diffusion d’un marxisme fossilisé, réduisant la conscience humaine à un simple reflet des réalités socio-économiques. La vulgate stalinienne renforce cette vision à partir des années 1930. Elle est consacrée en France par Althusser, qui oppose un Marx de la jeunesse, humaniste, à un Marx de la maturité, qui déploierait un « antihumanisme théorique ».
Très tôt, Lucien Sève combat cette fausse coupure, montrant que les questions de l’émancipation et de l’aliénation restent jusqu’au bout centrales dans l’œuvre de Marx. Depuis les années 2000, cette réflexion s’est renforcée. Marx est d’ailleurs aujourd’hui davantage appréhendé comme un philosophe que comme un économiste et on ne l’oppose plus à la démocratie et aux droits politiques (lire Abensour, par exemple).
Stéphanie Roza reprend ici le dossier, à travers l’étude comparative de deux figures majeures de la philosophie européenne du deuxième XXe siècle, peut-être les derniers philosophes « totalisant » : Sartre et Lukács. Concernant ce dernier, ses œuvres sont encore mal connues en France, malgré des efforts récents de traductions. Le Marxisme est un humanisme permet d’en offrir une première approche utile pour le public francophone.
Au fil des pages, Stéphanie Roza restitue les cheminements intellectuels de Sartre et de Lukács pour rendre à Marx sa part humaniste. L’ouvrage est d’autant plus fascinant que le Hongrois et le Français ont suivi des voies radicalement différentes, révélant la plasticité de Marx quand il s’agit de penser l’émancipation. Quand l’un quête un humanisme marxiste, l’autre cherche un marxisme humaniste. Certaines pages deviennent aussi captivantes qu’un roman policier : comment trouver l’issue dans un raisonnement qui achoppe ? Comment adapter son discours aux grands événements du temps ?
Bien évidemment, et malgré une clarté rare, l’ouvrage reste parfois ardu. On regrettera par ailleurs que les conflits et polémiques entre Sartre et Lukács, certes peu nombreux, ne soient pas davantage développés.
Pour autant, Stéphanie Roza livre une publication incontournable pour qui s’intéresse aux questions de l’émancipation individuelle et collective. Quelle est la marge de manœuvre des humains face aux forces sociales qu’ils engendrent par leur activité ? Comment concilier révolution et démocratie ? Chacun trouvera ici de quoi se nourrir.
La langue au prisme de l’informatique [2]
 Yann Diener est psychanalyste à Paris. Auteur prolixe, il a notamment écrit On agite un enfant (La Fabrique, 2011), ou encore Des histoires chiffonnées (Gallimard, 2019). Dans LQI, Notre Langue Quotidienne Informatisée (Les Belles Lettres, 2022), l’auteur tente de souligner la prégnance du paradigme de l’informatique dans la langue quotidienne que nous employons tout un chacun. Si ce phénomène semble anodin, il cache une mécanisation progressive des rapports humains. Or, cette dernière peut receler une barbarie latente.
Yann Diener est psychanalyste à Paris. Auteur prolixe, il a notamment écrit On agite un enfant (La Fabrique, 2011), ou encore Des histoires chiffonnées (Gallimard, 2019). Dans LQI, Notre Langue Quotidienne Informatisée (Les Belles Lettres, 2022), l’auteur tente de souligner la prégnance du paradigme de l’informatique dans la langue quotidienne que nous employons tout un chacun. Si ce phénomène semble anodin, il cache une mécanisation progressive des rapports humains. Or, cette dernière peut receler une barbarie latente.
D’emblée, l’auteur pointe un changement lié à son travail : s’il y avait jadis un ordinateur dans le bureau de la secrétaire, désormais chaque bureau de consultation est équipé d’une machine, et il est nécessaire de consulter « l’agenda électronique » vingt fois par jour. Ainsi, l’agenda papier, où le psychanalyste écrivait à la main certaines notes nécessaires au bon déroulement des séances de psychanalyse, se perd au profit de la raison informatique : la parole du patient n’est plus première puisqu’il s’agit de « communiquer » avec un ordinateur. Yann Diener cite cette phrase symptomatique qu’il dit à ses patients : « Notez les codes ». Le chiffrement sature donc d’emblée la parole.
Or, il existe une distinction entre communiquer et parler, comme il existe une différence entre le code et la parole : le code fixe le sens conventionnel des mots, c’est une part conventionnel du langage : la parole, quant à elle, est une création singulière qui s’appuie sur des conventions. Cette singularité est renforcée par l’énonciation qui est le ton, le rythme particulier d’une voix. Si les adolescents n’arrivent pas à « communiquer », cela est normal puisqu’ils ne sont pas encore des machines : le « système de codage », s’il devient totalisant, risque de liquider les équivoques, l’humour, les malentendus qui sont autant de marques de la liberté humaine.
Enfin, Diener indique l’aspect profondément théologique qui sous-tend l’extension du paradigme informatique : d’après le Dictionnaire étymologique de la langue française, « ordinateur » vient de la liturgie catholique : ce terme signifiait à l’origine « celui qui confère le sacrement d’un ordre ecclésiastique ». Ainsi, le Dieu-ordinateur prend la place du Seigneur en codant les existences de chacun jusqu’au maniement de la langue.
Érudit et riche, LQI analyse avec rigueur une langue conquise par le paradigme informatique. Contre une logique binaire et standardisée, Yann Diener réhabilite la singularité de la parole. Au moment où la machine tend à tout réifier, (re)lire cet essai est salutaire.
Néolibéralisme : le comprendre pour le combattre [3]
 En 2003, la guerre en Irak, sous la présidence Bush Jr., a été l’évènement le plus marquant d’un retour du conservatisme sous le visage d’une nouvelle force politique appelée « néo-conservatisme ». Si cela a été l’aspect le plus relevé, en particulier par la gauche, cela a été aussi, de manière plus discrète, la victoire du néolibéralisme sur la logique des démocraties dites « libérales ».
En 2003, la guerre en Irak, sous la présidence Bush Jr., a été l’évènement le plus marquant d’un retour du conservatisme sous le visage d’une nouvelle force politique appelée « néo-conservatisme ». Si cela a été l’aspect le plus relevé, en particulier par la gauche, cela a été aussi, de manière plus discrète, la victoire du néolibéralisme sur la logique des démocraties dites « libérales ».
Dans Les habits neufs de la politique, datant de 2007, soit de l’après-guerre et du retentissant « Patriot Act », Wendy Brown, professeure de philosophie politique à Berkeley, analyse au travers de deux textes le fonctionnement et les effets du néolibéralisme, et comment il trouve des convergences avec le néo-conservatisme.
Traitant du « néo-libéralisme » comme d’une « rationalité », au sens de Foucault, elle met ainsi en exergue sa force, car il s’impose non comme idéologie mais comme outil normatif. Cela lui permet d’imposer le marché et le calcul d’intérêt sans avoir l’impression d’y être forcé, que ce soit au niveau de l’État, de la société de l’« égale inégalité pour tous », jusqu’à l’individu, devenu entrepreneur de lui-même. Ayant eu besoin des institutions des démocraties « libérales » pour parvenir au pouvoir, il a ensuite effacé leur essence, un fragile équilibre entre droits politiques et droits économiques, comme celui de la propriété, pour en faire une coquille vide, dont il s’habille tel un bernard-l’hermite.
De cette rupture d’équilibre politique, on pourrait a posteriori comprendre certaines formes de nihilisme politique, du vote pour des politiques contraires à ses propres besoins, à celui pour des partis autoritaires et à l’attaque d’institutions.
Sur beaucoup d’aspects, notamment moraux, néo-conservatisme et néolibéralisme semblent s’opposer. Mais en réalité, les deux sont complémentaires : le néo-conservatisme offre des valeurs d’autorité, pour ne pas dire autoritaires assurant une pérennité, quand il ne remettra bien sûr pas en cause les positions sociales de la vision « gagnants -perdants » du néolibéralisme. L’un comme l’autre n’ont ni besoin de la démocratie sociale, ni de la démocratie politique, et a fortiori, pas besoin du peuple.
Comment alors s’attaquer au néolibéralisme (pour la gauche) ? Pour Wendy Brown, ce n’est ni par la morale, qui est l’expression favorite des néolibéraux, ni par un affrontement idéologique qui ne pourra pas avoir de prise, ni par une tentative de réhabilitation des démocraties « libérales », par nature insatisfaisantes. Cependant, tout porte à croire que le néolibéralisme n’est pas synonyme d’une vie bonne. C’est sans doute ici qu’il faut chercher et imaginer.
Pouvoirs de la fiction [4]
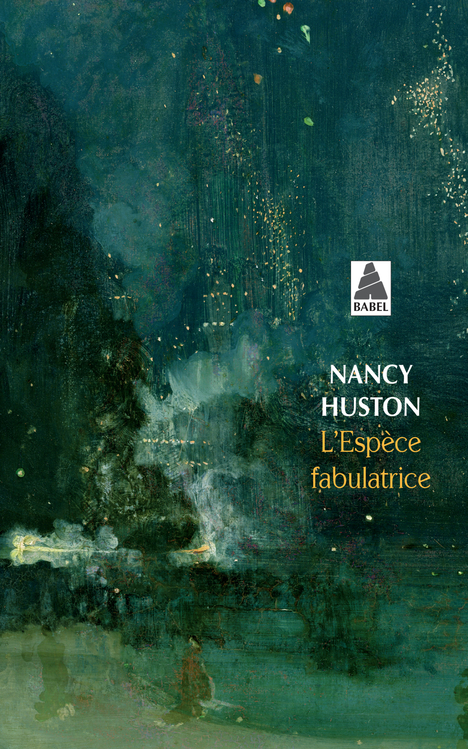 Lire, seize ans après sa parution initiale en 2008, l’essai de Nancy Huston intitulé L’espèce fabulatrice, permet de mettre en perspective le rapport aux identités de notre époque. Car toute identité, individuelle ou collective, ethnique, culturelle ou religieuse, est une fiction, une construction.
Lire, seize ans après sa parution initiale en 2008, l’essai de Nancy Huston intitulé L’espèce fabulatrice, permet de mettre en perspective le rapport aux identités de notre époque. Car toute identité, individuelle ou collective, ethnique, culturelle ou religieuse, est une fiction, une construction.
L’autrice canadienne part d’une intuition que l’on pourrait résumer ainsi : ces « fictions » qu’on nous raconte d’abord, puis que nous nous racontons ensuite, ont une qualité performative. Elles conditionnent notre rapport au monde et la manière dont nous interagissons avec lui.
Rédigé sans effort de démonstration – ce qui rend la lecture très fluide mais peu laisser un lecteur exigeant sur sa faim – ce texte amène de riches pistes de réflexion, en explorant la dimension « narrative » de l’identité, la sédimentation des histoires qui font la subjectivité. Les réflexions les plus fécondes portent sur la psychanalyse et la littérature. En revanche, sur le rapport à la politique et à la religion du « moi », la réflexion est souvent assez superficielle.
On pourrait également objecter à l’autrice qu’elle ne prend pas en compte la place de l’expérience dans la construction de soi, mais ce n’est pas là son sujet. Elle explore, quelque part entre Paul Ricoeur et les politiques de l’identité, la manière dont l’être humain fabule et par-là, se définit.
Apologie ironique de l’idéologie bourgeoise [5]
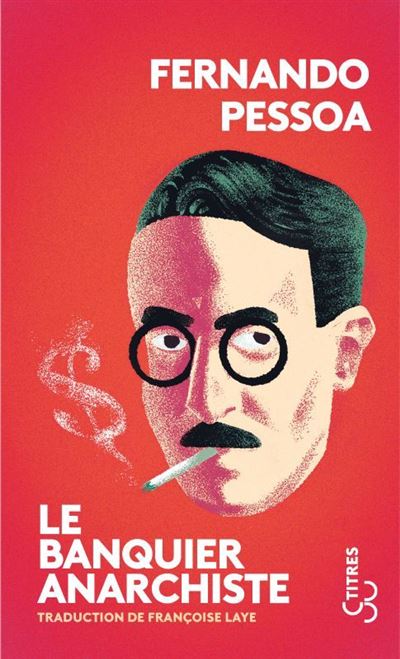 Alors que l’écrivain portugais Fernando Pessoa (1888-1935) publiait usuellement sous de multiples pseudonymes, Le banquier anarchiste est une des rares oeuvres publiées sous son vrai nom. Un indice incontestable de l’importance que Pessoa accordait à cette courte nouvelle, à l’étrangeté prononcée, dénudant de manière ironique et efficace les narratifs sous-tendant la domination bourgeoise. Entièrement sous forme de dialogue, elle met en scène un riche banquier expliquant à son interlocuteur, lors d’un dîner, en quoi il est et a toujours été un anarchiste cohérent et conséquent, « bien plus que les poseurs de bombes ».
Alors que l’écrivain portugais Fernando Pessoa (1888-1935) publiait usuellement sous de multiples pseudonymes, Le banquier anarchiste est une des rares oeuvres publiées sous son vrai nom. Un indice incontestable de l’importance que Pessoa accordait à cette courte nouvelle, à l’étrangeté prononcée, dénudant de manière ironique et efficace les narratifs sous-tendant la domination bourgeoise. Entièrement sous forme de dialogue, elle met en scène un riche banquier expliquant à son interlocuteur, lors d’un dîner, en quoi il est et a toujours été un anarchiste cohérent et conséquent, « bien plus que les poseurs de bombes ».
L’argumentation et le récit du banquier allient virtuosité sur la forme et absurdité sur le fond. Définissant l’anarchisme comme la révolte contre toutes les « fictions sociales » créant des injustices et contribuant à rendre les hommes inégaux, il commence par affirmer son refus du réformisme, qui vise simplement à remplacer une fiction sociale par une autre. Alors qu’il n’était qu’un jeune homme, il se tourne donc naturellement vers l’anarchisme, décidé à agir concrètement, et non pas à « écouter des laïus avec les copains » dans des salons. Le jeune homme, déterminé à n’écouter que les impulsions naturelles contrariées par les fictions sociales, découvre pourtant que des formes de tyrannie naissent dans son milieu militant. Des rapports de domination usuels tout d’abord, puis plus grave, une « tyrannie de l’entraide » qui infantilise certains membres. Afin d’échapper à la contradiction d’un milieu luttant pour l’égalité dans le monde tout en créant de l’inégalité en son sein-même, une conclusion s’impose : poursuivre seul la lutte contre toutes les fictions sociales. Mais puisque lutter contre les représentants humains de ces fictions est vain, et qu’un homme seul ne peut à lui seul abattre ces fictions elles-mêmes, le seul objectif d’un anarchiste ne peut donc être que de « libérer un homme : lui-même ». Et, bien sûr, amasser de grandes quantités d’argent est la seule manière d’y parvenir… Voici comment le jeune homme devint banquier, non en dépit de ses convictions anarchistes, mais par conviction anarchiste.
Au-delà de la mise en évidence d’une mythologie générique donnant le beau rôle aux dominants, l’intérêt de la nouvelle de Pessoa (à la manière de celles de Panaït Istrati) est également d’égratigner certains aspects de la mentalité des dominés. La crédulité des gens ordinaires (incarnée par le narrateur, ne contredisant que très peu l’argumentaire parfois grossier du banquier), l’égoïsme et la vanité des milieux militants, ressortent également en creux. La nouvelle de Pessoa constitue alors un appel au réveil face aux narratifs bourgeois, ce qui la rend toujours extrêmement actuelle… Une continuation du récit a d’ailleurs été imaginée un siècle plus tard par Adeline Baldacchino et Édouard Jourdain, dans une autre habile nouvelle.
Plongée au sein du deuil [6]
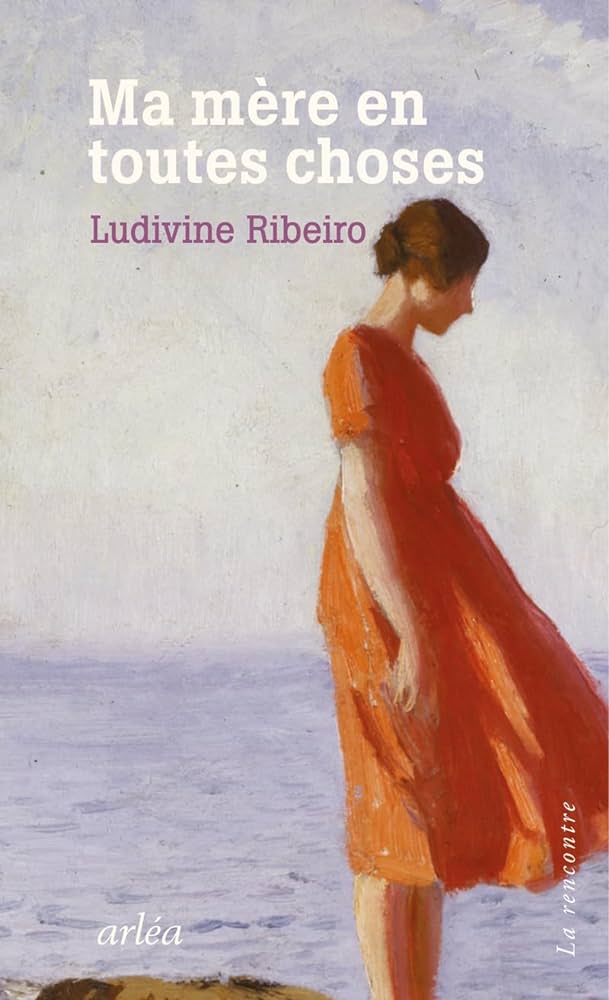 Ludivine Ribeiro a perdu sa mère – et tout son monde s’est écroulé. Dans Ma mère en toutes choses, l’auteure décide de la réécrire à travers les objets qui ont fait partie de son quotidien, les souvenirs épars, vaporeux, incomplets voire inachevés – toujours avec l’espoir de retrouver la lumière dans l’obscurité insoutenable du deuil.
Ludivine Ribeiro a perdu sa mère – et tout son monde s’est écroulé. Dans Ma mère en toutes choses, l’auteure décide de la réécrire à travers les objets qui ont fait partie de son quotidien, les souvenirs épars, vaporeux, incomplets voire inachevés – toujours avec l’espoir de retrouver la lumière dans l’obscurité insoutenable du deuil.
Philippe Delerm écrivait dans La Cinquième saison : « Aujourd’hui que les jours te font loin de mes mains, je pense à ces caresses qui me sont restées, à ces phrases de presque rien qui t’auraient amusée, à des histoires drôles – j’ai mal de ton rire lointain qui n’a pas résonné. »
À la manière de Delerm et de Francis Ponge, qui écrivent tous deux sur la beauté des objets et des situations parfois insignifiants, Ludivine Ribeiro redessine la vie de sa mère grâce aux souvenirs retrouvés, recherchés, qui dépassent les frontières de la mémoire et stagnent dans une réalité entre la vie et la mort.
Mais, si Ludivine Ribeiro met en avant les difficultés du deuil, elle évoque aussi la transmission. Qu’est-ce que nos disparus nous transmettent ? Leurs objets, certes, mais aussi l’étendue de leurs univers à redécouvrir. C’est ce qui touche et bouleverse dans la plume de l’auteure. Cette lumière qui s’étend sur cette liste d’objets dont on devine la forme, et surtout, dont on comprend les histoires qu’ils lèguent.
Comment écrire l’espoir à travers le deuil ?
Ludivine Ribeiro nous donne une ébauche de réponse. Le deuil nous force à nous reconnecter à l’essentiel, à ces instants auxquels on ne prête pas attention, mais qui font tout de la personne que l’on chérit. Elle nous apprend que la perte réinterroge l’amour, nous pousse à le comprendre davantage, à le rechercher encore – à le poursuivre. L’espoir, c’est aussi écrire l’être aimé, le sculpter dans le marbre d’un écrit qui fige ces souvenirs en fuite. En faire le témoin de l’éternité – un acte magique que seul l’art peut peindre dans le temps.
Ma mère en toutes choses est une œuvre émouvante, complexe à lire de par le thème du deuil, mais si merveilleuse pour l’âme qui n’oublie jamais.
Nos Desserts :
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Notre sélection littéraire des années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014
- Et notre revue papier (quatre numéros parus) à commander en ligne
Catégories :Shots et pop-corns
