- La pensée en otage : S’armer intellectuellement contre les médias dominants, Aude Lancelin, Les Liens qui Libèrent, 2018 [1]
- Paname underground, Johann Zarca, éditions de la Goutte d’Or, 2017 [2]
- Changer la vie : Pour une reconquête démocratique, Natacha Polony, éditions de l’Observatoire, 2017 [3]
- Les soliloques du Pauvre, Vîrus x Jehan-Rictus, Au Diable Vauvert, 2017 [4]
- La Source au bout du monde, William Morris, Libretto, 2017 [5]
- À nous la ville : Traité de municipalisme, Jonathan Durand Folco, Écosociété, 2017 [6]
- Homo metallicus : Du mythe à la réalité, Nicolas Bénard, Camion Blanc, 2017 [7]
- Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, Pièces et main d’œuvre, Service compris, 2017 [8]
- Un député à l’hôpital psychiatrique, François Ruffin, Fakir, 2017 [9]
- Faux départ, Marion Messina, Le Dilettante, 2017 [10]
La presse, meilleure caution du capitalisme [1]
 En 2016, l’ex-directrice adjointe de Marianne et de L’Obs faisait sensation avec Le Monde libre. Dans cet essai écrit après son renvoi idéologique – car jugée “trop radicale” pour ces soc-dem convertis au libéralisme –, la journaliste faisait état d’une presse, principalement de gauche, très mal en point. Un récit bien écrit et percutant qui lui a permis d’obtenir le Prix Renaudot essai. Un an après, elle remet le couvert avec l’excellent La pensée en otage.
En 2016, l’ex-directrice adjointe de Marianne et de L’Obs faisait sensation avec Le Monde libre. Dans cet essai écrit après son renvoi idéologique – car jugée “trop radicale” pour ces soc-dem convertis au libéralisme –, la journaliste faisait état d’une presse, principalement de gauche, très mal en point. Un récit bien écrit et percutant qui lui a permis d’obtenir le Prix Renaudot essai. Un an après, elle remet le couvert avec l’excellent La pensée en otage.
Aude Lancelin, qui accuse les journalistes de compromission volontaire ou non avec le système, s’attaque à sept fausses vérités répandues sur les médias : « les actionnaires de médias “n’interviennent” pas » ; « on ne peut pas se passer de ces grands capitaux privés » ; « critiquer les médias, c’est attaquer les personnes » ; « il y a de la diversité, “les médias” ça n’existe pas » ; « les journalistes doivent être neutres » ; « les journalistes sont par définition des forces démocratiques, à défendre quoi qu’il arrive » ; « les médias ne peuvent pas grand-chose ».
De quoi à la fois tordre le cou à des clichés trop répandus sur les médias, mais aussi tracer les contours d’une presse qui serait un vrai contre-pouvoir. La journaliste perçoit néanmoins un conformisme de classe chez les journalistes, déjà pointé par François Ruffin dans Les petits soldats du journalisme en 2003, et la capitulation vis-à-vis du Capital. À travers ce livre, Lancelin nous montre à la fois pourquoi la presse est aujourd’hui la meilleure garante du système et pourquoi elle va si mal.
Littérature du ghetto [2]
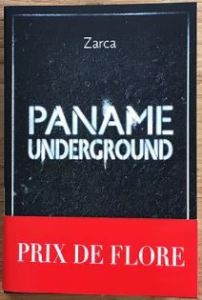 Jehan-Rictus, Louis-Ferdinand Céline ou Renaud, dans des styles très différents ont donné à l’argot ses lettres de noblesses. Bien qu’il ne semble en aucun cas s’être inspiré d’eux, Zarca est leur digne successeur. Ayant commencé à partagé ses textes en 2014 via son blog Le Mec de l’Underground puis avec son premier roman Le boss de Boulogne, paru aux éditions Don Quichotte, Zarca est aujourd’hui un écrivain reconnu. Fin 2017, il publie Paname underground, qui réussit à « fister » le prix de Flore, en compagnie de Pierre Ducrozet.
Jehan-Rictus, Louis-Ferdinand Céline ou Renaud, dans des styles très différents ont donné à l’argot ses lettres de noblesses. Bien qu’il ne semble en aucun cas s’être inspiré d’eux, Zarca est leur digne successeur. Ayant commencé à partagé ses textes en 2014 via son blog Le Mec de l’Underground puis avec son premier roman Le boss de Boulogne, paru aux éditions Don Quichotte, Zarca est aujourd’hui un écrivain reconnu. Fin 2017, il publie Paname underground, qui réussit à « fister » le prix de Flore, en compagnie de Pierre Ducrozet.
Alors qu’il veut rédiger un guide de l’underground parisien, Zarca perd sa “sœur” de cœur, Dina – à laquelle est dédié le roman –, et est victime d’une tentative d’assassinat. Des événements qui l’emmènent dans des aventures palpitantes entre Belleville, Stalingrad, Châtelet, Bezbar, etc. À la fois trash – la violence, le sexe et la drogue sont omniprésents – et écrit dans un argot toujours bien maîtrisé et jamais relou, ce roman, où il est très difficile de dire où s’arrête l’autobiographie et où commence la fiction, nous captive du début à la fin.
K.B.V.
Le programme commun de Natacha Polony [3]
 « Le révolutionnaire a la volonté de “transformer le monde” (Marx) alors que le révolté veut “changer la vie” (Rimbaud) », explique Albert Camus dans L’Homme révolté. Pour André Breton, « ces deux mots d’ordre […] n’en font qu’un ». Natacha Polony a choisi de réutiliser le mot d’ordre rimbaldien repris par Mitterrand en 1981 pour défendre une « alternative » à notre société, minée par la progression du capitalisme et de l’individualisme libéral.
« Le révolutionnaire a la volonté de “transformer le monde” (Marx) alors que le révolté veut “changer la vie” (Rimbaud) », explique Albert Camus dans L’Homme révolté. Pour André Breton, « ces deux mots d’ordre […] n’en font qu’un ». Natacha Polony a choisi de réutiliser le mot d’ordre rimbaldien repris par Mitterrand en 1981 pour défendre une « alternative » à notre société, minée par la progression du capitalisme et de l’individualisme libéral.
La chroniqueuse s’attache à redonner un sens à des mots de moins en moins compris, comme “aliénation”, “démocratie”, “république”, “autonomie”, “bien commun”, “socialisme”, “lutte des classes”, ”laïcité” ou “globalisation”, afin de défendre une « société vivable ». Pour « reconquérir nos vies », elle nous recommande d’“aimer”, de “combattre”, d’“habiter le monde”, de “s’enraciner” ou encore de “vieillir”. À travers ce livre, Polony essaie donc de tracer une alternative au capitalisme mondialisé, qui passe par la république, la démocratie, la décroissance et le socialisme, le tout avec des références qui sont chères au Comptoir (Orwell, Michéa, Ellul et Castoriadis pour ne citer qu’eux). Alors certes, on pourra toujours, et à juste titre, reprocher à la journaliste de participer au système qu’elle dénonce. On peut néanmoins lui accorder le mérite d’avoir une grande cohérence dans les idées qu’elle défend.
K.B.V.
Quand le rap rencontre la poésie populaire [4]
 C’est l’histoire d’une rencontre improbable. À ma gauche, Jehan-Rictus, poète populaire, qui écrit en argot parisien, disparu en 1933. À ma droite, Vîrus, rappeur de Rouen, connu dans le milieu underground depuis une dizaine d’années et reconnu pour la qualité de ses textes et son personnage asocial. Le résultat est un véritable ovni, oscillant entre musique et poésie.
C’est l’histoire d’une rencontre improbable. À ma gauche, Jehan-Rictus, poète populaire, qui écrit en argot parisien, disparu en 1933. À ma droite, Vîrus, rappeur de Rouen, connu dans le milieu underground depuis une dizaine d’années et reconnu pour la qualité de ses textes et son personnage asocial. Le résultat est un véritable ovni, oscillant entre musique et poésie.
« Au hasard – auquel je ne crois pas – d’une itinérance, parmi de semblables, sans but, quelques mots m’interpellent à plus d’un titre. […] Et… je remarque que le Pauvre se présente fier, digne, majusculé », écrit le MC normand. Voilà comment il décide de reprendre le recueil le plus célèbre de Jehan-Rictus, Les soliloques du Pauvre, et d’adapter huit de ses textes en rap, avec l’aide du comédien Jean-Claude Dreyfus. Les morceaux sont repris dans ce livre préfacé par Benoît Dufau, spécialiste du poète, accompagné d’un texte du rappeur, de notes, d’un glossaire et de la lettre de Rictus à Léon Bloy. Vîrus trace un joli trait d’union entre un certain rap et une certaine poésie populaire, et remet au goût du jour un grand artiste trop méconnu.
« Plus vrai qu’nature/ À chacun sa littérature/ Y a rien d’plus naturel que de vouloir voir l’bout du tunnel/ Quand on n’touche la fortune qu’avec nos prunelles… » Vîrus, Freestyle, 2000
K.B.V.
Le premier conte de fée moderne [5]
 William Morris est surtout connu de nos jours pour ses écrits politiques. Mais le socialiste de la fin du XIXe siècle fut aussi peintre, architecte, typographe, artisan et romancier. C’est cette dernière facette qui nous intéressera aujourd’hui, dans le sillage de la réédition de La Source au bout du monde paru chez Libretto en octobre 2017, un ouvrage souvent présenté comme le premier roman de fantasy de l’histoire de la littérature.
William Morris est surtout connu de nos jours pour ses écrits politiques. Mais le socialiste de la fin du XIXe siècle fut aussi peintre, architecte, typographe, artisan et romancier. C’est cette dernière facette qui nous intéressera aujourd’hui, dans le sillage de la réédition de La Source au bout du monde paru chez Libretto en octobre 2017, un ouvrage souvent présenté comme le premier roman de fantasy de l’histoire de la littérature.
Dans ce long texte – deux tomes pour plus de 800 pages – qui, dit-on, a inspiré les écrits de Tolkien, Morris narre les aventures de Rodolphe, fils cadet du roi des Haults-Prés, un royaume imaginaire dont il s’enfuit pour croiser le fer avec de nombreux ennemis et gagner le cœur des jouvencelles qui croisent son chemin. Sur son chemin, il rencontre inévitablement de nombreux dangers, de vrais ennemis, de faux amis mais aussi des compagnons qui l’aideront à mener sa quête de la Source au bout du monde, dont l’eau miraculeuse est réputée régénérer les corps.
Si ce roman n’est peut-être pas, comme l’insinue la maison d’édition, le premier roman de fantasy jamais écrit, nul doute qu’il a posé un certain nombre de motifs littéraires pour la postérité du genre : un chevalier errant, une quête, des éléments fantastiques dans un décor médiéval. Cependant, on sent que William Morris n’a pas voulu faire fi de toute réalité dans sa fiction : le christianisme y existe bel et bien, régissant les âmes et les consciences, et l’auteur se positionne dans le même registre moral que celui d’un Voltaire avec son Candide. Au fur et à mesure des épreuves, le héros grandit, et sa force ne décuple qu’à mesure où il progresse dans la connaissance de ses semblables.
Malgré quelques longueurs et répétitions, La Source au bout du monde a dû passer par bien des mains et inspirer nombre d’auteurs. En cela, il est peut-être, à tout le moins, l’un des contes de fée modernes les plus achevés pour son époque de publication. Du Seigneur des Anneaux à la franchise de jeux vidéos Zelda, en passant par les manga shônen, les bases narratives que William Morris y a construit sont désormais immortelles.
Noé Roland
Construire une alternative démocratique [6]
 Et si la ville était le lieu où pouvait se jouer la contestation au capitalisme ? C’est la question que pose Jonathan Durand Folco, philosophe et professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Certes, il n’ignore pas qu’avec la métropolisation, la ville est un lieu de flux capitalistes, où la lutte de classes s’accompagne d’une lutte pour l’espace qui relègue les classes subalternes à la périphérie. Pourtant, après une analyse rigoureuse de notre système économique, qui repose sur cinq piliers, à savoir « les classes, le marché, l’accumulation, l’appropriation et l’accélération », il en conclut à la nécessité de renouer avec le municipalisme.
Et si la ville était le lieu où pouvait se jouer la contestation au capitalisme ? C’est la question que pose Jonathan Durand Folco, philosophe et professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Certes, il n’ignore pas qu’avec la métropolisation, la ville est un lieu de flux capitalistes, où la lutte de classes s’accompagne d’une lutte pour l’espace qui relègue les classes subalternes à la périphérie. Pourtant, après une analyse rigoureuse de notre système économique, qui repose sur cinq piliers, à savoir « les classes, le marché, l’accumulation, l’appropriation et l’accélération », il en conclut à la nécessité de renouer avec le municipalisme.
Le livre est presque entièrement tourné vers cette idée de créer une opposition politique québécoise qui reposerait sur l’idée d’auto-gouvernement des villes par les citoyens. S’il ne plaide pas pour un parti, mais pour une plateforme citoyenne – le Réseau d’action municipal (RAM) qui regrouperait des Groupes d’action municipale (GAM) –, il défend également la participation aux élections… municipales. Une manière originale de sortir du capitalisme, qui diffère des méthodes traditionnelles. Ainsi, l’objectif de Folco, défenseur d’un patriotisme républicain et communal, est de créer une République universelle, qui s’inspirerait autant de l’Athènes antique, des communes du Moyen Âge, des cités italiennes de la Renaissance que de la Commune de Paris de 1871.
Pour l’auteur, le municipalisme devrait également s’appuyer sur les communs, afin de sortir à la fois de la propriété privée et de la propriété étatique. Folco mobilise l’exemple kurde du Rojava et les mairies rebelles espagnoles pour montrer que le municipalisme peut effectivement constituer une alternative à l’ordre néolibéral. On regrettera néanmoins que la souveraineté nationale, pourtant très importante au Québec, reste un angle mort de la réflexion, que la fausse bonne idée du revenu de base — meilleur allié de l’ubérisation de la société — soit reprise, et un peu de naïveté sur les mouvements d’occupation des places. Un très bon livre néanmoins, agrémenté de belles références à Antonio Gramsci, Murray Bookchin, ou encore Walter Benjamin.
K. B. V.
Heavy metal : vers la fin du mythe ? [7]
 Les musiques extrêmes en tant que phénomène culturel ont depuis toujours dépassé les bornes de la seule mélomanie. En effet, l’artiste heavy metal a pendant longtemps représenté une figure quasi divine pour nombre de fans de tous les sous-genres de cette musique.
Les musiques extrêmes en tant que phénomène culturel ont depuis toujours dépassé les bornes de la seule mélomanie. En effet, l’artiste heavy metal a pendant longtemps représenté une figure quasi divine pour nombre de fans de tous les sous-genres de cette musique.
C’est sur cette thématique de la mythification de l’artiste metal que nous invite à réfléchir Nicolas Bénard dans son nouvel ouvrage publié chez Camion Blanc. En s’appuyant sur un large corpus de magazines francophones des années 1980 à aujourd’hui et sur des exemples célèbres (Motörhead, Iron Maiden, Motley Crüe ou encore Black Sabbath), l’historien démontre que les musiciens metal les plus célèbres font l’objet d’un véritable culte de la part de leurs fans, culte qu’ils ont pendant longtemps entretenu avec la complaisance des journalistes. L’importance de l’image de l’artiste et de la mise en scène de la musique dans les scènes extrêmes est pointée dans cette perspective. Cependant, Bénard insiste sur le fait que ce culte s’est étiolé au fil du temps, témoignant d’une progressive pipolisation des musiques extrêmes et de la représentation de leurs acteurs dans les médias spécialisés. Désormais, les légendes d’hier s’exhibent dans leur quotidien et redeviennent des individus comme les autres lorsqu’elles laissent tomber leur masque scénique, à l’instar d’Ozzy Osbourne qui a été l’acteur d’une téléréalité centrée sur sa vie familiale. La conséquence principale de ce constat concerne l’artiste lui-même, dont le rôle semble muter au sein de nos sociétés post-modernes.
Rupture avec l’imaginaire du héros musicien ou prolongement logique de l’héroïsation par un narcissisme exacerbé et un marketing du quotidien? Si Nicolas Bénard refuse de répondre clairement, il soulève en tout cas la question, qui mériterait d’être étendue à tous les autres genres musicaux, ainsi qu’à d’autres sphères culturelles comme le cinéma.
N. R.
Le transhumanisme n’est pas un humanisme [8]
« La coexistence entre des gens extrêmement intelligents grâce à la technologie et des gens qui ont les capacités intellectuelles moyennes d’aujourd’hui ne peut pas être harmonieuse. Y a-t-il une cohabitation harmonieuse entre les chimpanzés et les hommes ? Non, nous les mettons dans des zoos. » prévenait le (futur)urologue Laurent Alexandre le 13 février 2017 sur Arte. Annonçant la couleur et sans autre forme de procès, le transhumanisme se porte à merveille. C’est sans compter le travail d’enquête et de critique que mène Pièces et Main d’œuvre (PMO) depuis 2002. Le collectif grenoblois a auto-édité (comme nous au Comptoir !) et signé à l’automne 2017, son Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme. Cités dans le texte, les technolâtres et leur haine de l’humain sont mis au pilori. Exemples à l’appui, PMO nous démontre que Le meilleur des mondes est déjà largement sur les rails. La plume trempée dans l’acide, le verbe haut, les détectives de PMO mordent (avec des dents non prothétiques) et nous offrent ainsi l’encyclopédie des arguments contre les inhumains.
L’une des principales pierres d’achoppement de cette somme est l’affirmation que la technologie n’est pas neutre. Contre ceux qui pensent encore que le ver n’est pas dans le fruit et qu’il ne tient qu’à nous de le manger ou pas, ils rappellent entre milles autres piques qu’il suffit d’imaginer un instant la vie sans téléphone portable pour en douter (et la difficulté d’être en société pour celui qui choisit de ne pas en avoir).
Véritables promoteurs de l’émancipation, ils rappellent avec un bon sens constant que s’émanciper de son pauvre corps, ou des contraintes biologiques pour le soumettre à la technoscience et ses machines est une contradiction dans les termes. À dessein, ils citent Michael Chorost, un homme implanté pour recouvrer l’ouïe : « Lorsqu’un de nos sens devient programmable, peut-on encore avoir confiance dans les informations qu’il nous communique sur le monde extérieur ? Un sens artificiel nous dépossède en partie de notre propre corps. […] Je serai lié à vie à cette compagnie et à sa conception des produits. Toute résistance s’avérerait futile, à moins que je ne veuille redevenir sourd. » Faisant leur l’idée que l’humain est un animal politique, c’est-à-dire un animal qui grandit en se socialisant, il nous font voir à quel point le transhumanisme n’est qu’une négation de l’autre.
Partisans de l’autonomie, jetez vous sur cette nécessaire mise au point pour ouvrir les yeux aux autres membres de notre espèce et ne plus vous laisser enfumer par ceux qui refusent de rester humains. C’est un appel à l’humanité contre l’anthropocide déjà à l’œuvre que scandent les chimpanzés du futur.
Faire revenir la question sociale à l’Assemblée nationale [9]
 Depuis que le journaliste François Ruffin a été élu député de sa circonscription dans la Somme, il s’est inventé un nouveau métier : celui de député-reporter. Paru en décembre 2017 aux éditions Fakir, son ouvrage Un député à l’hôpital psychiatrique propose une enquête sérieuse sur le milieu de la santé psychiatrique, assortie de quelques propositions concrètes pour améliorer le quotidien des soignants et des soignés.
Depuis que le journaliste François Ruffin a été élu député de sa circonscription dans la Somme, il s’est inventé un nouveau métier : celui de député-reporter. Paru en décembre 2017 aux éditions Fakir, son ouvrage Un député à l’hôpital psychiatrique propose une enquête sérieuse sur le milieu de la santé psychiatrique, assortie de quelques propositions concrètes pour améliorer le quotidien des soignants et des soignés.
Dans ce petit livre conçu pour aller droit au but, François Ruffin dresse un constat sans appel à partir de divers témoignages (soignants, membres d’associations de familles de malades…) : les hôpitaux psychiatriques, institutions d’utilité publique, sont actuellement maltraités, à l’image de tout le reste du secteur de la santé en France. Le personnel y est très investi mais se démotive de jour en jour à cause du manque flagrant de moyens financiers et humains. Les burn-out sont fréquents et la résignation est à son comble dans les différents services. Les malades, quant à eux, vivent dans une solitude toujours plus grande, et progressent difficilement. Les inégalités d’accès aux soins selon les régions et les profils socio-économiques n’ont jamais été aussi grandes pour les patients et leurs familles. En guise de conclusion, le député annonce ses propositions : une loi sur le financement de l’hôpital psychiatrique et une loi sur le financement du médico-social, afin de rendre à l’État ses prérogatives dans le domaine et obtenir davantage de moyens pour restaurer la dignité des malades et améliorer le quotidien des personnels.
Pédagogique et donnant la parole à tous les acteurs de terrain, Un député à l’hôpital psychiatrique est autant un livre-témoignage qu’un document de combat. Armé d’une méthode éprouvée, François Ruffin donne tout son sens à la fonction de député en la combinant à celle de l’enquêteur. En effet, grâce à un travail journalistique soutenu, il est l’un des seuls à éclabousser l’Assemblée nationale de ce qu’il appelle des « tranches de réel ». Nul doute que d’autres livres-enquêtes de ce genre suivront bientôt.
N. R.
Chronique du désenchantement contemporain [10]
Le 15 janvier 2018, j’achevais ainsi un article sur le rappeur Orelsan : « Car, si Michel Houellebecq a révélé la détresse sentimentale et spirituelle des pères de la génération Y, Kyan Khojandi et Orelsan ont, eux, dévoilé celle des gosses nés entre les années 1980 et 1990. Il ne manque plus que des alter egos féminins pour compléter le tableau. » Le lendemain, un lecteur commentait alors : « C’est chose faite depuis Faux Départ de Marion Messina (éditions Le Dilettante), un Voyage au bout de la nuit au féminin assaisonné de Plateforme. » Curieux, je me suis aussitôt procuré le roman en question.
 Publié le 23 août 2017, Faux départ est le premier roman de la jeune Marion Messina. Il raconte l’histoire d’Aurélie, fille de prolos vivant dans la banlieue grenobloise. Septembre 2008, alors que la crise économique pointe le bout de son nez, la jeune fille, bercée par le mythe de la méritocratie et rêvant d’ascension sociale, entame des études de droit à l’Université de Grenoble. Appartenant « au camp des éléments neutres, les petits blancs aux yeux baissés et aux bras croisés qui transpirait le malaise », Aurélie va très vite déchanter.
Publié le 23 août 2017, Faux départ est le premier roman de la jeune Marion Messina. Il raconte l’histoire d’Aurélie, fille de prolos vivant dans la banlieue grenobloise. Septembre 2008, alors que la crise économique pointe le bout de son nez, la jeune fille, bercée par le mythe de la méritocratie et rêvant d’ascension sociale, entame des études de droit à l’Université de Grenoble. Appartenant « au camp des éléments neutres, les petits blancs aux yeux baissés et aux bras croisés qui transpirait le malaise », Aurélie va très vite déchanter.
Timide et peu sûre d’elle, elle va se retrouver coincée dans un univers qui ne voulait visiblement pas d’elle, entre les cours sans intérêt, les jobs d’étudiants pour survivre financièrement, « les enfants de bourgeois intégrés à la société de consommation », les garçons élevés aux pornos et les filles superficielles. Un petit rayon de soleil quand même : Alejandro, Colombien à l’âme de poète maudit, arrivé en France pour suivre un M2 de Lettres modernes, dont elle tombe éperdument amoureuse, pour le meilleur et pour le pire. Avec ce roman, Marion Messina nous décrit la précarisation sur tous les plans – économique, intellectuel et affectif – de notre jeunesse et les problèmes que peut rencontrer une jeune femme aujourd’hui, dans un monde où des hommes adulescents veulent jouir, mais plus s’attacher. Un beau début pour celle à qui l’on souhaite maintenant le succès d’Orelsan et Houellebecq !
K.B.V.
Nos Desserts :
- Au Comptoir, nous vous servons aussi depuis 2016 un cocktail de réjouissances imprimées
- Si vous avez encore soif, retrouvez les shots du Comptoir des mois de décembre, novembre et d’octobre 2017
- Nous avions réalisé une sélection de livres à (se faire) offrir pour Noël 2015 et 2016 et 2017
Catégories :Culture, Shots et pop-corns

1 réponse »