 Comparant la séquence historique qui va de la Révolution de février 1848[i] au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 à celle qui va de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 au coup d’État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 (18 Brumaire de l’an VIII), Karl Marx écrit dans son ouvrage Le 18 Brumaire de Louis Napoléon (1852) : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. » Le philosophe allemand souligne par-là qu’en voulant refaire – souvent inconsciemment – l’histoire, nous nous condamnons à la caricaturer. Le spectre qui hante le mouvement Nuit debout n’est plus la Révolution de 1789, ni celle de 1848, ni la Commune de Paris de 1871, mais bien les événements de mai 1968. Or, comme Lordon, nous estimons que « ce serait bien de faire mentir la prophétie marxienne – si l’histoire se répète, que ça ne soit pas comme farce ». Pour cela, il faudrait analyser minutieusement Mai-1968 et comprendre où la rupture est nécessaire.
Comparant la séquence historique qui va de la Révolution de février 1848[i] au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 à celle qui va de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 au coup d’État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 (18 Brumaire de l’an VIII), Karl Marx écrit dans son ouvrage Le 18 Brumaire de Louis Napoléon (1852) : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. » Le philosophe allemand souligne par-là qu’en voulant refaire – souvent inconsciemment – l’histoire, nous nous condamnons à la caricaturer. Le spectre qui hante le mouvement Nuit debout n’est plus la Révolution de 1789, ni celle de 1848, ni la Commune de Paris de 1871, mais bien les événements de mai 1968. Or, comme Lordon, nous estimons que « ce serait bien de faire mentir la prophétie marxienne – si l’histoire se répète, que ça ne soit pas comme farce ». Pour cela, il faudrait analyser minutieusement Mai-1968 et comprendre où la rupture est nécessaire.
« Ils se souviennent au mois de mai,
D’un sang qui coula rouge et noir,
D’une révolution manquée
Qui faillit renverser l’Histoire,
J’me souviens surtout d’ces moutons,
Effrayés par la Liberté,
S’en allant voter par millions
Pour l’ordre et la sécurité. »
Renaud, Hexagone, 1975
Mai-1968 : deux mouvements en un
 Deux sociologies distinctes se révoltent en Mai-1968. À côté du prolétariat, héros “naturel” de tout mouvement social depuis l’émergence du mouvement ouvrier au XIXe siècle, un nouvel acteur apparaît sur le devant de la scène. Il s’agit de la jeunesse étudiante issue des nouvelles classes moyennes éduquées. Le sociologue Michel Clouscard définit ces dernières dans Les métamorphoses de la lutte des classes (Le Temps des Cerises, 1996) comme l’ensemble des « catégories sociales qui subissent à la fois la confiscation de la plus-value en tant que producteurs et l’injonction de consommation en tant que consommateurs ». Il qualifie la révolte étudiante de Mai-68 de « 1789 des classes moyennes ». Même si le parallèle atteint rapidement ses limites[ii], il nous permet de comprendre la spécificité de ce mouvement. Mai-1968 est en partie le fruit des mutations sociales opérées depuis le plan Marshall. En “aidant” les pays européens, les Américains permettent surtout au Vieux Continent d’accéder à leur modèle consumériste, qui entre en conflit avec le capitalisme d’État ayant cours à l’époque. Un nouveau marché du désir voit le jour, ainsi qu’une nouvelle classe moyenne, issue du prolétariat. C’est ce qui explique que des soulèvements d’étudiants éclosent à la même époque dans plusieurs autres pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Japon.
Deux sociologies distinctes se révoltent en Mai-1968. À côté du prolétariat, héros “naturel” de tout mouvement social depuis l’émergence du mouvement ouvrier au XIXe siècle, un nouvel acteur apparaît sur le devant de la scène. Il s’agit de la jeunesse étudiante issue des nouvelles classes moyennes éduquées. Le sociologue Michel Clouscard définit ces dernières dans Les métamorphoses de la lutte des classes (Le Temps des Cerises, 1996) comme l’ensemble des « catégories sociales qui subissent à la fois la confiscation de la plus-value en tant que producteurs et l’injonction de consommation en tant que consommateurs ». Il qualifie la révolte étudiante de Mai-68 de « 1789 des classes moyennes ». Même si le parallèle atteint rapidement ses limites[ii], il nous permet de comprendre la spécificité de ce mouvement. Mai-1968 est en partie le fruit des mutations sociales opérées depuis le plan Marshall. En “aidant” les pays européens, les Américains permettent surtout au Vieux Continent d’accéder à leur modèle consumériste, qui entre en conflit avec le capitalisme d’État ayant cours à l’époque. Un nouveau marché du désir voit le jour, ainsi qu’une nouvelle classe moyenne, issue du prolétariat. C’est ce qui explique que des soulèvements d’étudiants éclosent à la même époque dans plusieurs autres pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Japon.
Cependant, le mouvement social est proprement français. Déclenchée le 13 mai 1968 par la CGT, une grève générale d’une ampleur exceptionnelle en Europe – dix millions de grévistes – paralyse le pays. Si des jonctions partielles entre les deux mouvements ont ponctuellement lieu, le Mai-1968 étudiant et le Mai-1968 ouvrier ne réussiront jamais à se rejoindre. Les grévistes de l’usine de Renault-Billancourt vont même jusqu’à fermer leurs portes aux étudiants venus les soutenir. La mainmise du PCF et de la CGT sur le mouvement ouvrier n’est pas étrangère à cela. Effrayés par la concurrence gauchiste, le parti et le syndicat empêchent toute convergence des luttes. L’autre partie du problème provient du fait que les revendications étudiantes ne parlent pas aux travailleurs.
« Et rien à foutre de vos modèles de vie post-1968
La liberté de consommer ne sera pas sans suite. »
Lucio Bukowski, Posca Sec (avec Anton Serra), 2015
Du Mai-1968 étudiant au “nouvel esprit du capitalisme”
 La fin des années 1960 correspond au moment où les premières générations du baby-boom ont 20 ans et accèdent en masse à l’université (500 000 étudiants en 1968, contre 150 000 dix ans auparavant). Or, elles ne veulent plus vivre comme leurs parents, étouffés par un traditionalisme oppresseur et omniprésent à tous les niveaux de la société. Les prémices du soulèvement sont célèbres. Une vulgaire affaire de mœurs. Dans la toute jeune université de Nanterre, des garçons tentent de pénétrer dans les dortoirs des filles. L’un de leurs représentants, Daniel Cohn-Bendit – qui n’est pas encore “Dany le Rouge” – interpelle le ministre de la Jeunesse et des Sports, François Missoffe, sur le désir des jeunes de vivre leur sexualité et se voit conseiller d’aller piquer un plongeon dans la piscine. La révolte étudiante naît alors. Ce que l’histoire oublie souvent de mentionner, ce sont les origines idéologiques de tout cela.
La fin des années 1960 correspond au moment où les premières générations du baby-boom ont 20 ans et accèdent en masse à l’université (500 000 étudiants en 1968, contre 150 000 dix ans auparavant). Or, elles ne veulent plus vivre comme leurs parents, étouffés par un traditionalisme oppresseur et omniprésent à tous les niveaux de la société. Les prémices du soulèvement sont célèbres. Une vulgaire affaire de mœurs. Dans la toute jeune université de Nanterre, des garçons tentent de pénétrer dans les dortoirs des filles. L’un de leurs représentants, Daniel Cohn-Bendit – qui n’est pas encore “Dany le Rouge” – interpelle le ministre de la Jeunesse et des Sports, François Missoffe, sur le désir des jeunes de vivre leur sexualité et se voit conseiller d’aller piquer un plongeon dans la piscine. La révolte étudiante naît alors. Ce que l’histoire oublie souvent de mentionner, ce sont les origines idéologiques de tout cela.
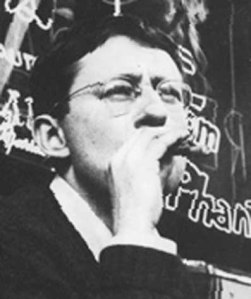 En 1966, l’Union nationale des étudiants de France (Unef) publie l’excellent De la misère en milieu étudiant, un pamphlet politique écrit « par des membres de l’Internationale situationniste (IS) et des étudiants de Strasbourg » dont l’auteur serait en fait un des membres les plus éminents de l’IS : Mustapha Khayati. Cette brochure, qui provoque le “scandale de Strasbourg”, jette les jalons de la révolte étudiante. L’année d’après, un autre situationniste s’adresse à la jeunesse. Il s’agit de Raoul Vaneigem avec son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Enfin, le chef de file de l’IS, Guy Debord, publie son ouvrage phare, La société du spectacle, en 1967[iii]. Les théories des marxistes de l’École de Francfort (notamment celles de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno et Herbert Marcuse), du marxiste libertaire Henri Lefebvre, professeur à l’université de Nanterre durant les faits, ou encore de la revue conseilliste Socialisme ou barbarie (1949-1967), fondée par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, influencent également les étudiants de l’époque.
En 1966, l’Union nationale des étudiants de France (Unef) publie l’excellent De la misère en milieu étudiant, un pamphlet politique écrit « par des membres de l’Internationale situationniste (IS) et des étudiants de Strasbourg » dont l’auteur serait en fait un des membres les plus éminents de l’IS : Mustapha Khayati. Cette brochure, qui provoque le “scandale de Strasbourg”, jette les jalons de la révolte étudiante. L’année d’après, un autre situationniste s’adresse à la jeunesse. Il s’agit de Raoul Vaneigem avec son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Enfin, le chef de file de l’IS, Guy Debord, publie son ouvrage phare, La société du spectacle, en 1967[iii]. Les théories des marxistes de l’École de Francfort (notamment celles de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno et Herbert Marcuse), du marxiste libertaire Henri Lefebvre, professeur à l’université de Nanterre durant les faits, ou encore de la revue conseilliste Socialisme ou barbarie (1949-1967), fondée par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, influencent également les étudiants de l’époque.
Les revendications sociétales cohabitent donc avec un idéal social. Mai-1968 rassemble aussi bien des petits bourgeois individualistes qui rêvent de s’insérer dans le capitalisme – ce qui explique que beaucoup de figures du mouvement sont devenues des ardents défenseurs de l’ordre établi, à commencer par “Dany le Rouge” – que de vrais radicaux, cherchant à faire revivre la Commune de 1871. Les Enragés, groupe d’étudiants influencé par le situationnisme et créé en février 1968 autour de la figure de René Riesel[iv], actif au sein du Mouvement du 22-Mars[v] avant de rompre avec lui, représente cette seconde tendance. Marqués par l’hédonisme[vi] et l’individualisme, ces révoltés, rejoignant en cela les bourgeois individualistes, ont le malheur de croire que les valeurs traditionnelles dans leur ensemble sont toutes garantes de l’ordre bourgeois et du capitalisme, alors que certaines constituaient en réalité un frein à la logique libérale. Jacques Julliard relève d’ailleurs que les militants de Mai-1968 « ne se sont pas avisés que ces valeurs (honneur, solidarité, héroïsme) étaient, aux étiquettes près, les mêmes que celles du socialisme, et qu’en les supprimant, ils ouvraient la voie au triomphe des valeurs bourgeoises : individualisme, calcul rationnel, efficacité ».
 Les soixante-huitards ont finalement contribué malgré eux à l’avènement de ce que Luc Boltanski et Ève Chiapello ont nommé le « nouvel esprit du capitalisme » (Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999). Comme le montrent les deux sociologues, en intégrant sa critique soixante-huitarde, le capitalisme a réussi à se renouveler en troquant l’ancien fordisme rigide contre une organisation en réseau, génératrice pour certains d’une plus grande liberté au travail, pour d’autres d’une plus grande précarité, et pour tous d’un asservissement accru à l’entreprise. Clouscard parle quant à lui de « social-démocratie libertaire » ou de « libéralisme libertaire », car ce nouveau système est né de « l’alliance sournoise du libéral et du libertaire », représentée par Pompidou, remplaçant De Gaulle à partir de 1969, et Cohn-Bendit. Pour le marxiste, le libéralisme-libertaire, qui pourrait se résumer par la formule « tout est permis, mais rien n’est possible » (Néo-fascisme et idéologie du désir, 1973), substitue le désir à la répression et aboutit au consentement des exploités. Mai-1968 est devenu ainsi un double modèle : il est à la fois le modèle révolutionnaire de la gauche radicale actuelle, mais c’est également la source du modèle de société que nous connaissons aujourd’hui.
Les soixante-huitards ont finalement contribué malgré eux à l’avènement de ce que Luc Boltanski et Ève Chiapello ont nommé le « nouvel esprit du capitalisme » (Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999). Comme le montrent les deux sociologues, en intégrant sa critique soixante-huitarde, le capitalisme a réussi à se renouveler en troquant l’ancien fordisme rigide contre une organisation en réseau, génératrice pour certains d’une plus grande liberté au travail, pour d’autres d’une plus grande précarité, et pour tous d’un asservissement accru à l’entreprise. Clouscard parle quant à lui de « social-démocratie libertaire » ou de « libéralisme libertaire », car ce nouveau système est né de « l’alliance sournoise du libéral et du libertaire », représentée par Pompidou, remplaçant De Gaulle à partir de 1969, et Cohn-Bendit. Pour le marxiste, le libéralisme-libertaire, qui pourrait se résumer par la formule « tout est permis, mais rien n’est possible » (Néo-fascisme et idéologie du désir, 1973), substitue le désir à la répression et aboutit au consentement des exploités. Mai-1968 est devenu ainsi un double modèle : il est à la fois le modèle révolutionnaire de la gauche radicale actuelle, mais c’est également la source du modèle de société que nous connaissons aujourd’hui.
« Ce que nous demanderions à la révolution, c’est l’abolition de l’oppression sociale ; mais pour que cette notion ait au moins des chances d’avoir une signification quelconque, il faut avoir soin de distinguer entre oppression et subordination des caprices individuels à un ordre social. »
Simone Weil, Réflexions sur la liberté et l’oppression, 1934
Nuit debout, mouvement post-soixante-huitard
 Toujours dans Le 18 Brumaire de Louis Napoléon, Marx note que « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. » S’il est faux de croire comme Éric Zemmour que Mai-1968 a été une « révolution encore plus importante que 1789 » et est responsable de « la grande destruction de la France », il paraît évident que le monde que nous connaissons aujourd’hui a été en partie forgé par lui. De même, s’ils ne sont pas nécessairement des héritiers biologiques des soixante-huitards, les Nuitdeboutistes s’inscrivent quand même dans leurs pas. Le soutien du sociologue et philosophe Edgar Morin à Nuit debout, déjà avocat de la jeunesse insurgée en 68, est le parfait symbole de ce passage de témoin. La liberté totale des prises de parole en assemblées générales, souvent plus orientées sur des préoccupations personnelles que sur l’intérêt commun, et la prolifération des commissions en tout genre rappellent le déroulement de Mai-68, caractérisé par une frénésie des tours de parole et la multiplication abusive des débats, symptôme d’un individualisme naissant. Le festivisme, parfois moqué par les détracteurs du mouvement, est une conséquence directe de l’hédonisme soixante-huitard. Ensuite, le « Tout le monde déteste la police », chanté pendant les affrontements avec les forces de l’ordre prolonge le « CRS-SS » de Mai-68. La défiance à l’égard des structures politiques traditionnelles (partis et syndicats) est également un héritage de 1968. Enfin, le mouvement Nuit debout est majoritairement constitué d’étudiants ou de jeunes (très) diplômés.
Toujours dans Le 18 Brumaire de Louis Napoléon, Marx note que « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. » S’il est faux de croire comme Éric Zemmour que Mai-1968 a été une « révolution encore plus importante que 1789 » et est responsable de « la grande destruction de la France », il paraît évident que le monde que nous connaissons aujourd’hui a été en partie forgé par lui. De même, s’ils ne sont pas nécessairement des héritiers biologiques des soixante-huitards, les Nuitdeboutistes s’inscrivent quand même dans leurs pas. Le soutien du sociologue et philosophe Edgar Morin à Nuit debout, déjà avocat de la jeunesse insurgée en 68, est le parfait symbole de ce passage de témoin. La liberté totale des prises de parole en assemblées générales, souvent plus orientées sur des préoccupations personnelles que sur l’intérêt commun, et la prolifération des commissions en tout genre rappellent le déroulement de Mai-68, caractérisé par une frénésie des tours de parole et la multiplication abusive des débats, symptôme d’un individualisme naissant. Le festivisme, parfois moqué par les détracteurs du mouvement, est une conséquence directe de l’hédonisme soixante-huitard. Ensuite, le « Tout le monde déteste la police », chanté pendant les affrontements avec les forces de l’ordre prolonge le « CRS-SS » de Mai-68. La défiance à l’égard des structures politiques traditionnelles (partis et syndicats) est également un héritage de 1968. Enfin, le mouvement Nuit debout est majoritairement constitué d’étudiants ou de jeunes (très) diplômés.
 Pourtant, la sociologie n’est plus exactement la même. Si les médias de droite n’ont pas de mots assez durs contre ces “bobos”, nous n’avons en aucun cas affaire aux « fils à papa » que Pier Paolo Pasolini raillait en Mai-1968. Certes, les participants de Nuit debout sont généralement diplômés. Mais il faut préciser, comme le fait l’anthropologue Emmanuel Todd dans Fakir, que « les jeunes diplômés du supérieur, c’est désormais 40 % d’une tranche d’âge. Ce n’est plus une minorité privilégiée, c’est la masse. » Ravageant les classes populaires au sens strict – ouvriers et employés – depuis les années 1980, la mondialisation néolibérale attaque désormais les classes éduquées, condamnées elles aussi au chômage et à la précarité. Todd résume le problème ainsi : « il faut comprendre, faire comprendre, que les stages à répétition, les boulots pourris dans les bureaux, les sous-paies pour des surqualifications, c’est la même chose que la fermeture des usines, que la succession d’intérim pour les jeunes de milieu populaires. La baisse du niveau de vie, c’est pour toute une génération. » Interrogée sur les “jeunes bobos”, la sociologue Anne Steiner, spécialiste de l’anarchisme, s’insurge contre l’abus du mot qui décrit surtout « des jeunes diplômés qui gagnent 1500 euros par mois et qui se contentent de toutes petites surfaces, d’habiter ces quartiers de l’Est parisien », avant de conclure qu’« il faut accepter l’idée que le peuple c’est aussi cette jeunesse qui enchaîne les CDD, les stages, les statuts d’intermittents. » Ajoutons au tableau qu’actuellement, plus de 70 % des étudiants sont contraints de travailler pour financer leurs études. Il semblerait finalement que ces bobos n’aient rien de bourgeois[vii].
Pourtant, la sociologie n’est plus exactement la même. Si les médias de droite n’ont pas de mots assez durs contre ces “bobos”, nous n’avons en aucun cas affaire aux « fils à papa » que Pier Paolo Pasolini raillait en Mai-1968. Certes, les participants de Nuit debout sont généralement diplômés. Mais il faut préciser, comme le fait l’anthropologue Emmanuel Todd dans Fakir, que « les jeunes diplômés du supérieur, c’est désormais 40 % d’une tranche d’âge. Ce n’est plus une minorité privilégiée, c’est la masse. » Ravageant les classes populaires au sens strict – ouvriers et employés – depuis les années 1980, la mondialisation néolibérale attaque désormais les classes éduquées, condamnées elles aussi au chômage et à la précarité. Todd résume le problème ainsi : « il faut comprendre, faire comprendre, que les stages à répétition, les boulots pourris dans les bureaux, les sous-paies pour des surqualifications, c’est la même chose que la fermeture des usines, que la succession d’intérim pour les jeunes de milieu populaires. La baisse du niveau de vie, c’est pour toute une génération. » Interrogée sur les “jeunes bobos”, la sociologue Anne Steiner, spécialiste de l’anarchisme, s’insurge contre l’abus du mot qui décrit surtout « des jeunes diplômés qui gagnent 1500 euros par mois et qui se contentent de toutes petites surfaces, d’habiter ces quartiers de l’Est parisien », avant de conclure qu’« il faut accepter l’idée que le peuple c’est aussi cette jeunesse qui enchaîne les CDD, les stages, les statuts d’intermittents. » Ajoutons au tableau qu’actuellement, plus de 70 % des étudiants sont contraints de travailler pour financer leurs études. Il semblerait finalement que ces bobos n’aient rien de bourgeois[vii].
Cette précarité des Nuitdeboutistes a évidemment des conséquences politiques, même si certains habitus petits-bourgeois demeurent. Influencée par Lordon et François Ruffin, une large partie des militants a compris que la « mondialisation heureuse » d’Alain Minc n’est qu’un mythe élitiste et que l’Union européenne n’est synonyme ni de paix ni de prospérité. Les termes “peuples”, “communs” et “souveraineté” ne sont plus des gros mots. Le mouvement tente également de créer un “être-ensemble”, qui tranche avec l’atomisation de la société en individus séparés les uns des autres, et un nouveau mode de fonctionnement alternatif. C’est pour cela qu’une partie de la gauche conteste Nuit debout, à l’image du jeune foucaldien Geoffroy de Lagasnerie. Le sociologue estime qu’« à travers des concepts comme “le peuple ”, “le commun”, la politique contestataire [de Nuit debout] tend à cultiver de curieux fantasmes d’appartenance et d’inclusion. » En bon individualiste, il déplore qu’« au prétexte de la lutte contre le néolibéralisme, une humeur idéologique s’installe qui érige comme forces négatives la dissidence et la liberté individuelle et vise à régénérer des pulsions d’ordre dans la gauche. »
 Cependant, si la gauche radicale, qui a donné naissance à Nuit debout, n’est pas aussi extrême que Lagasnerie, elle souffre souvent des mêmes maux idéologiques. Dans La Double pensée – retour sur la question libérale (Climats, 2008), Jean-Claude Michéa parle d’une « contre-révolution dans la révolution », qui s’est opérée après Mai-1968, avec pour conséquence « de liquider progressivement la contestation anticapitaliste en substituant partout à la vieille question sociale (tenue à présent pour grise et archaïque) le seul combat festif et multicolore, pour “l’évolution des mœurs”. » La raison est, selon lui, « qu’à la séquence Lukács – École de Francfort – Socialisme ou barbarie – Henri Lefebvre – Internationale situationniste, on a vu très vite succéder (cette évolution a été particulièrement nette dans le milieu universitaire où la lutte pour les places est toujours très vive) la séquence Althusser – Bourdieu – Foucault – Deleuze – Derrida. » Or, pour le philosophe libertaire, « autant la première séquence, quelles que soient ses limites, avait rendu possible une critique radicale du mode de vie capitaliste, autant les constructions idéologiques de la seconde allaient pouvoir être retournées avec une facilité déconcertante au profit des nouvelles dynamiques libérales. »
Cependant, si la gauche radicale, qui a donné naissance à Nuit debout, n’est pas aussi extrême que Lagasnerie, elle souffre souvent des mêmes maux idéologiques. Dans La Double pensée – retour sur la question libérale (Climats, 2008), Jean-Claude Michéa parle d’une « contre-révolution dans la révolution », qui s’est opérée après Mai-1968, avec pour conséquence « de liquider progressivement la contestation anticapitaliste en substituant partout à la vieille question sociale (tenue à présent pour grise et archaïque) le seul combat festif et multicolore, pour “l’évolution des mœurs”. » La raison est, selon lui, « qu’à la séquence Lukács – École de Francfort – Socialisme ou barbarie – Henri Lefebvre – Internationale situationniste, on a vu très vite succéder (cette évolution a été particulièrement nette dans le milieu universitaire où la lutte pour les places est toujours très vive) la séquence Althusser – Bourdieu – Foucault – Deleuze – Derrida. » Or, pour le philosophe libertaire, « autant la première séquence, quelles que soient ses limites, avait rendu possible une critique radicale du mode de vie capitaliste, autant les constructions idéologiques de la seconde allaient pouvoir être retournées avec une facilité déconcertante au profit des nouvelles dynamiques libérales. »
 Les conséquences politiques de cette nouvelle hégémonie politique ont largement été étudiées par le philosophe anarchiste Renaud Garcia dans Le Désert de la critique – déconstruction et politique (L’Échappée, 2015). Il conclut notamment que les systèmes de pensée théorisés par Foucault, Derrida ou Deleuze – qui se bornent à « “déconstruire” la pensée, les idées, les postulats, la vision du monde de l’adversaire, plutôt que d’en opérer la critique ou la démystification » – « détournent les énergies révolutionnaires et favorisent paradoxalement les évolutions du système socio-économique contemporain. » Elles conduisent une vraie « prolifération des luttes » – antiracistes, féministes, etc., qui ne sont pas pour autant remises en cause –, au détriment de la lutte globale et inclusive contre le système. À Nuit debout, la multiplication des commissions particulières, à côté des commissions d’ordre plus général, en est le symptôme. C’est probablement ce qui explique que les classes populaires, dans leur ensemble – blanches ou d’origine immigré, périurbaines et banlieusardes, etc. –, ne s’identifient que peu au mouvement pour le moment. La réalisation de la convergence des luttes a pour condition la mise en avant de combats rassembleurs, ainsi que comme l’expliquait il y a quelques semaines au Comptoir Romain Masson, la mobilisation d’« un imaginaire commun et des références qui parlent à tous ». Seule une analyse globale du fonctionnement du capitalisme, de ses agents (bourgeoisie, bureaucrates, classes politiques dirigeantes, etc.) et de ses institutions (Union européenne et État centralisé), ainsi que les difficultés qu’ils génèrent dans le quotidien des “gens ordinaires” peut le lui permettre.
Les conséquences politiques de cette nouvelle hégémonie politique ont largement été étudiées par le philosophe anarchiste Renaud Garcia dans Le Désert de la critique – déconstruction et politique (L’Échappée, 2015). Il conclut notamment que les systèmes de pensée théorisés par Foucault, Derrida ou Deleuze – qui se bornent à « “déconstruire” la pensée, les idées, les postulats, la vision du monde de l’adversaire, plutôt que d’en opérer la critique ou la démystification » – « détournent les énergies révolutionnaires et favorisent paradoxalement les évolutions du système socio-économique contemporain. » Elles conduisent une vraie « prolifération des luttes » – antiracistes, féministes, etc., qui ne sont pas pour autant remises en cause –, au détriment de la lutte globale et inclusive contre le système. À Nuit debout, la multiplication des commissions particulières, à côté des commissions d’ordre plus général, en est le symptôme. C’est probablement ce qui explique que les classes populaires, dans leur ensemble – blanches ou d’origine immigré, périurbaines et banlieusardes, etc. –, ne s’identifient que peu au mouvement pour le moment. La réalisation de la convergence des luttes a pour condition la mise en avant de combats rassembleurs, ainsi que comme l’expliquait il y a quelques semaines au Comptoir Romain Masson, la mobilisation d’« un imaginaire commun et des références qui parlent à tous ». Seule une analyse globale du fonctionnement du capitalisme, de ses agents (bourgeoisie, bureaucrates, classes politiques dirigeantes, etc.) et de ses institutions (Union européenne et État centralisé), ainsi que les difficultés qu’ils génèrent dans le quotidien des “gens ordinaires” peut le lui permettre.
La question de l’organisation doit également être tranchée. Si la défiance à l’égard des partis et syndicats, qui se sont largement compromis, semble légitime, le refus de toute organisation est une erreur. Toujours dans Fakir, Todd commente : « C’est le drame de cette jeunesse : c’est nous, en pire. Les soixante-huitards ont découvert les joies de l’individualisme, mais ils avaient derrière eux, dans leur famille, une solide formation dans des collectifs : le Parti communiste, l’Église, les syndicats. Là, ces générations sont nées individualistes, ce sont des soixante-huitards au carré, quasiment ontologiques. Il n’y a même pas le souvenir de ces collectifs forts. Et la volonté de ne pas s’organiser est presque élevée au rang de religion. » Or, « les patrons, l’État, le Parti socialiste, les banques sont organisés ». De plus, la grève générale souhaitée par Nuit debout ne peut pas exister sans organisation. Dans Le Temps des révoltes (L’Échappée, 2015), Anne Steiner explique ainsi : « De 1905 à 1911, on compte entre 1 000 et 1 500 grèves par an, d’une durée moyenne de quinze jours, certaines se prolongeant au-delà. Sans l’existence d’une forte solidarité, la faim serait vite venue à bout de ces résistances ouvrières. » Cette dernière n’était possible que grâce au travail de la CGT, anarcho-syndicaliste à l’époque. Nuit debout a donc pour tâche de créer l’organisation qui correspond à ses idéaux et à ses objectifs. Le mouvement devra donc apprendre à combiner verticalité et horizontalité, apprendre à déléguer – et non pas se faire représenter et encore moins commander –, sans renier son ambition démocratique anti-autoritaire.
Nuit debout pourrait avoir un impact bien plus faible que Mai-1968 si les choses s’arrêtaient là. Le mouvement aurait alors échoué à changer quoi que ce soit et finirait par apparaître comme une vulgaire bulle médiatique. Bien que conscient – contrairement à ce que pense naïvement Élisabeth Lévy – que le “Grand soir” n’est pas à l’ordre du jour, Nuit debout ignore le rôle important qu’il doit jouer dans notre société. Il a pour mission de renouveler la contestation du système capitalisme, et de devenir un mouvement populaire digne de ce nom. Mais pour cela, il ne doit pas devenir la farce de Mai-1968 !
Nos Desserts :
- À propos du Mouvement du 22-mars
- À propos du Mai-1968 ouvrier
- Pour Michael Löwy, que nous avons interviewé, Mai-68 représente une révolte romantique
- Nos articles sur Nuit debout
- Ludivine Bénard analyse les qualités et les défauts de Nuit debout
- Éric Dupin note « les limites d’un mouvement sympathique » (Nuit debout)
- À propos des deux Nuit debout qui se déroulent place de la République
- Pour Thomas Guénolé, comme Mai-1968, « Nuit debout réinvente le militantisme de gauche »
- « Nuit Debout : lettre ouverte à Frédéric Lordon » sur L’Arène nue de Coralie Delaume
- À propos de la pensée de gauche post-1968, lire « Les impensés du camarade Usul » par Galaad Wilgos
- Le Comptoir vous explique la lutte de classes et le précariat
Notes :
[i] Le 22 février 1848, le peuple de Paris se soulève sous l’impulsion des libéraux et des républicains (qui incluent les socialistes). Le 24 février, le roi des Français Louis-Philippe Ier est contraint d’abdiquer et la IIe République est proclamée. Après près de dix mois de gouvernement provisoire, Louis Napoléon Bonaparte est élu au premier tour de l’élection présidentielle, qui se déroule le 10 décembre 1848, avec plus de 5 millions de voix, soit 74,2 % des suffrages exprimés.
[ii] Si la bourgeoisie a réellement pris le pouvoir en 1789, les “classes moyennes” n’ont réussi à imposer que leurs valeurs, mais sont restées des classes exploitées.
[iii] Guy Debord définit le spectacle comme « le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image ». En 1988, dans ses Commentaires sur la société du spectacle, il ajoute qu’il s’agit de « l’accomplissement sans frein des volontés de la raison marchande ».
[iv] René Riesel fait partie avec Cohn-Bendit des huit étudiants de Nanterre convoqués par le rectorat en commission disciplinaire le 6 mai 1968. Certains professeurs de leur université comme Henri Lefebvre, Alain Touraine et Paul Ricoeur les accompagnent en soutien. Riesel reste toute sa vie proche du situationnisme et demeure un farouche opposant à la société industrielle. Il est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages parus aux Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances.
[v] Le Mouvement du 22-Mars est un mouvement libertaire réunissant des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes, des mao-spontex et des sans-étiquettes, dont la personnalité la plus médiatisée est Cohn-Bendit. Créé le 22 mars 1968, il s’auto-dissout fin mai de la même année, avant d’être interdit le 12 juin.
[vi] C’est aux Enragés que nous devons certains slogans de type « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », « Prenez vos désirs pour la réalité », ou encore « L’ennui est contre-révolutionnaire ». Quant au slogan « Vivre sans temps mort, jouir sans entrave », il est de Vaneigem.
[vii] Pour rappel, le terme “bobo” (“bourgeois-bohème”) est apparu aux États-Unis en 2000 sous la plume de David Brooks dans Bobos in Paradise : The New Upper Classe and How They Got afin de désigner des gens aisés appartenant à la classe moyenne supérieure, habitant en milieu urbain et aux valeurs plutôt de gauche.
Catégories :Politique

Cher Kévin,
Si les ouvriers de Boulogne Billancourt ont fermé leurs portes aux étudiants en 68, c’est qu’à l’époque le travail de conscientisation mené par le PCF et la CGT était assez solide pour que les premiers comprennent que le mai 68 de Cohn-Bendit n’était pas un mouvement parallèle au leur en plus utopiste ou idéaliste, mais constituait bien l’ennemi de classe.
De même, Nuit Debout n’est pas un mouvement naïvement spontané et mignonnement désorganisé qui lutte maladroitement pour les travailleurs. C’est la réaction elle même, par qui passera la loi El Khomri « et son monde » (le monde du signifiant de la social démocratie libérale).
Puisque vous citez Michel Clouscard vous savez sans doute que contrairement à une certaine musique « de gauche » actuelle, la lutte des classe ce n’est pas la caissière face à Bernard ARNAULT. Dans la société post plan Marshall, la lutte des classes c’est à l’intérieur des nouvelles couches moyennes (concept clouscardien majeur) ceux issus de la promotion du bas (le prolétariat) face à ceux issus de la dégénérescence du haut (la grande bourgeoisie possédante). L’enjeu en est les nouveaux métiers de l’animation et du management nécessaires au mode de production libéral-libertaire (si vous l’ignoriez tout est expliqué dans Critique du libéralisme-libertaire paru aux éditions DELGA).
La lutte des classes actualisée ce sont les producteurs (ouvriers, employés, technicien-cadres, fonctionnaires précaires, petits entrepreneurs surtaxés) face aux surplus du libéralisme libertaire qui composent le mouvement Nuit Debout soit ceux qui occupent les postes « peinards » et valorisés du système (métiers de l’animation, de la culture, étudiants, intermittents du spectacle, travailleurs indépendants…) et même si leur situation est également en voie de dégradation (crise oblige) par rapport à celle de leurs parents qui eux ont étés les grands gagnants de 68 (professions libérales, profs d’université, journalisme…).
Bien à vous,
PERRIOT
Bravissime!